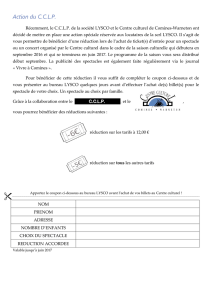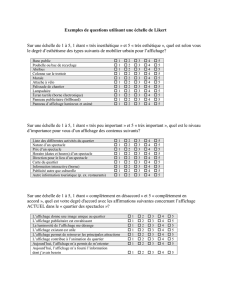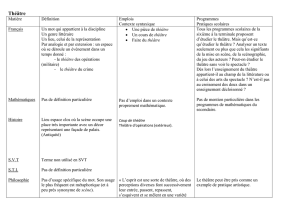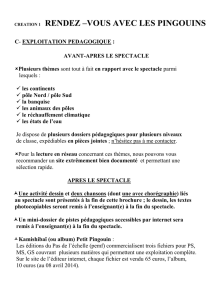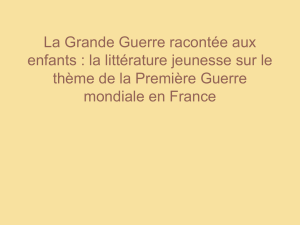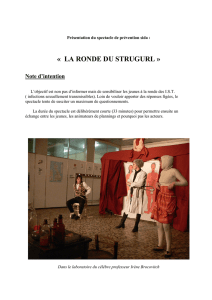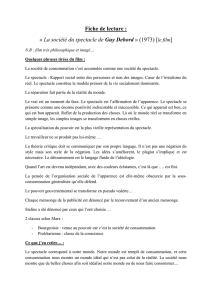la question du sens : transversalite, interactivite

1
Espace Magnan 31, rue Louis de Coppet Nice
A
A
AC
C
CT
T
TE
E
ES
S
S
D
D
DU
U
U
C
C
CO
O
OL
L
LL
L
LO
O
OQ
Q
QU
U
UE
E
E
S
S
Sp
p
pe
e
ec
c
ct
t
ta
a
ac
c
cl
l
le
e
e
V
V
Vi
i
iv
v
va
a
an
n
nt
t
t
e
e
et
t
t
T
T
Te
e
ec
c
ch
h
hn
n
no
o
ol
l
lo
o
og
g
gi
i
ie
e
es
s
s
N
N
Nu
u
um
m
mé
é
ér
r
ri
i
iq
q
qu
u
ue
e
es
s
s
Samedi 29 Avril 2006
Audiovisuel et holographie au service des Arts de la scène
Le potentiel créatif des nouvelles techniques
L’intégration de techniques audiovisuelles et numériques dans le spectacle vivant ouvre de
nouveaux espaces expressifs. Cette recherche de métissage des formes et des techniques se
rencontre aujourd’hui dans la plupart des arts de la scène, qui s’enrichissent mutuellement
de leurs apports spécifiques. La venue, au Théâtre National de Nice, de la compagnie
canadienne 4DArt avec un spectacle hybride, alliant réel et virtuel, est l’opportunité d’une
journée de réflexion sur ces nouvelles pratiques.
PROGRAMME
Ouverture………………………………………………………………………………………………….. Page 2
La question du Visuel…………………………………………………………………………………… Page 3
La question du Son……………………………………………………………………………………… Page 17
La question du Sens (Scénographie)………………………………………………………………… Page 24
La question du Sens (Transversalité, Interactivité)………………………………………………… Page 28
Conclusion………………………………………………………………………………………………... Page 41
Annexes (Ouvrages cités, Remerciements, Contacts, Partenaires et relais) ………………… Page 42

2
OUVERTURE
Andrée Ugolini
A travers notre programmation théâtrale, nous avons vu se dessiner nettement une tendance à inclure des
éléments audiovisuels dans le spectacle vivant : danse, théâtre, musique. Interventions souvent limitées
faute de supports ou de moyens, mais révélatrices d’une évolution réelle. Nous avons donc pensé que
l’Espace Magnan - lieu de théâtre et de cinéma - se devait de proposer une journée de réflexion destinée à
faire le point sur cette question de l’intégration des technologies numériques dans le spectacle vivant.
Echanger des informations, partager des expériences, essayer de répondre à certaines questions que l’on
peut se poser, voilà ce qui va tisser la trame de cette journée, à travers les 4 tables rondes que nous vous
proposons. Je voudrais remercier le Conseil Régional des Alpes-Maritimes et la ville de Nice - dont nous
avons un représentant avec nous aujourd’hui, M. Cédric Cirasa, conseiller municipal chargé des affaires
culturelles – ainsi que le Théâtre National de Nice et la DRAC PACA, qui sont nos partenaires pour cette
journée.
Joël Bayen-Saunères
En préambule, j'avais envie d’insister sur le terme mêler, car ce qui me parait intéressant, c’est d'arriver à
produire des oeuvres qui dans leur structure même, mêlent le spectacle vivant et l'audiovisuel.
Si on arrive à travailler sur des projets artistiques, dans lesquels la mise en scène se mêle à la mise en
image, tout en gardant en perspective la quête du sens, alors il peut y avoir là quelque chose de très
intéressant à développer. Il ne s'agit pas de remplacer quelque forme théâtrale que ce soit, mais plutôt
d'essayer d'ouvrir de nouveaux espaces expressifs, à notre époque d'image et de multimédia.
Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs. L'idée de cette journée est de faire le point, d’une manière
forcement assez générale : repérer les problématiques, donner des réponses à certaines questions, poser
certaines questions sans forcement trouver de réponses… à charge pour chacun de préciser sa propre
recherche, ses propres réflexions.

3
LA QUESTION DU VISUEL
Michel Lemieux, co-directeur (avec Victor Pilon) de la Compagnie canadienne 4dart, de Montréal.
Co-metteur en scène du spectacle La Tempête. Musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène et
performeur. Réalisateur de vidéos clips, de publicités, de courts métrages, et de plusieurs expositions
multimédia.
Franco Bevione, ingénieur multimédia, directeur général du Virtual Reality Multimédia Park de Turin.
Georges-Albert Kisfaludi, ingénieur optique et multimédia, enseignant en art et nouvelles technologies,
spécialiste en scénographie et art vivant. Fondateur de la société ATEA, basée à Nancy, spécialisée dans la
conception et l'aménagement scénographique, la production multimédia et la réalisation audiovisuelle.
Claudio Papalia, président de la FERT (Filming with an European Regard in Turin), association qui a pour
but d’aider la création audiovisuelle et cinématographique indépendante, relais du programme MEDIA à
Turin. Claudio Papalia est porteur d'un projet Interreg pour le développement des entreprises
audiovisuelles, dans lequel se trouve un volet concernant l'intégration des nouvelles technologies dans les
réalisations théâtrales.
Andréa Arghinenti, ingénieur et technicien aux studios Virtual Reality de Turin. Responsable pour la
création de contenus 3D.
Spectacle vivant et nouvelles technologies
Joël Bayen-Saunères
Ce qu'il y a de formidable dans La Tempête, c’est qu’il ne s'agit pas d'un événement purement visuel, mais
que vous ayez relevé le challenge de ne pas utiliser les effets vidéos, les effets numériques, comme une
simple illustration - ce qui peut être très bien - mais avez tissé toute la trame de votre mise en scène. Le
théâtre et la danse abordent à peine ce niveau d’intégration, restant le plus souvent dans l’illustratif.
Michel Lemieux
Et bien oui, mais c’est normal : cela fait près de 20 ans que je baigne là dedans. Quand mon père à vu mes
premiers spectacles, il m'a dit : « mais tu faisais les même choses dans ta chambre avec une lampe de
poche, des marionnettes, toutes sortes de choses… . Je suis né devant un téléviseur, alors pour moi la
technologie, c’est comme un crayon. C’est un outil tout simplement. Un outil fascinant, parce que c’est un
crayon qui change de forme continuellement, qui se perfectionne, qui est multiforme. Je n’ai jamais vu
l'utilisation de la technologie dans les spectacles vivants comme quelque chose de plaqué, au contraire.
Cela fait complètement partie, pour moi, de l'expression théâtrale, et ça se doit d'être travaillé dès le début
d'une création.
J’ai commencé à l'école nationale de théâtre du Canada, en technique du théâtre. On m’y a enseigné les
techniques séculaires du théâtre et c’est vrai que je me suis toujours senti un peu cloisonné dans cet
enseignement là, bien qu’il m'ait donné la méthodologie nécessaire pour faire ce métier. Alors, très tôt, en
sortant de l'école nationale, en 79, j’ai tout de suite bifurqué. J’ai eu à faire une affiche pour le chorégraphe
Edouard Lock. Rapidement, je me suis retrouvé dans les spectacles de sa compagnie, la Human Step, en
tant que musicien d’abord. J’ai entrepris de le convaincre d’utiliser un peu plus d’images dans ses
spectacles. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé comme performeur sur scène. Je dis bien performeur et
non comédien, parce que je ne suis absolument pas un comédien. Performeur dans le sens de la
performance. Donc, un art de la gestuelle. Un art qui est au-delà de la dramaturgie.

4
Détourner les règles
Michel Lemieux
Je me suis retrouvé à faire des spectacles sur scène, mes propres créations, dans lesquelles je jouais de la
guitare électrique, toujours avec une pièce de 25 centimes, un culot de bouteille, ou un tournevis… toujours
d'une façon détournée, à la John Cage. Voilà, détourner les outils, c’est l’esprit dans lequel je travaille
depuis 20 ans. Quand on prend un projecteur vidéo et qu'on ne lit pas nécessairement le livre d'instructions,
on en arrive à le mettre à l'envers, à changer la lentille, à rajouter un miroir… ce sont des choses qui
normalement ne se font pas. Je ne veux pas utiliser les machines en les respectant trop. Je veux pouvoir
casser la mine de mon crayon quelquefois. Je pense qu'il faut transgresser la technologie et ses machines.
C’est une attitude un peu irrévérencieuse que j'ai toujours eu et que mes collègues ont toujours partagé par
rapport aux technologies et aux programmes informatiques. Comment détourner l'usage premier et
s'approprier ces outils ? Ce que j'adore dans le spectacle vivant, c’est qu'on travaille à la fois avec du digital
et avec des bouts de ficelle. Je m'identifie beaucoup à Cocteau, par rapport à sa multidisciplinarité, mais
aussi à Méliès, au niveau du bricolage des choses.
La modernité, une notion très virtuelle
Michel Lemieux
Il ne faut pas avoir peur d'utiliser éventuellement de vieilles techniques. Ce qu'on fait est basé sur de très
vieilles techniques, en fait, notamment celle du Pepper’s Ghost. Je connaissais bien le travail d’Arthur
Pepper, en Amérique. La première fois que j'ai vu ses techniques à l’œuvre, c’était à Disney World, en
Floride, dans la maison hantée. J'avais 18 ans et j’y suis retourné à peu près 4 fois de suite, pour
comprendre comment cela fonctionnait. Ils font ça avec du verre et des mannequins. On est placé sur une
espèce de petit monorail, et les mannequins sont au-dessous. On voit, par un simple fading d'éclairage, les
mannequins apparaître en fantômes dans le décor. J’ai pensé que l'on pourrait faire ça avec de la vidéo. J’ai
un ami qui a une société d'informatique au Québec. Il m'a demandé un petit spectacle corporatif de 10
minutes. Alors nous avons fait un petit théâtre de 70 places, avec une petite scène de 3 mètres de large, et
nous y avons fait nos premiers essais de Pepper’s Ghost ; mais appliqués au plexiglas et à la vidéo.
Nous avons appelé notre compagnie 4dart, parce que, à partir de la troisième dimension - des gens sur
scène, des décors - nous ajoutons une quatrième dimension, qui, pour certains, est le temps, et pour nous
est cette dimension du virtuel, cette dimension évanescente des images.
Finalement, on s'est retrouvé au musée d'art contemporain de Montréal, en 91, pour faire un spectacle basé
sur le recueil de poésie d'un ami, qui s'appelle Claude Beausoleil - très grand poète québécois -, qui
s'appelle Grand hôtel des étrangers. Un hôtel qui existait à Paris, il y a plusieurs années. C'est l'histoire d'un
poète qui va dans cet hôtel et fait le bilan de sa vie en une nuit.
On parle souvent d'holographie, mais en fait cela n’existe pas encore : il y a quelques essais d'holographie
sans support apparent, mais ce n’est pas encore ça. Dans nos spectacles nous utilisons une simulation
d’holographie, basée sur les vieilles techniques de l’illusionnisme. Avec ces techniques, on peut développer
un langage holographique, même si la technique holographique appliquée au spectacle n'existe pas
encore. Nous avons utilisé ces techniques dans Grand hôtel des étrangers, pour illustrer le voyage intérieur
du personnage. Ça ressemble beaucoup à La Tempête.
4Dart
Par la suite, on a fait plusieurs productions : une basée sur le mythe d'Orphée, qui s'appelait Orfeo. Avec
plein d'hommages et de clins d’œil à Orphée de Cocteau. Une création centrée sur la danse, sans texte.
Les seuls textes que nous avions étaient des citations sonores injectées dans la musique. Des citations de
Cocteau, d'Edouard Dermit, du film, et quelques citations de l’Orfeo de Monteverdi, et d’Orphée et Eurydice
de Gluck. J'avais tellement trituré la musique des opéras que cela devenait complètement autre chose.
Orphée est un thème tellement travaillé, qu’on avait décidé de l’actualiser pour notre spectacle. Par la suite,
on a fait un spectacle qui s'appelait Anima, basé sur une entrevue radiophonique que Desmond Morris,
l'anthropologue britannique (Auteur du Singe Nu), avait fait pour Radio Canada, il y a quelques années.

5
On y trouvait un Desmond Morris beaucoup moins scolaire que dans ses documentaires. Il était plein
d’humour. Il vulgarisait sa pensée pour le grand public. On nous a donné la permission d’utiliser sa voix, et
le spectacle s'articulait sur un certain nombre de ses pensées.
C’était un spectacle assez politique, parce que Desmond Morris parlait beaucoup de la guerre et de cette
qualité que nous avons, nous les humains, de coopérer. Qualité qui nous permet de vivre dans des
mégapoles sans trop d'anarchie.
Mais faculté qui crée aussi les soldats qui obéissent aux ordres et vont tuer des gens. Ce spectacle a eu une
carrière internationale, comme tous nos spectacles. On va notamment souvent jouer aux Etats-Unis.
Celui-là a été peu vu là-bas, parce qu'après le 11 septembre, les Américains ne voulaient pas entendre ce
discours, même les intellectuels.
La Tempête, de Shakespeare
Tous nos spectacles sont extrêmement différents les uns des autres. Ce qui déstabilise beaucoup les
puristes, parce qu'ils s'installent dans un style de spectacle. Quand Lorraine Pintal - qui est la directrice
artistique du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), le plus grand théâtre de répertoire français en Amérique –
nous a invité, Victor Pilon et moi, à faire un spectacle dans son théâtre, elle voulait que ce soit, du théâtre
classique. Elle produit aussi du théâtre de création, mais en bonne directrice de théâtre, elle doit composer
une saison, et cette saison-là, il y avait déjà beaucoup de créations. Evidemment, on ne pouvait pas espérer
refaire le film de Greeneway, qui est absolument génial. Mais, La Tempête, c’est une pièce déjà un peu
virtuelle. Dans les didascalies, sur certaines traductions, on peut lire « Ici apparaissent des spectres
évanescents, sur une musique étrange »… On a lu cela et on s’est dit, « mais, c’est nous ! C’est vraiment
nous. Il faut monter cette pièce ! ».
Il faut savoir que le théâtre élisabéthain se faisait le jour, à ciel ouvert. Le Globe Theater est à ciel ouvert.
Et les pièces duraient très longtemps, 4, 5, 6 heures. J'ai eu la chance de voir un opéra chinois, qui dure
éternellement, et Shakespeare, c’est un peu comme un opéra chinois : les gens entrent, sortent, ils arrivent
à l'entracte, mangent durant le spectacle. On dirait qu'ils n’écoutent pas, et tout d'un coup, un acteur arrive
sur scène, et tout le monde se met à applaudir. Car ils écoutent, en fin de compte. Mais ils connaissent
tellement la pièce, que l’on dirait qu’ils n’écoutent pas. Le théâtre élisabéthain, c’était un peu comme ça. On
faisait du business, on se livrait à des échanges sociaux… et la pièce se déroulait. C'est pour cela que dans
le texte original de La Tempête, qui dure plus de 3 heures, chaque information est répétée au moins quatre
fois. Et quand on arrive à la troisième répétition, il y a toujours un : « M'écoutes-tu Miranda ? ! », pour dire au
public : « Là, maintenant, c’est la troisième fois, il faut que vous écoutiez, si vous voulez comprendre
l'histoire ». Comme de nos jours, on est dans une perspective de public captif, où le public voit trois films en
DVD par semaine, il commence à être habitué aux ellipses et aux techniques de narration : on n'a plus
besoin de répéter.
Le travail en équipe
Quand le TNM nous a invité, ils avaient un peu peur, parce qu'ils savaient qu'on ne fait pas vraiment du
théâtre. On est des metteurs en scène de danse, de performance, de multidisciplinarité, mais on n'est pas
vraiment des metteurs en scène de théâtre classique. Alors, quand nous avons dit que nous aimerions
monter La Tempête, mais pas tout seuls, avec une metteur en scène que nous aimons beaucoup, Denise
Guilbault, ils ont été très soulagés. Ils allaient avoir un spectacle qui puisse plaire à leurs abonnés. Et en
même temps, pour nous, c’était une façon de travailler avec cette femme extraordinaire, qui ne travaille pas
du tout le multimédia ou l'audiovisuel, et est vraiment dans le théâtre pur. On ne se sentait pas assez calé en
dramaturgie et en direction d'acteurs classique pour monter cette pièce. Donc, nous avons fait la mise en
scène à trois. Ce qui se fait très bien parce qu'au Québec, on a une hiérarchie horizontale. Contrairement en
Europe, où on a une hiérarchie verticale. Ici, le théâtre est très jeune. Ça fait 30 ans que l'on fait du théâtre
original au Québec. Avant on faisait une copie du théâtre français. Au Québec, le technicien et le concierge
du théâtre peuvent donner leur avis. Et si elle est géniale, l'idée du concierge, qui suis-je pour la refuser ?
On a beaucoup de créations collectives au Québec, à cause de cela. Il y a une espèce de convivialité. Alors
faire une mise en scène à trois, ce n’est pas difficile pour nous.
Pour Denise, ce qui était déstabilisant, c’était la présence du virtuel. Pour elle, tout était possible. Alors
quand on a commencé à lui indiquer les limitations : « Tu peux pas sortir du cadre, ça reste sur scène, c’est
à l'italienne, tu peux pas aller dans la salle, ça reste quand même frontal... » elle s'est mise à comprendre
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%