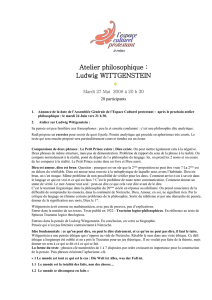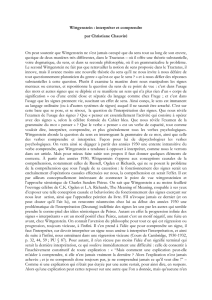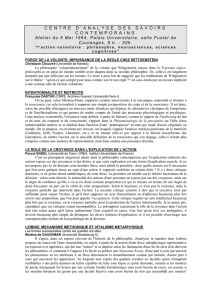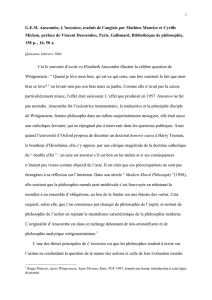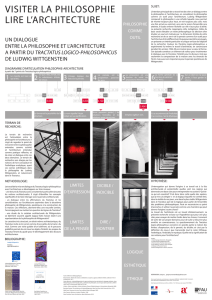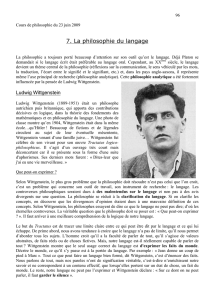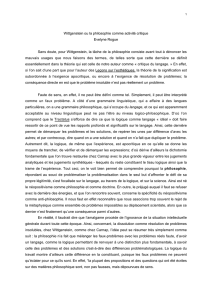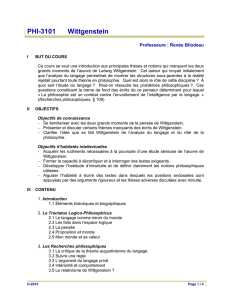Langage Usage - Chiara Pastorini

numéro 33
Les philosophes
Le Tractatus développe une conception du langage fondée sur
la correspondance entre les propositions et les faits du monde.
Une proposition est vraie si elle est l’« image de la réalité »
(Tractatus, 4.021), autrement dit si l’état de choses qu’elle
représente existe. Et inversement : par exemple, « la mer est
rouge » est une proposition fausse parce qu’aucun fait
ne lui correspond. Avec le passage du Tractatus à ses écrits
postérieurs, Wittgenstein abandonne cette vision
d’un langage figuratif, qui est également idéal et unique ;
il revient au langage de tous les jours et élabore
une philosophie « plurielle » de celui-ci. Le langage apparaît
dès lors comme un ensemble hétérogène de « jeux
de langage », expression qui renvoie à des activités diverses
comme « donner des ordres », « résoudre des énigmes »,
« faire une plaisanterie », etc. (Recherches philosophiques,
§ 23). Ces jeux, qui restent ouverts, sont liés entre eux
par des analogies et des différences ; ils présentent un « air
de famille » et non une unité d’essence. Ainsi, le langage
n’est pas quelque chose de figé et d’immuable, qui pourrait
être analysé dans ses composantes une fois pour toutes.
De nouveaux jeux de langage surgissent sans arrêt,
et d’autres tombent dans l’oubli, de la même façon que,
dans une ville, des maisons anciennes se mêlent
à des constructions nouvelles. Enfin, pour Wittgenstein,
les jeux de langage s’entrelacent à des pratiques
extralinguistiques (gestes, comportements, etc.). Le fait
de parler est indissociable d’une « forme de vie », notion qui
peut être considérée comme synonyme d’activité, au sens
où les êtres humains communiquent en tant qu’acteurs dans
des contextes définis par des usages et des habitudes. Ce n’est
que dans une manière d’agir déterminée, à l’intérieur d’une
même forme de vie, que le sujet d’une communauté apprend
un langage, lui donne un sens et interagit avec autrui.
On distingue d’habitude un « premier » et un « deuxième »
Wittgenstein : l’auteur du Tractatus logico-philosophicus
d’une part, et celui des écrits postérieurs aux années
1931-1932, dont les Recherches philosophiques (cf. cahier
central) représentent l’œuvre principale, d’autre
part. Cependant, Wittgenstein a toujours conservé une manière
propre de faire de la philosophie, qui présente trois traits
saillants. Premièrement, la philosophie a, pour Wittgenstein,
un but d’éclaircissement conceptuel. Si dans le Tractatus elle vise
à la « clarification logique des pensées » (Tractatus, proposition 4.112),
dans les Recherches philosophiques elle devient « un combat contre
l’ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre
langage » (§ 109). La philosophie assume donc pour Wittgenstein
une fonction thérapeutique, au sens où elle nous guérit des erreurs
et des confusions qui peuvent surgir dans l’esprit ou dans l’usage
des propositions du langage. Deuxièmement, Wittgenstein conçoit
la philosophie comme une activité, et non comme une science
ou une discipline abstraite. Philosopher ne consiste pas à construire
des théories ou à énoncer des thèses ; au contraire, c’est se livrer
à une pratique antispéculative qui s’exerce au cœur même des
formes de communication humaine. Troisièmement, la philosophie
a pour Wittgenstein une vocation descriptive, et s’oppose en cela
à l’exigence explicative qui caractérise les sciences. Le philosophe
organise ses pensées non comme une succession d’arguments
et de démonstrations, mais plutôt comme des suites d’observations,
dont l’ordre guide le lecteur à travers des points de vue différents
qui font voir comment les choses sont. Dans le cas du Tractatus,
l’image la plus efficace pour décrire l’œuvre est celle de l’échelle :
les propositions sont comme les marches d’une échelle par
lesquelles on rejoint le point de vue optimal qui nous permet
de saisir ce qui auparavant était caché. Une fois arrivés au sommet
de la structure, nous sommes en mesure de penser et d’agir
sans retomber dans les équivoques de la tradition philosophique.
L’échelle (la philosophie du Tractatus) ne sert alors plus à rien,
et il faut s’en débarrasser sans regret !
Par Chiara Pastorini
La notion de « jeu de langage » est intrinsèquement liée
à l’idée selon laquelle le sens d’un terme dépend
de son usage concret. Au § 43 des Recherches philosophiques,
Wittgenstein explique que la signification d’un mot n’est rien
d’autre que son emploi dans le langage. Il donne l’exemple
suivant : « Si quelqu’un dit : “Moise n’a pas existé”, cela peut
signifier différentes choses. Notamment : Les Israélites
n’avaient pas qu’un seul guide quand ils ont quitté l’Égypte
– ou : Leur guide ne se nommait pas Moise – ou : Personne n’a
existé qui ait accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse
– ou : Etc., etc. » (§ 79). Le sens du mot « Moïse » tient donc
à l’usage qui en est fait dans nos jeux de langage, et il sera
différent selon qu’il est employé dans un récit, dans
un document historique, ou en tant que prénom d’un ami.
Contre toutes les théories linguistiques pour lesquelles
la signification consiste en l’association d’une image
(objective ou mentale) avec un signe, le concept de jeu
de langage ouvre plutôt sur une dimension pragmatique
et renvoie aux règles d’application qui gouvernent
les emplois des expressions. Métaphoriquement, le langage
se transforme alors en une « boîte à outils » (Recherches
philosophiques, § 11), ou en un « tableau de bord
d’une locomotive » (§ 12), où les « manettes » (comprendre :
les mots) ont une fonction spécifique.

numéro 33
Les philosophes
Wittgenstein prend souvent l’exemple de l’expression « J’ai mal
aux dents » et considère que celle-ci ne désigne pas une
expérience privée. De manière générale, selon lui, il n’existe pas
une intériorité cachée, un monde intime d’idées et de
sensations ; celles-ci ne sont pas des états ou des objets mentaux
que le sujet de l’expérience posséderait et connaîtrait grâce à
« l’œil de l’esprit ». Contre toute approche fondée sur le modèle
de l’introspection, Wittgenstein adopte un point de vue
grammatical, selon lequel « J’ai mal aux dents » – au même titre
qu’« Au secours ! », par exemple – n’est qu’un appel à l’aide,
une expression de douleur qui se substitue au cri primitif. Ainsi,
les énoncés construits à la première personne sont des actes
expressifs, qui ne reposent pas sur une quelconque observation
intérieure. Ces énoncés diffèrent des propositions à la troisième
personne du singulier (« Il a mal aux dents »), lesquelles
peuvent être validées objectivement (l’homme en question
se tord de douleur) et apparaissent comme des assertions
communicatives. La critique de l’intériorité n’a pas
pour but de fournir une théorie psychologique, mais de dissiper
une illusion majeure de la philosophie, celle du sujet
métaphysique de type cartésien, clos sur lui-même
et parfaitement conscient de ses affections et de ses actes
réflexifs. Wittgenstein substitue donc à l’ego un être incarné
faisant partie d’une communauté linguistique, d’un « nous ».
Autre terme clé de la deuxième philosophie
de Wittgenstein, les règles constituent
l’instrument par lequel les êtres humains
s’entendent dans les formes de vie
ordinaire. Au sein des jeux de langage,
les hommes suivent en fait des règles
de grammaire, qui, sans prédéterminer
d’une façon normative leur comportement,
fournissent toutefois les critères d’un agir
correct. Ici, « correct » signifie conforme
à une habitude partagée ; c’est à travers
un processus d’actions et de réactions
à l’intérieur d’une communauté linguistique
que l’apprentissage d’une certaine règle
a lieu. Nous apprenons des règles dans
des cadres très différents, selon que nous
faisons des mathématiques, que nous
voulons avoir accès à une langue étrangère
ou organiser notre cérémonie de mariage…
Les règles sont donc à la fois nécessaires
et conventionnelles, et elles sont par nature
publiques. Il est impossible de créer
et de suivre une règle à titre privé, car,
pour être établie et avoir une valeur, celle-
ci doit pouvoir être évaluée et adoptée
par les autres. Dans le même registre,
un langage privé, c’est-à-dire un langage
qui nécessairement n’est parlé et compris
que par une seule personne, est un
non-sens – parce que tout langage suppose
des critères d’application communs.
Les réflexions de Wittgenstein sur
les règles apportent ainsi un puissant
argument contre le solipsisme.
Dans les tests psychologiques, une illusion d’optique est fréquemment utilisée.
Il s’agit d’un dessin ambigu, silhouette que l’on peut voir tantôt comme un lapin
et tantôt comme un canard, selon que l’on considère son extrémité comme
des oreilles ou un bec (cf. illustration ci-contre). Pour Wittgenstein, l’hésitation
ressentie devant ce dessin, le fait que l’on puisse y voir un canard ou un lapin,
montre que cette expérience ne relève pas seulement de la perception, d’un voir-
simple : elle se situe à mi-chemin entre la vision et la pensée et requiert la notion
d’un « voir-comme ». Or, si l’étude du voir-simple est un problème physiologique
revenant aux sciences expérimentales, celle du voir-comme est un problème
conceptuel, qui concerne à ce titre la philosophie. Wittgenstein explicite
ce deuxième emploi du mot « voir » en faisant référence à la ressemblance
entre deux visages. Au lieu d’affirmer « Je vois quelque chose », je dis dans
ce cas : « Je vois que ces deux visages se ressemblent », ou bien « Je vois
une ressemblance entre ces deux visages ». Ce dernier usage du mot « voir »
relève d’un certain type d’expérience, la « remarque d’un aspect », et nous
conduit à modifier notre vision d’un objet, tandis que celui-ci ne change pas.
Seul livre édité de son vivant,
le
(traduction
de Gilles-Gaston Granger, « Tel » Gallimard,
2001) est une œuvre fascinante, traité de
logique qui débouche sur des considérations
sur l’éthique. Dans ses écrits du début des
années trente, notamment
(trad. de Marc Goldberg et Jérôme
Sackur, « Tel » Gallimard, 1996), Wittgenstein
critique l’illusion du sujet métaphysique et pose
les bases de sa seconde philosophie. Le sommet
en est les
(trad.
Françoise Dastur
et alii,
Gallimard, 2004,
cf. cahier central
), qui développe son approche
pragmatique du langage et ses réexions sur
les concepts psychologiques. Rédigé à la toute
n de sa vie,
(trad. de Danièle
Moyal-Sharrock, « NRF » Gallimard, 2006)
expose en particulier la différence entre le
savoir et la croyance. Mentionnons également
la très accessible
,
que l’on trouvera dans le volume
(trad.
de Jacques Fauve, « Folio Essais » Gallimard,
1992). Pour avoir accès à l’intimité de
Wittgenstein, les
(trad. de Jean-Pierre Cometti, PUF,
1999) sont des témoignages précieux. Enn,
les
(trad. de Gérard Granel,
« GF » Flammarion, 2002) sont une compilation
d’aphorismes saisissants sur des sujets divers,
de l’art à la science en passant par la religion.
Pour s’initier, le lecteur pourra se reporter
notamment à
de Joachim Schulte (trad. de Marianne
Charrière et Jean-Pierre Cometti, Éditions
de l’Éclat, 1992) ou à
de P. M. S.
Hacker (trad. de Jean-Luc Fidel, Seuil, 2000).
de Mathieu
Marion (PUF, 2004) et
, édité par Sandra Laugier
et Christiane Chauviré (Vrin, 2006), permettent
de découvrir les deux œuvres majeures
du philosophe. Pour approfondir, outre le très
complet
de
Hans-Johann Glock (trad. d’Hélène Roudier
de Lara et Philippe de Lara, Gallimard, 2003),
les travaux de Jacques Bouveresse sont
incontournables – voir en particulier
(Minuit,
1976). Parmi les publications récentes,
signalons
de Christiane
Chauviré (PUF, 2009), qui aborde la question
de la subjectivité chez Wittgenstein,
et le numéro de la revue
sur le thème
« Wittgenstein politique » (n° 38, PUF, 2009).
Dans une lettre à l’éditeur Ludwig
von Ficker, Wittgenstein écrit à propos
du Tractatus : « Mon livre consiste
en deux parties : celle ici présentée,
plus ce que je n’ai pas écrit. Et c’est
précisément cette seconde partie qui est
la partie importante. Mon livre trace
pour ainsi dire de l’intérieur les limites
de la sphère de l’éthique, et je suis
convaincu que c’est la SEULE façon
rigoureuse de tracer ces limites.
En bref, je crois que là où tant d’autres
aujourd’hui pérorent, je me suis arrangé
pour tout mettre bien à sa place
en me taisant là-dessus. » Sur l’éthique,
Wittgenstein garde le silence, et pour
cause : pour lui, elle représente ce dont
nous ne pouvons pas parler. C’est
le domaine de l’indicible, de l’insensé,
entièrement distinct du domaine
de la science, où, là, les propositions
ont un sens. L’éthique concerne
la valeur de l’existence, et plus
largement les « problèmes de
la vie ». Or, pour Wittgenstein,
les interrogations fondamentales ne
peuvent être exprimées, et de surcroît
résolues, dans et par le langage ;
même s’il existe chez l’homme
une tendance ancrée à vouloir mettre
des mots sur ses angoisses, à « s’élancer
contre les frontières du langage »
(Conférence sur l’éthique), l’éthique
demeure hors d’atteinte. Cet accent
mystique sur l’ineffable se retrouve
chez Wittgenstein dans ses
considérations sur l’esthétique
et la religion. Nous pouvons lire
en particulier dans le Tractatus
qu’« éthique et esthétique ne font
qu’un » (6.421). L’art se présente donc
également comme une tentative
de dire l’indicible. Plus précisément,
dans l’expérience esthétique,
la subjectivité du spectateur trouve
un point d’accord avec le monde,
qu’elle appréhende comme une totalité.
Dans ses leçons sur l’esthétique données
à Cambridge en 1938, Wittgenstein
compare le jugement esthétique à
une expression du visage ou à un geste.
Ce sont des choses qui ne s’expliquent
pas, mais se ressentent : dire qu’une
pièce de Schubert est mélancolique,
ce n’est pas énoncer une proposition
fondée, cela reviendrait plutôt
à dessiner un visage, à faire un
mouvement de la main ou à danser
1
/
2
100%