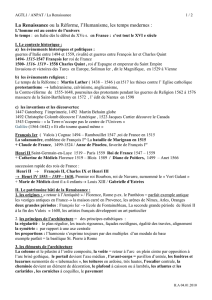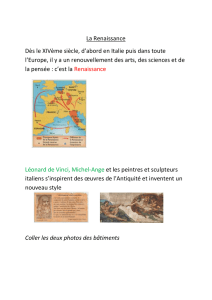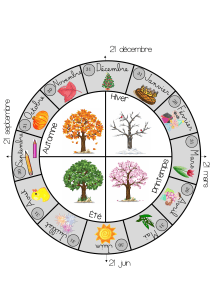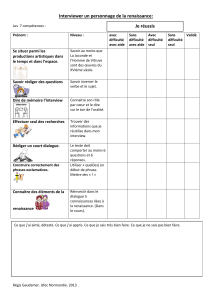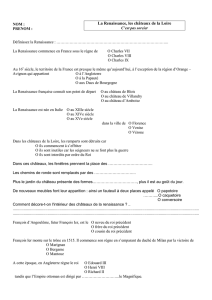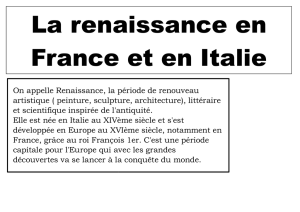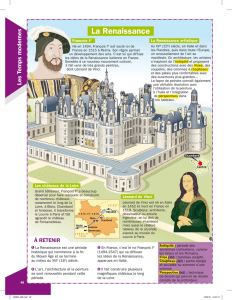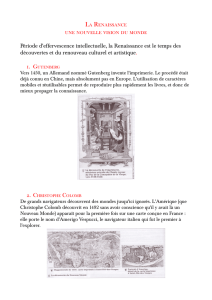la renaissance

65
L
LA
A
R
RE
EN
NA
AI
IS
SS
SA
AN
NC
CE
E
Ce nom est donné au vaste mouvement culturel qui, au XVe
et pendant une partie du XVIe siècle, abandonne explicitement
les valeurs médiévales, liées à la féodalité, et a, parmi
d’autres caractéristiques, celle de faire renaître les valeurs
de l’Antiquité dans la civilisation européenne. C’est un essor
intellectuel provoqué en Italie, puis dans toute l’Europe par
le retour aux idées et à l’art antiques gréco-latins, par le
retour aux canons esthétiques et aux thèmes gréco-latins, à la
perspective en peinture. Cette nouvelle esthétique succède à
l’esthétique médiévale. Le centre d’où elle part, c’est la
Toscane, surtout la ville de Florence.
La Renaissance est facilitée avant tout par la découverte
de l’imprimerie
20
qui fait connaître les œuvres des grandes
figures de l’Antiquité, et par l’invention de la gravure qui
contribue à vulgariser les œuvres d’art.
En Italie, la Renaissance a pour protecteurs les papes
Jules II et Léon X. C’est l’époque de l’Arioste, Machiavel, le
Tasse, Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico, Léonard de
Vinci, Michel-Ange, Bramante et tant d’autres. La Renaissance
est ici le produit d’un essor économique, durant plusieurs
siècles, des grandes cités marchandes et de Florence en
particulier. C’est dans cette ville qu’aux XIVe et XVe siècles
les grandes familles bourgeoises comme les Médicis, les
Strozzi ou les Pitti rivalisent dans les domaines de
l’architecture et du mécénat, suscitant ainsi un mouvement
plus général.
20
« Merveilleuse chose que l’écriture et merveilleuse chose que l’imprimerie qui divulgue les
mots, les réunit en brochures, en livres. Rien d’étonnant que Beda, lors de l’affaire des
Placards, ait obtenu du roi l’interdiction définitive d’imprimer des livres. L’imprimerie
était un instrument civil contre le pouvoir religieux. La Sorbonne l’avait bien compris.
C’était un instrument de divulgation des langues populaires contre le latin, un moyen de
répandre le savoir détenu par les couvents et les universités. L’interdiction avait été levée
grâce au crédit des Du Bellay auprès de François, premier du nom. Et les livres s’étaient
répandus comme une grande marée. Grâce surtout aux imprimeurs de Lyon » ( Michel Ragon : Le
roman de Rabelais, 1993, p. 186).

66
La Renaissance provient du mécénat des puissants qui
consacrent une partie importante de leur richesse à embellir
leur cadre de vie et à acquérir des signes de différenciation
sociale. En Italie comme en France, la Renaissance transforme
radicalement la place de l’art et de l’artiste au sein de la
société : les talents se mettent au service de personnes
privées, l’art est « privatisé ». Cette « privatisation »
s’oppose à la forme collective de la production et de la
consommation artistiques des temps féodaux. Cette forme
collective s’était exprimée principalement dans la
construction des cathédrales et dans la création des vitraux
qui étaient accessibles à l’ensemble de la population. À
l’époque de la Renaissance, les riches palais à Florence et
ailleurs présentent des façades extérieures austères et sont
fermés au public. Les sculptures et les peintures qu’ils
abritent sont réservées uniquement à ceux qui habitent ou qui
fréquentent ces demeures.
En France, la Renaissance apparaît beaucoup plus tard
qu’en Italie. D’après les spécialistes, son début coincide
avec les premières guerres d’Italie vers la fin du XVe siècle
qui mettent au contact la France et l’Italie. En Italie, les
seigneurs français apprennent à goûter la « dolce vita » (la
douceur de vivre) et, de retour en France, ils essaient de
reconstituer autour d’eux un cadre luxueux et raffiné. Ainsi,
la Renaissance française s’explique-t-elle par le désir de
luxe et le mécénat des rois et des grands financiers.
L’Italie, qui a fourni à la France deux reines devenues
régentes, Catherine et Marie de Médicis, plusieurs ministres
et une importante colonie d’immigrés (artistes, marchands,
banquiers, hommes de guerre et autres aventuriers) exerce sur
les Français du XVIe siècle une véritable fascination.
Le contact prolongé avec une civilisation supérieure sur
le plan technique, intellectuel et artistique a favorisé la

67
diffusion en France des idéaux de l’humanisme et de la
Renaissance.
Pendant la première moitié du XVIe siècle, la Renaissance
des arts et des lettres en France se fait sous le signe de
François Ier. Ce jeune homme cultivé et amateur d’art joue pour
la Renaissance française le rôle de Léon X pour l’Italie, le
rôle que jouera Louis XIV pour le classicisme. Favorable à
l’esprit nouveau, le roi se fait protecteur des savants, des
écrivains et des artistes ce qui lui apporte le titre de Père
des Lettres. Dans ce rôle, il est secondé par sa sœur
Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre. Cette dernière est
l’auteure d’un recueil de nouvelles écrites à la manières de
l’Italien Boccace, intitulé l’Heptaméron.
En 1530, François Ier fonde le Collège des lecteurs
royaux, l’actuel Collège de France. A l’époque, il s’agit d’un
groupe de professeurs payés directement par le roi et protégés
par le souverain, ce qui leur permet d’échapper à la tutelle
de la Sorbonne. Ils sont chargés d’enseigner des disciplines
que l’université de Paris ignorait. D’abord, on enseigne le
grec et l’hébreux, ensuite le droit français, le latin, les
mathématiques et la médecine. Notons que la Sorbonne
bannissait des études le grec qu’elle considérait comme langue
païenne. En créant cette institution, le roi contribue
implicitement à la propagation des idées de l’humanisme et de
la réforme.
Roi-mécène, François Ier attire en France les artistes
italiens les plus illustres : Léonard de Vinci qui meurt à
Cloux
21
près d’Amboise en 1519, Benvenuto Cellini, Rosso
Fiorentino, le Primatice
22
. Avec leurs œuvres, la cour de
France gagne en faste et en prestige, et bientôt l’art
français produit à son tour des chefs-d’œuvre.
21
Aujourd’hui, Clos-Lucé
22
Francesco Primaticcio

68
Rosso Fiorentino (le Florentin) et le Primatice
travaillent ensemble à Fontainebleau, chantier royal et centre
artistique de grande importance sous le règne de François Ier.
Rosso dirige toute une équipe d’artistes qui se consacrent à
la décoration de la galerie François Ier, le Primatice s’occupe
d’une part des appartements royaux ; d’autre part, il
contribue à l’embellissement du jardin où il réalise le
pavillon de Pomone, la fontaine de Hercule ou encore la grotte
des Pins. Les deux maîtres ont profondément marqué l’École de
Fontainebleau dont nous allons encore parler.
Le dessinateur, orfèvre, médailliste et sculpteur
Benvenuto Cellini, au service de François Ier, crée la célèbre
Nymphe qui devait décorer la Porte Dorée du château de
Fontainebleau, aujourd’hui exposée au Louvre, et il est
également l’auteur d’une magnifique salière, véritable chef-
d’œuvre d’orfèvrerie qui représente Cybèle, la déesse de la
terre et Neptune, le dieu de la mer. Le récipient, prévu pour
le sel, qui se trouve entre les deux figures assises l’une en
face de l’autre, est en forme de barque. La salière, conservée
dans un musée à Vienne en Autriche, est le seul objet
d’orfèvrerie de Cellini qui ait subsisté jusqu’à nos jours,
tous les autres étant perdus. Notons que le Musée Bargello à
Florence abrite sa superbe médaille à l’effigie du roi
François Ier.
48) La salière de Cellini.

69
A l’imitation des princes italiens, les Valois se veulent
des mécènes fastueux, protecteurs des lettres et des arts.
Amboise, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceaux,
Chaumont, Cheverny et tant d’autres châteaux de la Loire,
construits pour eux et pour leurs courtisans, témoignent de
leur prédilection pour ce Jardin de la France, où le
vocabulaire ornemental venu d’Italie se marie avec la
tradition française. La cour se sédentarisant de plus en plus,
c’est l’Ile-de-France qui l’emporte avec Fontainebleau, Anet
et le Louvre de Pierre Lescot et, plus tard, avec les
Tuileries de Philibert Delorme.
Dans le domaine de l’architecture, la réalisation la plus
prestigieuse de cette période est sans doute la construction,
lancée par François Ier, du château de Chambord qui est le plus
vaste palais de la Renaissance en France. La construction de
cet édifice, connu pour ses chapiteaux, flèches, cheminées et
terrasses, débute en 1519 et sa plus grande partie est achevée
en 1537. Le roi y associe une architecture lyrique de roman
chevaleresque à tous les signes extérieurs du pouvoir. À
l’intérieur, placé au centre de l’édifice, le célèbre escalier
à double vis, où l’on se croise sans se rencontrer, a
probablement été construit d’après un plan de Léonard de
Vinci. Ce qui est intéressant, c’est que l’on connaît les noms
de quelques maçons français ayant travaillé sur le chantier,
mais le nom du véritable architecte de cette demeure royale
reste inconnu. On suppose que Léonard de Vinci et un autre
Italien, Dominique de Cortone auraient pu participer à sa
conception.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%