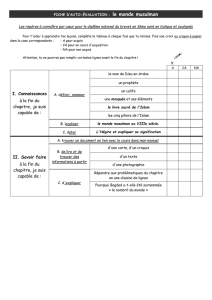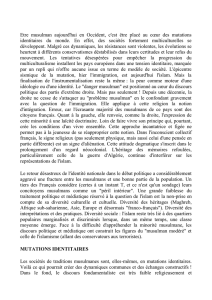Dounia Bouzar

Dounia Bouzar
Quel islam de France ?
Centre œcuménique, 12 décembre 2003
(Transcription G. Sustrac, revue par D. Urbain)
Dounia Bouzar est anthropologue, chargée de recherche à la protection judiciaire de la jeunesse et co-
auteur du livre « L’une voilée, l’autre pas ».
Le sujet d’aujourd’hui : les jeunes français de confession musulmane
Bonsoir à tous, merci d’être venus discuter avec moi. Permettez-moi, d’abord, de me présenter. J’ai été
éducatrice pendant 15 ans, auprès du juge des enfants, pour les adolescents avant de faire de la
recherche, de reprendre des études et de travailler sur la question de la première génération de français
de confession musulmane. Toutes mes positions sur cette question sont certainement liées au fait que
j’ai été éducatrice pendant des années. Ce que je vous propose ce soir c’est de faire le point sur cette
question
J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit bien de la première génération de français de confession
musulmane. Jusque là, il y avait effectivement, dans certaines familles, des gens nés ici sur le sol
français. Mais globalement, statistiquement, c’est depuis 25 à 40 ans que l’on assiste à la vraie
première génération de masse qui est socialisée à l’école de la République, a grandi en France et se
réapproprie sa référence musulmane en disant haut et fort « on veut être à la fois français et
musulmans » sans être un petit peu moins français pour être plus musulman ou l’inverse : on n’a plus
de choix à faire. Ce que je vais essayer de vous montrer ce soir c’est le tâtonnement dans lequel nous
sommes encore avec le rapport Stasi, le paradoxe aussi, les avancées, les richesses, les problèmes, les
choses qui tourneront, en tous cas pour essayer de témoigner puisque cela fait maintenant une dizaine
d’années que j’enquête auprès de cette génération là.
Ceux de cette génération essaient de se déterminer comme français de confession musulmane et ils se
trouvent au milieu des autres musulmans qui ne sont pas français, c’est-à-dire qui n’ont pas de racines
ici en France, qui ont donc une mentalité et une vision du monde propre à une culture différente, une
culture du pays du Maghreb, ou bien qui ont vécu l’immigration, ce qui correspond à acquérir une
culture et une représentation du monde différente. Donc d’un côté, d’autres musulmans qui ne sont pas
de culture française, de l’autre, les autres français qui ne sont pas musulmans et qui ont un regard sur
l’islam qui est pour beaucoup le produit de l’histoire et de la relation avec les pays musulmans. Je vais
vous parler uniquement de ces jeunes français de confession musulmane, pas de tous les jeunes, sans
vous dire que tous les jeunes musulmans, ou tous les jeunes un peu basanés, se sentent de telle façon.
Je vais essayer de vous faire comprendre de l’intérieur comment eux, ces jeunes, vivent les choses.
Réunir culture française et référence musulmane
Aujourd’hui, avec le rapport Stasi en particulier, on se situe à un moment de l’histoire où l’on espère
se placer à la réunion de la culture française et de la référence musulmane, même si d’une part cette
rencontre s’est déjà faite autrefois, en d’autres lieux, et si d’autre part, on ne rencontre jamais des
religions ou des cultures mais toujours des êtres humains qui ont intériorisé des interactions, des
éléments de culture, de religion, en interaction entre elles, qui sont toujours susceptibles d’évolution,
qui correspondent à une recomposition personnelle en fonction de l’histoire individuelle. A la
télévision, on vous a présenté des comportements de personnes dans des hôpitaux ou ailleurs, en le
reliant au fait qu’ils étaient musulmans. Jamais vous ne verrez ce type de raisonnement fait pour
d’autres personnes. Quand vous avez dans une cité quelqu’un qui vole, on vous dit : c’est un voleur.
Quand c’est un jeune basané, on va vous dire : c’est un musulman.

2
Il faut faire très attention à deux types de dérives : soit on ne reconnaît pas la facette musulmane d’une
personne, soit on essaie de la reconnaître et de se dire : il a le droit d’être musulman, etc. Mais on va le
réduire à cela, c’est-à-dire qu’on va lier tous ses comportements au fait qu’il est musulman. Et on va
lire toute sa façon d’agir au seul fait qu’il est musulman, souvent dans le négatif d’ailleurs. J’ai
carrément entendu des juges qui liaient le comportement d’un jeune au fait qu’il était musulman dans
son rapport à la loi. Il y a eu des déclinaisons de ce type à la télévision récemment à propos d’un mari
qui refuse la contraception à sa femme et tout cela est mis dans un débat sur la laïcité. Manque de bol,
l’islam permet la contraception et ce thème n’a rien à voir avec le débat sur la laïcité. Pour justifier
d’un type de comportement, quand bien même la personne concernée a sa référence musulmane, en
tant qu’éducatrice, je voudrais qu’on déconstruise ce qui pousse cette personne à avancer sa référence
musulmane pour justifier de son type de comportement, plutôt qu’on se dise : c’est cela être
musulman. Il faut faire attention à ne pas enfermer les gens dans une partie de leur identité ; les
musulmans sont des gens comme les autres avec un niveau social, une culture, une histoire familiale,
des angoisses face à la mort, la maladie, etc. Et ils mobilisent des ressources pour faire face à cela qui
ne sont pas toujours liées à l’islam, quels que soient leurs comportements.
Maintenant, je vais vous parler de ces jeunes qui aimeraient bien dire qu’on peut être à la fois français
et musulman. La première période durant laquelle les jeunes ont décidé de se réapproprier cet islam, se
situe quelques années après l’« échec » de la Marche des beurs. Après cette marche, une partie des
grands frères revendiquent le droit de vote pour les parents au niveau des municipales. Intervient
également la demande de lutte contre les discriminations et l’égalité à l’embauche. On peut parler
d’échec de la Marche des beurs car aujourd’hui on en est toujours au même point. Par contre,
Mitterand accorde un point important : la carte de séjour des 10 ans.
Les petits frères qui suivent, avec 4-5 ans de moins, voyant que les choses ne s’arrangent pas,
notamment en matière de discrimination et de ghettoïsation, se posent la question fondamentale : qui
sommes-nous pour être traités comme cela ? D’où un mouvement de regard sur la mémoire, sur ses
origines, qui est beaucoup plus fort chez ces petits frères qu’il ne l’était chez les grands frères qui ont
fait la Marche des beurs, qui étaient plutôt dans une dynamique de socialisation par l’école et pleins
d’espoir sur le modèle républicain conduisant à un travail.
La déception entre ce qu’ils avaient intériorisé à l’école (on est tous égaux, etc.) et la réalité quand ils
sont passés au monde du travail a entraîné la Marche pour l’égalité, sans parler des violences
policières. Les petits frères, s’apercevant quelques années plus tard qu’ils sont toujours victimes des
discriminations, se posent la question de qui ils sont et se réapproprient l’islam, notamment en se
disant : nos pères étaient de passage en France donc ils étaient discrets pour respecter leur hôtes, les
français ; ils ont fait attention de ne pas choquer personne, ont accepté de prier dans les caves, aussi
parce qu’ils vivaient dans l’angoisse d’être expulsés ; nos grands frères ont cru dans le modèle
républicain. Nous on est nés en France, on n’est plus expulsable et on ne veut plus rien cacher : on
veut se déterminer à partir de toutes nos références et on ne veut plus en laisser une partie à la frontière
(notamment la référence musulmane) puisque de toute façon en plus on ne nous donne rien en
échange. Il y a donc à la fois la réappropriation du passé et le signe qu’on est ici chez nous, que c’est
notre pays.
Organiser la question musulmane, au départ, est donc un signe d’intégration pour ces jeunes, la preuve
que leur vie est en France et qu’ils veulent avoir une relation authentique en France, alors que d’autres
français ont vécu cela comme un refus d’intégration. Il y a donc un premier malentendu de base qui se
place à l’époque de la construction des premières mosquées. Suite à cela, notamment dans le secteur
de Lyon où la Marche de beurs avait été initiée, les jeunes, quand ils ont récupéré cette référence
musulmane, ont regardé à l’étranger pour savoir ce que c’était être musulman. C’est l’époque de la
montée du GIA, de la Révolution iranienne, etc. À Lyon, cela donne lieu à des manifestations très
ostentatoires, voire violentes, dans lesquelles les petits frères se retrouvent dans la même envie que les
grands frères.

3
Cela signifie que, contrairement à certains mouvements qu’on appelle salafistes aujourd’hui qui
réclament une grande lisibilité et la séparation d’avec les autres, ils revendiquaient haut et fort de
rentrer dans les espaces qui leur étaient refusés au sein de la société en faisant « Allah est grand » sur
la place publique. Cette revendication ouverte était vécue comme une vengeance pour nos pères et nos
frères obligés de prier dans les caves.
Cela se situe vers 1987-88, avant l’affaire du foulard de Creil. Cette revendication entraîne une
première montée de la laïcité hostile à ce genre de manifestation à caractère religieux. La demande de
ces jeunes, citoyenne au départ, va passer à une lecture des droits et devoirs, en d’autres termes :
comment être musulman en France, sur cette terre laïque et jusqu’où pouvons-nous aller ? Ainsi, vont-
ils commencer à travailler sur les textes relatifs à la laïcité dans la Constitution et se rendre compte que
la laïcité n’est pas anti-Dieu et que rien, dans la loi française, ne les empêche de croire en Dieu. D’où
un premier soulagement. Suite à cela, ils éprouveront l’envie d’aller voir leur islam et de rentrer plus à
fond dans les deux concepts d’islam et de laïcité qu’on leur avait présentés comme incompatibles. Se
trouvent dans cette démarche les prémisses de l’islam de France. Ils vont retourner voir les textes
religieux de l’islam. De cette époque datent les premières traductions en français de nombreux livres
traitant de l’islam, les premières conférences en français, faites par des gens nés en France.
Avec cette réappropriation, cette relecture, on commence à penser l’islam en français, ce qui marque
un changement radical, une autre vision du monde, mal vécue par les autres musulmans. Quand on a
commencé à penser l’islam en français, disent les jeunes, on ne pouvait plus continuer à appeler les
autres français : des « mécréants », comme le faisaient d’autres musulmans qui venaient d’ailleurs. Le
regard sur les autres a changé. Et ils se sont alors rendu compte qu’on ne pouvait plus uniquement
regarder les autres pays musulmans pour savoir comment être musulman sur cette terre laïque et qu’il
y avait quelque chose à réinventer, à contextualiser (déclinaison du sens des choses et pas toujours de
la lettre).
La majorité de ces jeunes s’est vite reconnue dans une vision globale de l’islam : être musulman ne
peut être réduit au rituel ou à quelque chose de privé, mais englobe tous les domaines de la vie de tous
les jours (quartier propre, aide aux personnes âgées, respecter son professeur, bien étudier à l’école,
s’inscrire pour voter dans sa cité, etc.). Cette vision a fait peur également car cela rappelait la vision
des frères musulmans dans les pays musulmans. Le choix de cette vision globale permettait en fait aux
jeunes de ne pas avoir de choix à faire entre un bon citoyen et un bon musulman, et de régler la
question de ce monde bipolaire qu’on leur présentait : islam d’un côté et francité de l’autre. Chez les
Frères musulmans, il y a cette volonté d’islamiser la société : le Coran est ma constitution ; l’islam
règle tout.
Dans ces mouvements qu’on a vu naître en France, ce n’est pas le cas. Sur la question de la forme, il y
a une nouvelle conscience islamique qui n’existe qu’en France et qu’on a du mal à comprendre. Tout
en ayant une vision globale de l’islam et en appliquant l’islam dans tous les domaines de la vie, sur les
questions de fond, sur la forme, ils ont fait tout un travail pour séparer les principes du Coran et leur
application historique, ce qui leur a permis d’accepter la laïcité.
Les principes du Coran peuvent se décliner autrement que dans les pays musulmans qui en ont une
déclinaison historique, c’est-à-dire dans un cadre laïque. La laïcité est non seulement intériorisée
comme quelque chose qui ne dérange pas mais aussi qui permet de travailler encore plus les questions
de fond. Ce travail de séparation entre les principes du Coran et l’application historique n’est pas
encore fait sur le fond, c’est-à-dire sur un certain nombre de valeurs et ce sera difficile de la faire dans
le contexte actuel. Par contre, sur la question de la laïcité, ce qu’il faut retenir c’est que ce travail de
réflexion est fait pour la très grande majorité des musulmans de France.

4
La question des femmes
Cette question est encore plus aiguë que celle des hommes. Les femmes sont vraiment assignées à des
stéréotypes. Soit tu es musulmane et donc forcément soumise, soit tu veux devenir une femme
moderne et tu dois te détacher de toute référence religieuse. On a l’impression qu’une femme ne peut
rentrer que dans deux classes prédéfinies et que l’on fait fi de toutes les interactions qui peuvent
pousser un individu à se construire au-delà des places toutes faites. Mais il y a quand même cette
pression d’une norme occidentale qui serait le seul chemin pour devenir une femme moderne, alors
que elles aussi, première génération de françaises passées à l’école de la République, elles se
réapproprient leur sexe, justement parce qu’elles sont de culture française et qu’à l’école de la
République elles ont appris à dire « je ».
Et elles vont vérifier par elles-mêmes la réalité des textes qu’on a servi à leurs mères ou leurs grands-
mères et se rendre compte d’un certain nombre de mélanges entre les traditions et la religion : que rien
ne les oblige à épouser quelqu’un de même origine, encore moins leur cousin, qu’il n’y a pas de critère
ethnique dans le mariage musulman, que faire des études, c’est une obligation tant pour la femme que
pour l’homme et pas une permission. Jusque là elles avaient du mal à imposer des valeurs modernes, à
imposer à leur père qu’elles voulaient faire des études.
Bien sûr, je me base sur des familles en difficulté, celles qu’on rencontre en tant qu’éducatrice, avec
fréquemment un père au chômage. La fidélité au groupe familial passait par le respect des traditions.
Un père émigré, qui se retrouve au chômage, cela n’a pas que des conséquences économiques et
sociales. Il a pris la décision de partir d’un pays et lorsqu’il se retrouve au chômage, c’est sa
responsabilité personnelle de père qui est en jeu, c’est le sens de la famille en France dont il est
question. Dans certains cas, seule la religion lui fournira une explication à sa venue en France : c’est
Dieu qui a voulu que je sois là. Pour cette génération là, bien au-delà de la question de la référence
religieuse, c’est la question des trous de mémoire qui est portée de tous les côtés.
Pour les pères qui se retrouvent ainsi complètement déchus, leur seule autorité c’est la nostalgie, c’est
de se recroqueviller sur des valeurs qu’ils avaient dans leur village quand ils sont partis. Les jeunes
vous disent : mon père, il est plus strict que les pères qui sont restés au pays. Au pays, cela continue à
bouger, ici, mon père il a bloqué la pendule le jour où il est arrivé : « chez nous c’est comme çà ». De
l’autre côté, les éducateurs avaient une telle représentation de l’islam et de la culture arabo-musulmane
que quand ils arrivaient dans une famille avec ce genre de problèmes, ils ne parvenaient pas à faire la
part des choses entre ce qui tient du dysfonctionnement et ce qui relève de la culture ou de la religion.
Ainsi, l’éducateur ne se réfère plus à une grille de lecture professionnelle, mais on invoque l’islam.
Finalement, l’éducateur intervient en se référant aux lois en vigueur : chez nous, on n’a pas le droit de
taper sur sa fille ; chez nous la fille a le droit de faire des études, etc. Le jeune se retrouve ainsi tiraillé
entre le respect des traditions d’origine et l’ouverture offerte par les lois de la République. Or tout
adolescent a besoin de choisir des valeurs à l’extérieur de sa famille et de rentrer dans un système de
confrontation, de mesure entre générations. Et ces jeunes ne parvenaient donc pas à faire ce travail.
Or, la réappropriation de l’islam par les filles ne leur a pas servi à se rapprocher de leurs parents, mais
au contraire à confirmer l’obligation leur incombant de faire des études, leur droit à ne pas être mariée
de force, etc. Elles vont ainsi introduire les valeurs nouvelles dans leur famille, en s’appuyant sur la
lecture des textes religieux et en justifiant leur position par l’islam. Elles retournent ainsi vers leur
mère en lui disant qu’elle s’est fait « avoir » et elles argumentent.
Ainsi, ces jeunes ne vont plus se reconnaître dans des références ethniques (Algérie, Maroc…). On
veut des mosquées musulmanes diront-ils, avec des livres, des salles où l’on puisse travailler, faire de
l’éducation, des espaces fonctionnels, propres. Pas besoin de minarets, on n’est plus au Maghreb.
Donc il ne s’agit plus d’origine ethnique ou de respect des traditions, mais simplement d’être
musulman. Et cela va amener des valeurs nouvelles et des discussions. Il s’agit donc d’une véritable
libération pour ces jeunes filles, notamment vis-à-vis des grands frères, en tous cas certains d’entre eux

5
qui leur contestent le droit de faire des études, par exemple. Dans ce cas, l’islam leur sert d’outil pour
avoir accès à des valeurs modernes sans pour autant être dans une trahison des valeurs de la mémoire.
On observe une certaine « désethnicisation » de l’islam. La question d’être française ou musulmane
disparaît ainsi complètement et on peut avoir accès à des valeurs modernes sans être en rupture avec
l’islam.
Certes, les islamistes utilisent cette situation en indiquant que ce sont eux qui connaissent le Coran,
pas les parents, et s’en servent pour créer un conflit de générations pour enlever l’autorité des parents
sur les jeunes. D’ailleurs, lorsqu’une jeune fille quittait le cercle familial pour faire des études, les
éducateurs applaudissaient sans considérer la rupture que cela impliquait. Aujourd’hui, quand des
jeunes s’appuient sur l’islam pour le même objectif, on invoque les mouvements islamistes qui les
remontent contre leurs parents et pas le fait qu’ils ont le droit de remettre en question des traditions qui
ne sont pas de leur culture, étant nés ici, et qu’on ne va pas les obliger à se soumettre à des valeurs
ancestrales sous prétexte qu’ils sont passés par l’islam pour prendre un peu de recul. Cette génération
est à un tournant qui n’est pas facile à négocier et elle essaie de se trouver.
Mon point de vue est que ce qui fait l’égalité des hommes et des femmes, ce ne sont ni la Bible, ni le
Coran, c’est le développement économique des pays. À partir de là, il y a interaction entre les êtres
humains et les normes religieuses ; l’évolution de la société conditionne le dialogue avec les textes
religieux. Pour les femmes, repasser par l’islam pour revendiquer leurs droits présente deux
avantages : se réapproprier le passé et arracher aux hommes le monopole de parler au nom de Dieu.
Mais cela peut aussi conduire à des travers et amener certaines musulmanes à tout attendre de Dieu :
l’islam répondrait à tout. D’où l’intérêt pour elles d’avoir accès à d’autres représentations du monde,
par la science ou d’autres expériences humaines. Ainsi, après avoir abordé la forme, le temps était
venu de réfléchir au fond. Mais cela suppose de ne pas toucher à la liberté de conscience, faute de
quoi on ne permettra pas le développement d’une pensée autonome.
La référence musulmane
Si l’on veut faire évoluer tous les textes religieux, il faut distinguer la foi, les croyances et les rituels.
Les musulmans ont encore du mal à regarder objectivement un certain nombre de croyances,
lesquelles sont perçues inséparables de la foi. Ce qui s’explique, notamment, par la difficulté à
accepter cette référence musulmane comme une référence parmi tant d’autres. La lutte menée pour la
faire reconnaître amène automatiquement une surenchère. Pour moi, l’intégration de la référence
musulmane au patrimoine fondateur français est essentielle et le rapport Stasi en fait état, par exemple
en proposant des jours fériés musulmans partagés par tous, même si cela est normal et historique qu’il
y ait plus de fêtes chrétiennes. Toutefois, l’islam reste la référence du Maghreb et des pays arabes.
Dans les auditions de la Commission Stasi, on n’a pas fait assez fait la place aux musulmanes qui se
réapproprient l’islam et qui, comme Saïda Kada, vivent le voile comme un impératif religieux. À
l’inverse, le témoignage d’une iranienne maltraitée pour son voile a été déterminant sur le symbole et
le sens du foulard.
On est donc au croisement des mythes fondateurs : à la Révolution, remplacement du divin par la
nation, mythe de la race homogène issue des Gaulois, une histoire forte pour souder tous les français
sur des valeurs communes. Le premier objectif de l’école laïque obligatoire était de « franciser » les
paysans qui avaient leurs dialectes et leurs coutumes. Toujours au niveau des mythes et de la morale,
ce qui a justifié la colonisation c’était la volonté de civiliser (cf. la phrase de Jules Ferry : les races
supérieures ont un devoir, celui de civiliser les races inférieures). Cela partait d’un bon sentiment,
surtout si l’on considère ceux qui voulaient arrêter la colonisation parce que cela ne rapportait pas.
Néanmoins, cette approche de civilisation laisse des traces dans les inconscients collectifs. L’islam
c’était la référence des indigènes qu’il fallait civiliser.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%