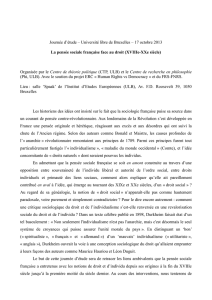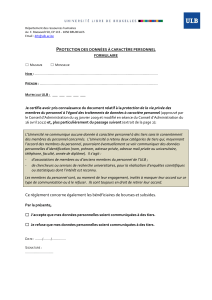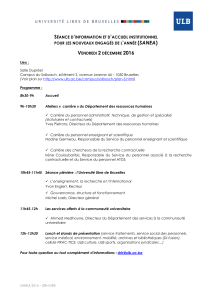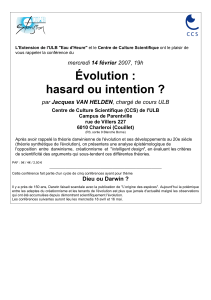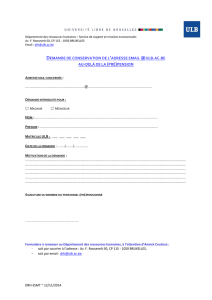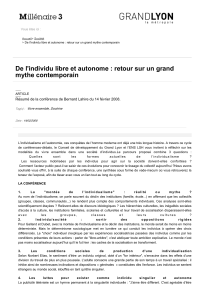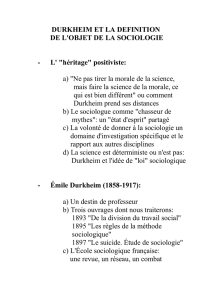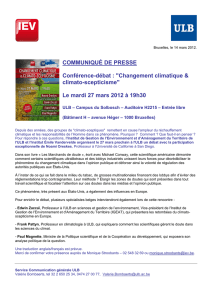La pensée sociale frç face au droit_17-10

Journée d’étude – Université libre de Bruxelles – 17 octobre 2013
La pensée sociale française face au droit (XVIIIe-XXe siècle)
Organisée par le Centre de théorie politique (CTP, ULB) et le Centre de recherche en philosophie
(Phi, ULB). Avec le soutien du projet ERC « Human Rights vs Democracy » et du FRS-FNRS.
Lieu : salle ‘Spaak’, Institut d’Etudes Européennes (ULB), Av. F.D. Roosevelt 39, 1050 Bruxelles
Les historiens des idées ont insisté sur le fait que la sociologie française puise sa source dans
un courant de pensée contre-révolutionnaire. Aux lendemains de la Révolution s’est développée en
France une pensée originale et hérétique, réagissant aux excès et aux désordres qui ont suivi la
chute de l’Ancien régime. Selon des auteurs comme Bonald et Maistre, les causes profondes de
l’« anarchie » révolutionnaire remontaient aux principes de 1789. Parmi ces principes furent tout
particulièrement fustigés l’« individualisme », « maladie du monde occidental » (Comte), et l’idée
concomitante de « droits naturels » dont seraient pourvus les individus.
En admettant que la pensée sociale française se soit en amont construite au travers d’une
opposition entre souveraineté de l’individu libéral et autorité de l’ordre social, entre droits
individuels et primauté des liens sociaux, comment alors expliquer qu’elle ait pareillement
contribué en aval à l’idée, qui émerge au tournant des XIXe et XXe siècles, d’un « droit social » ?
Au regard de sa généalogie, la notion de « droit social » n’apparaît-elle pas comme hautement
paradoxale, voire purement et simplement contradictoire ? Pour le dire encore autrement : comment
une critique sociologique du droit et de l’individualisme s’est-elle renversée en une revalorisation
sociale du droit et de l’individu ? Dans un texte célèbre publié en 1898, Durkheim faisait état d’un
tel basculement : « Non seulement l'individualisme n'est pas l'anarchie, mais c'est désormais le seul
système de croyances qui puisse assurer l'unité morale du pays ». En distinguant un ‘bon’
(« spiritualiste », « français » et « allemand ») d’un ‘mauvais’ individualisme (« utilitariste »,
« anglais »), Durkheim ouvrait la voie à une conception sociologique du droit qu’allaient emprunter
à leurs façons des auteurs comme Maurice Hauriou et Léon Duguit.
Le but de cette journée d’étude sera de retracer les liens ambivalents que la pensée sociale
française a entretenus avec les notions de droit et d’individu depuis ses origines à la fin du XVIIIe
siècle jusqu’à la première moitié du siècle dernier. Au cours des interventions, nous tenterons de
cerner les effets produits par la pensée sociologique sur le droit et, inversement, l’impact de

l’évolution post-révolutionnaire du droit sur la sociologie naissante. Il s’agira ainsi de reconstruire
dans toute sa complexité l’histoire intellectuelle de la pensée sociologique face au droit, de Saint-
Simon à Gurvitch, des lendemains de la Révolution aux premières ébauches de l’Etat social. Nos
réflexions seront guidées par l’hypothèse que la séquence historico-intellectuelle qui va de la
critique du droit et de l’individualisme à leur réhabilitation sociologique touche à des questions qui
sont aujourd’hui encore les nôtres.
Pour le comité organisateur :
Louis Carré (FRS-FNRS/ULB)
Jean-Yves Pranchère (ULB)

Programme
9h-9h30 : Accueil des participants et introduction à la journée
9h30-10h30 : « Une idée mystique de la solidarité sociale : la peine de mort de Maistre à
Ballanche », par Jean-Yves Pranchère (ULB)
10h45-11h45 : « Le statut du droit selon les saint-simoniens », par Frédéric Brahami (Université de
Franche-Comté)
11h45-12h45 : « Autour de la Raison Collective. Normes sociales et Justice chez Pierre-Joseph
Proudhon », par Anne-Sophie Chambost (Université Paris-Descartes)
13h-14h : Pause
14h-15h : « Durkheim et l’idée de contrat social », par Louis Carré (FNRS-ULB)
15h-16h : « Droit social et critique de la démocratie : les paradoxes de la règle de droit chez
Duguit », par Philippe Crignon (Université de Bordeaux)
16h-17h : « La Déclaration des droits sociaux de Georges Gurvitch : un ‘programme conscient
d’action politico-sociale’ », par Alain Loute (CPDR-UCL)
17h15-19h : Table ronde autour du livre de Bruno Karsenti (EHESS-Paris) D’une philosophie à
l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes. Discutante : Florence Caeymaex (FNRS-
ULg).
1
/
3
100%