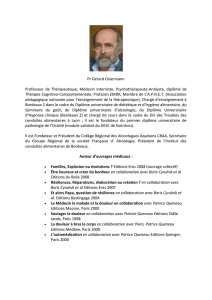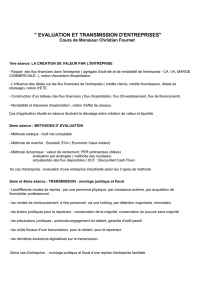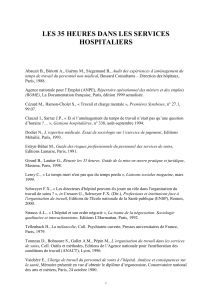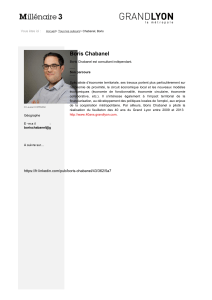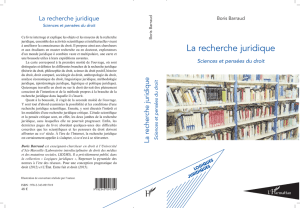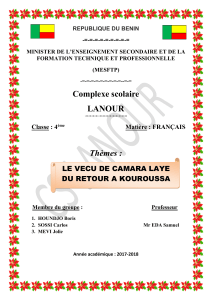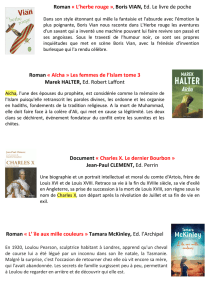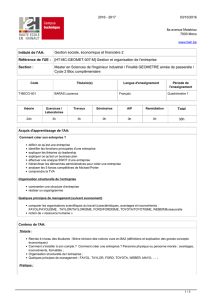Connaissez-vous vraiment Mai 68

Paroles à venir – Rencontre autour du livre Mai-Juin 68 Sous la direction de
D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti et B. Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008
1
Rencontre du 23 juin 2008 avec Frédérique Matonti Co-directrice,
avec Dominique Damamme, Boris Gobille, et Bernard Pudal du livre
Mai Juin 68, Editions de l’Atelier, Paris, 2008.
Mai Juin 68, sous la direction de Dominique Damamme, Boris Gobille, Frédérique
Matonti et Bernard Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008, 445 p. 27 €.
Les co-directeurs :
Dominique Damamme
Professeur de science politique à l’université Paris-Dauphine.
Boris Gobille
Maître de conférences en science politique à l'École normale supérieure lettres et
sciences humaines (université de Lyon), chercheur au laboratoire Triangle-CNRS.
Frédérique Matonti
Professeure de science politique à l’université Paris I-Panthéon- Sorbonne, membre du
Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS/CNRS).
Bernard Pudal
Professeur de science politique à l’université Paris X-Nanterre, chercheur au CSU («
Cultures et sociétés urbaines », UMR, 7112-CNRS/Paris VIII).
Les auteurs :
Catherine Achin, Romain Bertrand, Ivan Bruneau, Dominique Damamme, Muriel Darmon,
Brigitte Gaïti, Boris Gobille, Nicolas Hatzfeld, Eric Lagneau, Sandrine Lévêque, Cédric
Lomba, Audrey Mariette, Lilian Mathieu, Frédérique Matonti, Dominique Memmi, Bruno
Muel, Francine Muel-Dreyfus, Delphine Naudier, Érik Neveu, Olivier Neveux, Philippe
Olivera, Julie Pagis, Bernard Pudal, Jean-Noël Retière, Hervé Serry, Anne Simonin,
Isabelle Sommier, Xavier Vigna, Jean-Louis Violeau

Paroles à venir – Rencontre autour du livre Mai-Juin 68 Sous la direction de
D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti et B. Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008
2
Le livre : sa 4ème de couverture
«Connaissez-vous vraiment Mai 68 ? Quarante ans après son surgissement, l’événement
continue de faire débat : s’appuyant sur quelques poncifs, d’aucuns proclament qu’il
faudrait en " liquider l’héritage " ; certains l’accusent d’avoir provoqué un effondrement
de l’autorité ; d’autres encore font le procès d’une génération 68 convertie aux délices
du libéralisme et accaparant pouvoirs et argent aux dépens des plus jeunes. Mai 68
mérite-t-il d’être ainsi cloué au pilori ? Cet ouvrage propose de sortir des clichés pour
entrer dans la connaissance approfondie de ce qui fut l’un des grands événements du
XXe siècle. Pour la première fois à cette échelle, vingt-neuf chercheurs, historiens,
politologues, sociologues, révèlent l’ampleur du changement cristallisé par le conflit de
mai et juin 1968 en France. Ils repèrent d’abord les craquements qui l’ont précédé et
l’expliquent en partie : démocratisation de l’école, crise de l’université, des institutions
religieuses et politiques, des méthodes patronales... Ils dévoilent ensuite l’ébranlement
inédit que provoqua cette révolte multiforme : dans les rues, les usines, sur les campus,
chez les artistes, jusque dans les partis de droite... Ils analysent enfin les effets de
long terme de cet étonnant bouillonnement social, culturel et politique qui modifia
durablement les manières d’être femme, de travailler, d’enseigner, de s’engager en
politique, de faire du théâtre, de penser son corps... Que reste-t-il aujourd’hui de Mai-
Juin 68 ? Loin de l’image folklorisée du monôme étudiant, cet ouvrage met en lumière le
rôle moteur d’une aspiration toujours vive : prendre la parole et transformer sa vie hors
des limites assignées par les pouvoirs.
Le livre : Présentation de l’éditeur
Connaissez-vous vraiment Mai 68 ? En pleine polémique sur l’héritage de Mai 68, le livre-
référence qui mesure l’ampleur d’un des évènements majeurs du XXe siècle.
Enjeu des polémiques, Mai 68 est mal connu. À quelques exceptions près, et encore
toutes récentes, l’événement est bien plus objet de fantasmes qu’objet de connaissance.
Quatre décennies après l’événement, on ne comptabilise que quelques recherches
scientifiques notables. Ce déficit scientifique et la récurrence de ce « passé qui ne
passe pas » dans la vie politique imposent aujourd’hui de rouvrir à nouveaux frais le
dossier. Peu d’événements historiques pacifiques ont été l’enjeu d’une querelle des
héritages comme Mai 68. Paradoxe pour un événement qui n’a entraîné qu’un très faible
nombre de victimes, Mai 68 jouerait, depuis plus de trente-cinq ans, le rôle dévolu
pendant deux siècles à la Révolution Française (Feher) : moment célébré ou honni, la
crise de Mai aurait tout d’une histoire inachevée, comme telle sujette à controverses
incessantes, par rapport à laquelle chacun est sommé de se situer. Couronnement d’un
procès en récusation, l’élection présidentielle de 2007 a vu s’imposer un discours
sécuritaire qui ne craignait pas d’imputer à Mai 68 une responsabilité singulière, celle
d’avoir miné tous les ressorts de l’Autorité : du laxisme des enseignants hérité de Mai
68 à l’affaissement de l’autorité de l’Etat, des zones de non-droit à la démission des
parents, etc. On assiste aujourd’hui à un véritable tir de barrage médiatique et
essayiste contre Mai 68. La presse magazine s’interroge sur le fait de savoir s’il faut

Paroles à venir – Rencontre autour du livre Mai-Juin 68 Sous la direction de
D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti et B. Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008
3
« liquider Mai 68 pour penser l’école aujourd’hui » (Télérama) – au demeurant pour
conclure plutôt par la négative –, un philosophe en place publie un ouvrage sur « la fin de
l’autorité » (Alain Renaut), on republie un ouvrage de dénonciation des contestataires de
Mai (L’univers contestationnaire) – les indices abondent, dont ces exemples ne sont qu’un
échantillon. La critique de Mai 68 n’est plus l’apanage de la droite. Le présent ouvrage
porte un nouveau regard sur Mai 68 en s’appuyant sur les travaux sérieux existants, en
portant à la connaissance d’un large public les fruits de nouvelles recherches et de
nouvelles synthèses. Au lieu de plaquer sur l’évènement une grille d’analyse préétablie, ce
livre examine l’évènement 68 dans sa profondeur et l’ébranlement qu’il a généré, en
fournissant une nouvelle problématique qui parlera autant au spécialiste des sciences
sociales qu’au lecteur non spécialiste.
(source : http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1015992&contID=1014802)
En savoir plus grâce à l’audio
Ecouter les auteurs, invités de Sylvain Burmeau de l’émission «la suite dans les idées » à
France-Culture, le 22 janvier 2008 : http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/suite_idees/fiche.php?diffusion_id=59183
Deux critiques (parmi d’autres !)
Télérama n° 3033 (1er mars 2008)
Débat : Peut-on enfin écrire la vraie histoire de Mai 68 ?
Mai 68 a fait couler beaucoup d'encre. Quarante ans après, des chercheurs
offrent pourtant sur les événements un nouveau regard. Plus objectif ?
Il s'est passé quelque chose en 1968, vers mai-juin. Un peu avant aussi et beaucoup
après. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Et la chose en question doit avoir son
importance pour avoir déclenché depuis quarante ans autant d'émerveillement que de
hargne, autant d'éloges que d'indignités, fort peu de tiédeur en tout cas. Mais que
s'est-il passé au juste ? Une révolution ? Un mouvement social ? La révolte d'une
jeunesse contre les carcans autoritaires ? Une libération sexuelle ? Le triomphe de
l'individualisme ? Un changement d'air et d'ère politique ?... Tant d'interprétations, de
commentaires, d'idées générales ni vraies ni fausses, d'essais, d'albums photo, de
numéros spéciaux dans la presse (y compris à Télérama, qui publiera un hors-série en
avril) ont fait de 68 un gigantesque « événement de papier », comme dit l'historien
Philippe Artières. Mais, quarante ans plus tard, peut-être le temps de l'histoire est-il
venu, celui du recul et de l'étude.
Longtemps considéré à l'université comme un sujet sulfureux ou porté par des
chercheurs militants, Mai 68 pourrait bien trouver ses lettres de noblesse, notamment

Paroles à venir – Rencontre autour du livre Mai-Juin 68 Sous la direction de
D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti et B. Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008
4
grâce à l'ouverture des archives après le délai légal de trente ans. En effet, deux
ouvrages collectifs surnagent dans cette actualité éditoriale « spécial Mai » : du côté
des sciences sociales et politiques, Mai-Juin 68, dirigé par Dominique Damamme, Boris
Gobille, Frédérique Matonti et Bernard Pudal, aux éditions de l'Atelier ; du côté de
l'histoire, 68, Une histoire collective (1962-1981), dirigé par Philippe Artières et
Michelle Zancarini-Fournel, à La Découverte.
« Il serait stupide de disqualifier le regard des témoins, mais il est bon aussi
d'étudier Mai 68 sans avoir de comptes à régler. »
Le premier est davantage un état de la recherche ; le second, un vrai livre d'histoire
ouvert également sur les événements internationaux, les objets culturels, les portraits
d'acteurs oubliés, et construit pour un public large. Mais les deux ouvrages ont des
points communs : considérer Mai-Juin 68 dans une époque (1962-1981 pour les
historiens, 1945-1975 pour les sociologues), avoir été conçus et écrits « dans
l'intergénérations », autrement dit avec – naturelle pyramide des âges oblige – une
bonne proportion d'auteurs trop jeunes pour avoir été acteurs de 68. « Il serait stupide
de disqualifier par principe le regard des témoins et acteurs, confie Boris Gobille, 35
ans, chercheur en sciences politiques, qui travaille sur le sujet depuis quinze ans, mais il
est bon aussi de l'étudier sans avoir de comptes à régler : je n'ai ni à faire oublier que
j'ai été gauchiste, ni non plus à me rattraper sur un événement à côté duquel je serais
passé. » Même son de cloche chez Philippe Artières, né en mai 1968 : « Mai 68 m'a
donné envie d'être historien, de même que la Commune a suscité beaucoup de vocations.
L'histoire que je pratique, toutes les méthodes historiques actuelles sont issues de
cette époque. Mais les historiens qui ont vécu 68 répugnent à s'en faire une spécialité
parce qu'ils craignent de faire une histoire d'ancien combattant. J'ai été l'élève de
Michelle Perrot, à qui l'on doit les premiers travaux sur 68 [sur les ouvriers et sur la
Sorbonne, NDLR] ; elle ne m'en a jamais parlé. »
Etudier Mai 68, c'est aussi ressentir ce « manque du manque » que l'historien
Christophe Prochasson (1) repère comme caractéristique du travail historique sur
l'époque contemporaine : le trop-plein, trop de documents, trop de témoignages, trop de
mémoires où se rejouent les affrontements d'hier... Dans le cas de Mai 68, ce « trop »
est particulièrement « trop ». « Pour la guerre d'Algérie ou pour Vichy, c'était le silence
qui faisait écran, analyse Boris Gobille, pour Mai 68, c'est la logorrhée. » « Il s'agit
donc, affirme l'historienne Michelle Zancarini-Fournel, une des pionnières sur ce sujet,
de dépasser cette gangue d'interprétations générales tout en considérant que ces
lectures mémorielles font désormais partie de l'Histoire. »
Dès 1978, Serge July, oubliant la radicalité de ses engagements maoïstes, avance
le mot de « libéral-libertaire ».
Les « lectures mémorielles » en question sont surtout celles, construites par certains
des acteurs eux-mêmes dès les années 70, qui consistent à ne voir dans Mai 68 que le
prurit révolutionnaire d'une jeunesse plutôt dorée contre ses pères, ou la révolte des
Trente Glorieuses contre la société bloquée d'un gaullisme finissant ; bref, un grand
vent d'irrespect joyeux d'individus jouisseurs. Dès 1978, Serge July, oubliant la

Paroles à venir – Rencontre autour du livre Mai-Juin 68 Sous la direction de
D. Damamme, B. Gobille, F. Matonti et B. Pudal, Editions de l’Atelier, Paris, 2008
5
radicalité de ses engagements maoïstes, avance le mot de « libéral-libertaire » dans une
interview donnée à la revue Esprit. Le mot fera florès. En 1987, sort au Seuil la
première histoire de 68, Génération, d'Hervé Hamon et Patrick Rotman. On reprochera
à cette grande fresque, palpitante, passionnante, d'avoir phagocyté l'événement en le
concentrant sur les témoignages d'une poignée d'intellos parisiens sachant exercer le
ministère de la parole et occupant depuis des positions visibles dans les médias,
l'édition, la vie intellectuelle, l'université, les partis politiques. « Génération », encore un
mot qui fera florès. Rotman ne le renie pas aujourd'hui : « En mai 68, une génération,
celle des baby-boomeurs, a pris conscience d'elle-même en rencontrant un événement
fondateur. Si Mai 68 hante encore, c'est parce qu'il a été un de ces moments de
transcendance, de croyance collective où toute une société éprouve l'espoir de vivre
autrement. »
« Nous sommes encore dans un vide bibliographique. Le trop-plein des essais et
témoignages cache paradoxalement ce vide. »
De leur côté, les historiens travaillaient. Dès le 4 août 1989 était ouvert, à l'initiative
de quelques-uns, dont Michelle Zancarini-Fournel, le fonds d'archives privées Mémoires
de 68, qui donnera lieu à un Guide des sources d'une histoire à faire (2), établi en 1993,
avant le premier grand colloque universitaire sur 68 qui se tient en 1994 (3). Tout ce
travail de collecte a permis de mettre au jour des centaines de lieux, de collectifs,
d'associations, d'ateliers, qui furent des chantiers d'expérimentation ou de luttes
sociales un peu partout en France.
« Le Mai ouvrier n'a pas eu de lendemains mémoriels, remarque Bernard Pudal.
Contrairement au Front populaire ou à la Commune. On peut y voir la domination d'une
parole par celle, plus audible, des étudiants. Mais l'attitude des syndicats y est pour
beaucoup. La CGT a tout fait pour refuser l'alliance entre étudiants et ouvriers. Et
même s'ils ont été débordés par leur base, notamment au moment des accords de
Grenelle, les leaders syndicaux demeuraient les interlocuteurs du pouvoir. Résultat :
nous sommes encore, sur 68, dans un vide bibliographique. Le trop-plein des essais et
témoignages cache paradoxalement ce vide. » Dès lors, l'enjeu de ce quarantenaire
pourrait bien être la restauration de cette histoire sociale, provinciale, paysanne,
ouvrière.
Tous s'accordent à dire que Mai 68 s'est achevé entre 1975 et 1980.
L'étude du passé n'échappe pas à la politique du présent, Mai 68 reste un événement
complexe et fortement symbolique dont on ne finit pas, comme la Révolution française,
de se disputer l'héritage. Tous s'accordent à dire que Mai 68 s'est achevé entre 1975
et 1980 : choc pétrolier, début du chômage de masse, publication de L'Archipel du
Goulag, de Soljenitsyne, qui met à mal toute défense du communisme, mort de Sartre
(1980), élection de Mitterrand en 1981 avec le slogan soixante-huitard « Changer la vie
». Alors, que s'est-il passé en 68 qui vaille encore qu'on lui règle son compte ? Les
auteurs de ces deux livres se gardent de conclure. Sauf à remarquer, comme Boris
Gobille et Bernard Pudal, que « toute crise, guerre ou révolution fait bouger les lignes
parce que des gens qui n'étaient pas destinés à se rencontrer se parlent. En 68, les
 6
6
1
/
6
100%