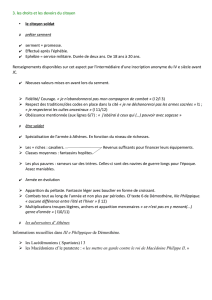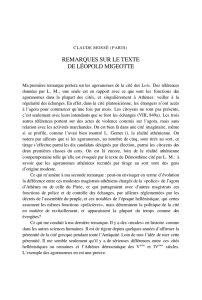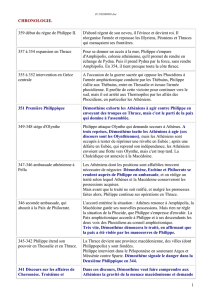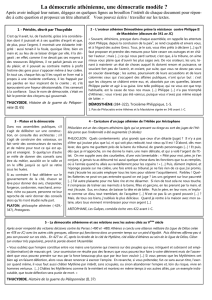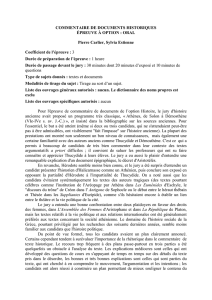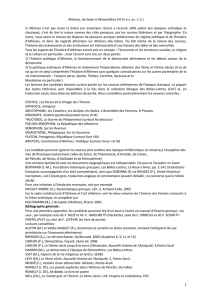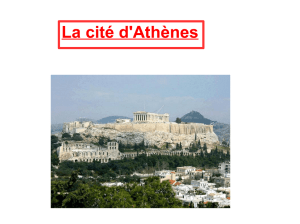T17 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DE LA GRÈCE
depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin de la génération
contemporaine d’Alexandre Le Grand
George Grote
traduction d’Alfred Sadous
DIX-SEPTIÈME VOLUME

CHAPITRE I — GRÈCE CENTRALE : DEPUIS L’AVÈNEMENT DE
PHILIPPE DE MACÉDOINE JUSQU’À LA NAISSANCE D’ALEXANDRE
(359-356 AV. J.-C.).
Dans les derniers chapitres qui précédent, j’ai suivi l’histoire des Grecs siciliens
pendant de longues années de despotisme, de souffrances et d’appauvrissement,
jusqu’à elle époque de liberté renouvelée et de bonheur relatif, accomplie sous
les auspices bienfaisants de Timoleôn, entre 344 et 336 avant J.-C. Il convient
actuellement de reprendre le fil des événements dans la Grèce centrale, au point
où je les ai laissés à la fin du troisième chapitre du quinzième volume,— c’est-à-
dire à l’avènement de Philippe de Macédoine, en, 360-359 avant J.-C. La mort de
Philippe arriva en 336 avant J.-C., et les années qui précédèrent sa mort nous
mettront sorts les yeux les dernières luttes de la liberté hellénique complète,
résultat qui forme un pénible contraste avec les exploits du libérateur
contemporain Timoleôn en Sicile.
De pareilles luttes n’auraient pas pu paraître dans les limites du possible, même
au politique doué de la plus longue vue, soit de Grèce, soit de Macédoine, — au
moment où Philippe monta sur le trône. Au milieu des espérances et des craintes
de la plupart des cités grecques, la Macédoine passait alors totalement inaperçue
: pour Athènes, Olynthos, Thasos, la Thessalia et quelques autres lieux, elle était
un point non sans importance, mais qui toutefois n’était pas d’une grandeur de
premier ordre.
Le monde hellénique était à ce moment (360-359 av. J.-C.) dans un état différent de
tout ce qu’on avait vu depuis l’échec de Xerxès, en 480-479 avant J.-C. La
défaite et. la dégradation de Sparte avaient délivré les États de l’intérieur des
terres du seul État président qu’ils avaient jamais appris à considérer. Son
ascendant souverain, qu’elle avait possédé longtemps et dont elle avait fait un
grave abus, avait été abattu par les succès d’Epaminondas et des Thêbains. Elle
n’était plus le chef d’un corps nombreux d’alliés subordonnés, envoyant des
députés à ses assemblées périodiques, — soumettant à son influence leur
politique étrangère, — plaçant leurs contingents militaires sous le
commandement de ses officiers (xenagi), — et même administrant leur
gouvernement intérieur au moyen d’oligarchies dévouées à ses desseins, avec le
renfort, partout où il était nécessaire, d’un harmoste et d’une garnison
spartiates. Elle ne trouvait plus sur sa frontière septentrionale une quantité de
villages arkadiens détachés, régis chacun par des chefs dévoués à ses intérêts et
lui fournissant de hardis soldats, et elle n’avait plus la cité amie de Tegea, liée à
elle par une oligarchie philo-laconienne et par une tradition d’ancienne date. Par
suite de la grande révolution qui s’opéra dans les sentiments après la défaite des
Spartiates à Leuktra, les petites communautés arkadiennes, encouragées et
guidées par Epaminondas, s’étaient concentrées dans la grande cité fortifiée de
Megalopolis, actuellement centre d’une confédération panarkadienne, avec une
assemblée (appelée les Dix Mille) qui s’y réunissait fréquemment pour décider
des questions d’intérêt et de politique communes aux diverses sections du nom
arkadien. Tegea aussi avait subi une révolution politique, de sorte que les deux
cités, contiguës l’une avec l’autre et formant ensemble la frontière septentrionale
de Sparte, transformèrent ses voisins arkadiens, de précieux instruments qu’ils
étaient, en de formidables ennemis.

Mais cette perte de forces auxiliaires étrangères et clé dignité n’était pas ce que
Sparte avait souffert de pire. Sur sa frontière nord-ouest (contiguë aussi avec
Megalopolis) se trouvait la cité nouvellement établie de Messênê, représentant près
d’une moitié du territoire et de l’avoir de Sparte, qui lui était enlevée. La moitié
occidentale et la plus fertile de la Laconie avait été séparée d’elle et était répartie
entre Messênê et diverses, autres cités indépendantes : elle était labourée
surtout par ceux qui avaient été jadis periœki et ilotes de Sparte.
Dans la phase de l’histoire grecque où nous somme maintenant sur le point
d’entrer, — alors que le monde hellénique collectif, pour la première fois depuis
l’invasion de Xerxès, était près d’être forcé de se défendre contre un ennemi
étranger venant de Macédoine, — ce changement opéré dans la position de
Sparte était une circonstance d’une grave importance. Non seulement les
Péloponnésiens étaient désunis et privés de leur chef commun, mais encore
Messênê et Megalopolis, connaissant l’hostilité intense de Sparte contre elles —
et sa grande supériorité de force, même réduite comme elle l’était, à tout ce
qu’ils pouvaient réunir, — vivaient dans une crainte perpétuelle de, son attaque.
Leurs voisins les Argiens, ennemis permanents de Sparte, étaient bien disposés à
les protéger ; mais une pareille aide était insuffisante pour leur défense, sans
alliance en dehors du Péloponnèse. En conséquence, nous les :errons pencher
vers l’appui soit de Thèbes, soit d’Athènes, quel que fût celui qu’elles pouvaient
avoir, et finalement même bien accueillir les armes de Philippe de Macédoine,
comme celles d’un protecteur contre l’hostilité acharnée dé, Sparte, Elis ; —
placée par rapport à la Triphylia clans la même position que Sparte par rapport à
Messênê, — se plaignait que les Triphyliens, qu’elle regardait comme des sujets,
eussent été admis en qualité de citoyens dans la fédération arkadienne. Nous
verrons Sparte s’efforcer d’engager Élis dans des combinaisons politiques
destinées à assurer à l’une et à l’autre le recouvrement de leur ancienne
domination1. Il sera parlé plus longuement ci-après de ces combinaisons ; à
présent, je me borne à mentionner le fait général que la dégradation de Sparte,
combinée avec sa menace perpétuelle d’agression contre Messênê et l’Arkadia,
désorganisa le Péloponnèse et lui enleva ses moyens de défense panhellénique
contre le nouvel ennemi étranger qui s’élevait alors lentement.
Le système péloponnésien jadis puissant fut de fait complètement brisé (360-359
av. J.-C.). Corinthe, Sikyôn, Phlionte, Trœzen et Epidauros, importantes comme
États secondaires et comme alliées de Sparte, furent alors détachées de toute
combinaison politique, et ne visèrent qu’à se garantir, chacune pour son compte,
de toute part à une collision entre Sparte et Thèbes2. Il paraîtrait aussi que
Corinthe avait été récemment opprimée et troublée par le despotisme temporaire
de Timophanês, décrit dans mon dernier chapitre, bien que la date de cet
événement ne puisse être établie d’une manière précise.
Mais les forces principales et prépondérantes de la Hellas résidaient
actuellement, pour la première fois dans notre histoire, en dehors du
Péloponnèse et non dans ses limites, à Athènes et à Thèbes. Ces deux cités
étaient dans la plénitude de la vigueur et de la puissance. Athènes avait une
flotte nombreuse, un commerce florissant, un corps considérable d’alliés
maritimes et insulaires, qui envoyaient des députés à son congrès et
contribuaient à un fonds- commun pour le maintien de la sécurité commune. Elle
1 Démosthène, Orat. pro Megalopolit., p. 203, 204, s. 6-10 ; p. 206, s. 18, — et dans de fait tout
le Discours, qui est un exposé instructif de politique.
2 Xénophon, Hellenica, VII, 4, 6, 10.

était de beaucoup la plus grande puissance maritime en. Grèce. J’ai raconté
ailleurs comment son général Timotheos avait acquis pour elle l’importante île de
Samos, en même temps que Pydna, Methônê et Potidæa, dans le golfe
Thermaïque ; comment il échoua (comme Iphikratês avait échoué avant lui) dans plus
d’une tentative sur Amphipolis ; comment il fit une conquête et établit des colons
athéniens dans la Chersonèse de Thrace, territoire qui, après avoir été attaqué et
mis en danger par le prince thrace Kotys fut regagné par les efforts continus
d’Athènes, dans l’année 358 avant. J.-C. Athènes n’avait pas subi de pertes
considérables pendant les luttes qui aboutirent à la pacification après la bataille
de Mantineia, et sa condition parait en général avoir été meilleure qu’elle ne
l’avait jamais été depuis ses désastres, subis à la fin de la guerre du
Péloponnèse.
La puissance de Thêbes également était imposante et formidable. Elle avait, il est
vrai, perdu beaucoup de ces alliés péloponnésiens qui formaient le déploiement
de forces écrasant d’Épaminondas, quand il envahit la Laconie pour la première
fois, en profitant du nouveau mouvement anti-spartiate qui suivit
immédiatement la bataille de Leuktra. Elle ne conservait qu°Argos, avec Tegea,
Megalopolis et Messênê. Ces trois dernières cités ajoutaient peu à sa force et
avaient besoin qu’elle leur prêtât un appui :-vigilant, prix qu’Épaminondas avait
été parfaitement disposé à payer pour l’établissement d’une forte frontière contre
Sparte. Mais le corps des alliés en dehors du Péloponnèse groupés autour de
Thèbes était encore considérable1 ; c’étaient les Phokiens et les Lokriens, les
Maliens, les Hêrakléotes, la plupart des Thessaliens et la plupart (sinon tous) des
habitants de l’Eubœa, peut-être aussi les Akarnaniens, les Phokiens étaient, dans
le fait, des alliés hésitants ; disposés — à circonscrire leurs obligations dans lès
limites les plus, étroites d’une défense mutuelle en cas .d’invasion, et nous
verrons bientôt les relations entre les deux États devenir positivement hostiles.
Outre ces alliés, les Thêbains possédaient l’importante position d’Orôpos, sur la
frontière nord-est de l’Attique, ville qui avait été enlevée à Athènes six années
auparavant, à la profonde mortification des Athéniens.
Mais, outre des alliés en dehors de la Bœôtia, Thêbes avait prodigieusement
accru la puissance de sa cité dans l’intérieur de cette contrée. Elle s’était
approprié les territoires de Platée et de Thespiæ sur sa frontière méridionale, et
ceux de Korôneia et d’Orchomenos près de sa frontière septentrionale, par
conquête et par une expulsion partielle de leurs anciens habitants. Comment et
quand ces acquisitions avaient-elles été effectuées, c’est ce qui a été expliqué
déjà2 ; ici je me borne à rappeler le fait pour apprécier la position de Thèbes en
359 avant J.-C., — à savoir que ces quatre villes, ayant été autonomes en 372
avant J.-C., — unies à elle seulement par les obligations définies de la
confédération bœôtienne, — et en partie même en hostilité réelle contre elle, —
avaient actuellement perdu leur autonomie avec leurs citoyens libres, et avaient
fini par être absorbées dans son domaine et sa souveraineté. Ce domaine de
1 Xénophon, Hellenica, VI, 5, 23 ; VII, 5, 4. Diodore, XV, 62. Les Akarnaniens avaient été alliés de
Thêbes à l’époque de la première expédition d’Épaminondas dans le Péloponnèse ; l’étaient-ils
encore au moment de sa dernière expédition, c’est ce qui n’est pas certain. Mais comme
l’ascendant de Thêbes sur la Thessalia était beaucoup plus grand à la dernière de ces deux époques
qu’à la première, nous pouvons être surs qu’elle n’avait pas perdu son empire sur les Lokriens et
les Maliens, qui (aussi bien que les Phokiens) étaient entre la Bœôtia et la Thessalia.
2 Voir tome XIV, ch. 4 et tome XV, ch. 1-3 de cette Histoire.

Thèbes s’étendait ainsi à travers la Bœôtia depuis les frontières de la Phokis1 au
nord-ouest jusqu’à celles de l’Attique au sud.
La nouvelle position acquise ainsi par Thèbes en Bœôtia, et achetée au prix de
l’anéantissement de trois ou de quatre cités autonomes, est un fait d’une grande
importance par rapport à la période qui nous occupe maintenant, non seulement
parce qu’elle agrandit et enfla la puissance des Thêbains eux-mêmes, mais
encore parce qu’elle suscita partout contre eux dans l’esprit hellénique un
sentiment fortement défavorable. Précisément dans le temps où les Spartiate
avaient perdu presque une moitié de la Laconie, les Thêbains avaient annexé à
leur propre cité un tiers du territoire bœôtien libre. La remise en vigueur du droit
de cité messênien libre, après une existence suspendue de plus de deux siècles,
avait récemment été accueillie avec une satisfaction universelle. Combien dut
être choqué ce même sentiment, quand Thèbes anéantit, pour son propre
agrandissement, quatre communautés autonomes, toutes de sa parenté
bœôtienne, l’une de ces communautés encore étant Orchomenos, respectée tant
à cause de son antiquité que de ses légendes traditionnelles ! On ne s’occupa
guère de discuter les circonstances du cas, et de rechercher si Thêbes avait
excédé la mesure de rigueur autorisée par le code de la guerre à l’époque. Dans
les conceptions nationales et patriotiques de tout Grec, la Hellas consistait en un
agrégat de communautés municipales, autonomes et fraternelles.
L’anéantissement de l’une d’elles ressemblait à l’amputation d’un membre faite à
un corps organisé. Une répugnance à l’égard de Thèbes, que fit naître cette
conduite, affecta fortement l’opinion publique du temps, et se manifesta surtout
dans le langage des orateurs athéniens, exagérée par la mortification que leur
causait la perte l’Orôpos2.
Le grand corps des Thessaliens, aussi, bien que les Magnêtes et les Achæens
Phthiotes, était au nombre de ceux qui obéissaient à l’ascendant de Thêbes.
Même le puissant et cruel despote, Alexandre de Pheræ, était compté dans ce
catalogue3. Les cités de la fertile Thessalia, possédées par de puissantes
oligarchies avec de nombreux serfs dépendants, étaient généralement en proie à
des luttes intestines et à une rivalité municipale ; le désordre y régnait aussi bien
que l’absence de foi4. Les Aleuadæ, chefs à Larissa, — et les Skopadæ à
Krannôn, — avaient été jadis les familles dominantes du pays. Mais dans les
mains de Lykophrôn et de l’énergique Jasôn, Pheræ avait été élevée au premier
rang. Toutes les forces de la Thessalia étaient réunies sous Jasôn comme tagos
(général fédéral), avec une quantité considérable de tributaires circonvoisins,
Macédoniens, Épirotes, Dolopes, etc., et en outre une armée permanente de
volontaires bien organisée. Il pouvait rassembler huit mille chevaux, vingt, mille
1 Orchomenos était contiguë avec le territoire phokien (Pausanias, IX, 39, 1).
2 ) Isocrate, Or. VIII, De Pace, s. 21 ; Démosthène, adv. Leptinem, p. 490, s. 121 ; pro
Megalopol., p. 208, s. 29 ; Philippiques, II, p. 69, s. 15.
3 Xénophon, Hellenica, VII, 51 4 ; Plutarque, Pélopidas, c. 35. Waschsmuth affirme, à mon sens,
d’une manière erronée, que Thêbes fut désappointée dans la tentative qu’elle fit pour établir son
ascendant en Thessalia (Hellenisch. Alterthümer, vol. II, X, p. 328).
4 Platon, Kritôn, p. 53 D ; Xénophon, Mémorables, I, 2, 24 ; Démosthène, Olynthiennes, I, p. 15,
s. 23 ; Démosthène, Cont. Aristokratês, p. 658, s. 133.
Pergit ire (le consul romain Quinctius Flamininus) in Thessaliam : ubi non liberandæ modo civitates
erant, sed ex omni colluvion et confusione in aliquam tolerabilem formam redigendæ. Nec enim
temporum modo vibis, ac violentiâ et licentiâ regiâ (i. e. les Macédoniens) turbati erant ; sed
inquieto etiam ingenio gentis, nec comitia, nec conventum, nec consilium ullum, non per
seditionem et tumultum, jam inde a principio ad nostram usque etatem, tradticentis (Tite-Live,
XXXIV, 51).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
1
/
210
100%