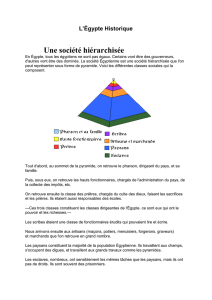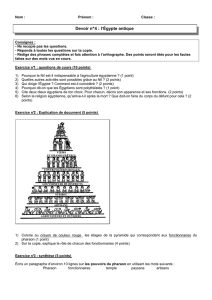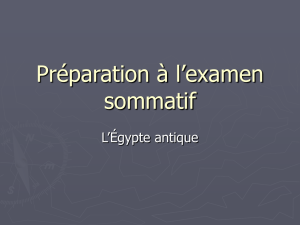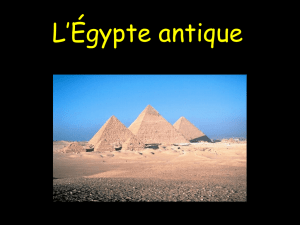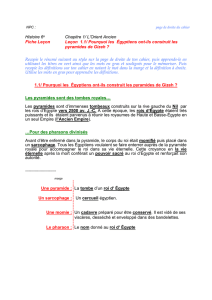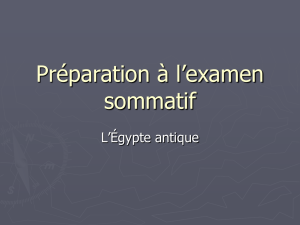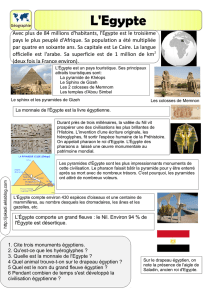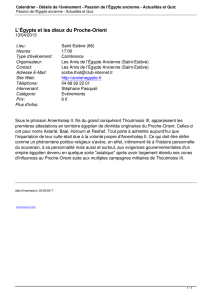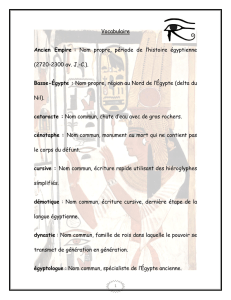Patronat colonial, entrepreneurs étrangers et égyptien

Les réseaux d’affaires en Égypte : patronat européen, minorités locales et
notables égyptiens dans la réforme et l’industrialisation du pays durant
l’entre-deux-guerres.
Caroline Piquet, ATER à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV)
L’Égypte de l’entre-deux-guerres offre un cas original pour l’étude du patronat
européen outre-mer, puisque celui-ci y fonctionne en réseau avec les minorités
étrangères locales et les notables égyptiens. La pénétration des capitaux étrangers
dans le pays s’effectue dès la seconde moitié du XIXe siècle. L’occupation anglaise en
1882 ne verrouille pas le marché égyptien, qui demeure le lieu d’une concurrence
entre capitaux étrangers : jusqu’en 1956, les capitaux français sont plus importants
que ceux des Britanniques
1
. En 1922, le pays est déclaré souverain et s’engage dans
une période de construction nationale. Alors que l’administration coloniale anglaise
contrôle l’appareil d’État, les acteurs privés se penchent sur la réforme industrielle et
sociale du pays. Le patronat européen comprend alors qu’il convient d’assurer ses
réseaux au sein de la société égyptienne afin de maintenir ses positions.
L’étude des réseaux réunissant le patronat européen et les élites économiques
d’Égypte représente un vaste terrain de recherche, ouvert par les études fondatrices
de David Landes
2
, Robert Tignor
3
et Samir Saul
4
. Néanmoins, bien des aspects
demeurent encore méconnus : pour mener à bien un tel projet, il conviendrait de se
livrer à une prosopographie des patronats européens dans le pays, puis à celle des
bourgeoises locales et égyptiennes, pour proposer ensuite une étude des réseaux.
Récemment, une initiative de l’université américaine du Caire vise à développer des
études de cas d’entreprises étrangères et égyptiennes, dans une perspective nouvelle
adoptant les méthodes de la Business History
5
. Le présent chapitre se veut bien
moins ambitieux ; il propose d’étudier les réseaux qui se forment entre le patronat
européen et les acteurs locaux à travers deux associations spécialisées sur la réforme
et l’industrialisation du pays : la Société Sultanieh d’économie politique, de
statistiques et de législation et la Fédération des industries égyptiennes. Ces
associations permettent de présenter les enjeux et les limites de la collaboration entre
les Européens et les Égyptiens. Ces deux groupes partagent, certes, un projet
commun : sortir le pays de son arriération économique et le faire entrer dans la
marche des pays développés ; néanmoins, leurs intérêts sont divergents : conserver
les privilèges pour les uns, conquérir le marché égyptien pour les autres. Le
capitalisme colonial peut-il accepter l’émergence d’un capitalisme national ? Ce
dernier peut-il accepter les chasses gardées et les privilèges octroyés aux étrangers ?
Pour présenter le débat, nous reviendrons sur les acteurs de la réforme, pour évoquer
ensuite leur participation aux deux associations mentionnées ci-dessus. Enfin, on
1
Samir Saul, La France et l’Égypte de 1882 à 1914. Intérêts économiques et implications
politiques, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1997, page
XV.
2
David Landes, David, Banquiers et pachas. Finance internationale et impérialisme
économique en Égypten, Paris, Albin Michel, 1993.
3
Robert Tignor, State, Private enterprise and Economic Change in Egypt, 1918-1952,
Princeton, Princeton University Press, 1984.
4
S. Saul, op.cit.
5
Economic and Business History Research Centre Chronicles, October 2005, volume1/issue
2.

2
2
s’attachera à l’affaiblissement du patronat européen face à la montée du
nationalisme.
1. Les hommes de la Réforme : les patronats européens et les élites
économiques locales
Dès le XIXe siècle, les khédives égyptiens ont souhaité associer les Européens à la
rénovation et à la modernisation du pays, en réclamant l’aide des scientifiques
occidentaux et l’apport technique et financier des entreprises étrangères. Dans le
domaine économique, trois catégories d’acteurs apparaissent alors : le patronat
européen, les minorités étrangères locales et les grands propriétaires terriens
égyptiens.
A. Le patronat européen en Égypte : de la distance à l’arrimage au pays
L’Égypte au XIXe siècle constitue une colonie de capitaux où les étrangers s’illustrent
dans le crédit hypothécaire, la commercialisation du coton et les sociétés
concessionnaires
6
. Les trois types de patronats européens les plus représentés sont le
patronat britannique, français et belge. Ces investisseurs dominent en particulier le
secteur des banques, avec entre autres la National Bank et la Land Bank en ce qui
concerne les capitaux britanniques, le Crédit foncier égyptien, les agences des
banques métropolitaines de la Société générale et du Crédit lyonnais pour les
capitaux français. L’autre grand domaine d’investissement de ce patronat concerne
les concessions d’équipement public. Ces sociétés sont constituées de capitaux
étrangers et conservent une direction européenne, bien que relevant le plus souvent
de la juridiction égyptienne. On compte parmi les plus fameuses de ces entreprises la
Compagnie du canal de Suez, la Compagnie des eaux d’Alexandrie et du Caire, la
Compagnie des tramways d’Alexandrie, la Cairo Electric Company, la Compagnie
Oasis d’Héliopolis du Baron Empain ou encore la Compagnie de gaz et d’électricité
Lebon. Toutefois, le patronat européen n’est pas uniforme : les Britanniques sont
attachés à une Égypte agraire et se montrent hostiles aux entreprises locales, alors
que les Français, les Belges, les Allemands et les Italiens y voient des opportunités
pour leurs financiers
7
. De plus, il convient de souligner la position particulière du
patronat français : outre l’importance des capitaux investis dans le pays, celui-ci se
distingue par un discours de civilisation : l’évocation de la France des Lumières se
présente volontiers comme un contrepoids à l’occupant anglais
8
.
Néanmoins, ce n’est pas tant la nationalité de ces entreprises et de leurs capitaux qui
en font des modèles coloniaux que leur organisation et leur fonctionnement. Et
l’exemple- type de l’entreprise coloniale en Égypte demeure un bastion du patronat
français : la Compagnie du canal de Suez. Les dirigeants de la Compagnie
entretiennent des liens très serrés avec les milieux d’affaires coloniaux. Le prince
d’Arenberg, Charles Jonnart, Jules et François Charles-Roux, présidents et vice-
6
Jacques Berque, Égypte. Impérialisme et révolution, Paris, Gallimard, 1967, pp. 171-193.
7
Robert Tignor, State, Private enterprise and Economic Change in Egypt, op.cit, p. 19.
8
François Charles-Roux, « Le capital français en Égypte », in L’Égypte contemporaine, 1911,
pp. 465-502. Égypte-France, exposition française au Caire, 1929. L. de Vincenot, « Les
capitaux étrangers en Égypte » in Le Temps, numéro spécial Égypte, 28 342 bis.

3
3
président de la Compagnie, incarnent des figures célèbres du « parti colonial »
9
. De
plus, les réseaux d’affaires de Suez se situe tout entier hors d’Égypte et repose sur le
patronat métropolitain : dans son conseil d’administration se distinguent les
industriels du Nord avec un représentant de l’industrie textile, Eugène Motte, et deux
maîtres de forges, Armand Viellard-Migeons et Humbert de Wendel, les
représentants du patronat lyonnais avec l’industriel Auguste Issac et le banquier
Cambefort, le patronat marseillais avec le négociant Marcel Rouffio, l’industriel Émile
Darier et les Charles-Roux, père et fils
10
. Enfin, parmi les administrateurs aux
carrières politiques, on note le poids des anciens fonctionnaires coloniaux : Gaston
Doumergue, André Lebon, Marcel Olivier, les frères Paul et Jules Cambon, Ernest
Roume.
Cependant, le cas de Suez est assez exceptionnel dans le pays : beaucoup
d’entreprises étrangères présentent un profil bien plus intégré et fonctionnent avec
des réseaux locaux. C’est le cas notamment de la société fondée par le baron Empain
en 1906, la Heliopolis Oases Company : destinée à créer un faubourg au nord du
Caire, cette entreprise met en place un vaste projet immobilier assorti de
l’équipement d’un chemin de fer pour assurer la liaison avec la capitale. Héliopolis
demeure une oeuvre majeure du patronat colonial belge, financée pour l’essentiel par
le grand capitalisme wallon
11
. Malgré un financement européen et une direction
européenne à cheval entre Paris et Bruxelles, l’entreprise s’ouvre à la société locale
assez tôt, pour des raisons d’efficacité ; Empain se concilie les intérêts locaux, ce qui
lui permet de signer l’achat de terrain et une concession pour le chemin de fer avec
Boghos Nubar, fils d’un ancien Premier Ministre avec lequel il avait déjà noué des
contacts pour le tramway du Caire. Empain utilise aussi les services de Georges Eid,
sujet belge né en Syrie et devenu représentant commercial des Belges au Caire ;
d’autre part, la société a recours à des intermédiaires locaux comme l’ingénieur
Ayrout et les maisons de maçonnerie locales
12
.
De même, le Crédit foncier d’Égypte offre un exemple de patronat européen bien
intégré dans les affaires du pays. Premier établissement financier et seconde plus
grande entreprise d’Égypte à la veille de la Première Guerre mondiale après Suez, il
illustre le dynamisme des capitaux français dans le pays. Joseph Caillaux en 1911 est
nommé président de conseil d’administration, puis après la guerre, Émile Miriel
impose sa personnalité dans l’établissement comme administrateur-délégué. Ancien
inspecteur des finances, cet homme a été choisi pour défendre les intérêts français en
Égypte. Durant l’entre-deux-guerres, les membres du conseil d’administration du CFE
soulignent les liens très ténus avec les réseaux bancaires parisiens, avec notamment
la présence de l’ancien président du Crédit lyonnais, le Baron Brincard. Toutefois si
les réseaux financiers du CFE se situent en France, cet établissement est l’un des
premiers dans les années 1880 à réorganiser son fonctionnement, pour mettre
l’accent sur une meilleure intégration au marché égyptien. À cette époque, bon
nombre de sociétés étrangères qui n’avaient leurs réseaux qu’en Europe s’avérèrent
9
Charles-Robert Ageron, « Le parti colonial », in Les collections de l’Histoire, n°11, avril
2001, pp. 28-33.
10
Archives de la Compagnie du canal de Suez (ACUCMS), bulletins des assemblées générales,
1995060 024-025.
11
Robert Ilbert, Héliopolis, Le Caire 1905-1922, genèse d’une ville, Paris, Éditions du CNRS,
1981, p. 15.
12
Ibidem, pp. 30 et 81.

4
4
incapables de s’adapter aux réalités du marché égyptien ; faute de relais locaux, la
plupart d’entre elles disparaissent pour laisser place à de nouvelles formes
d’entreprises qui implantent leur siège en Égypte
13
. Le CFE installe alors une partie de
sa direction au Caire et intègre à son organisation des banquiers et des
entrepreneurs locaux issus des communautés juive, grecque et levantine, le plus
célèbre étant le banquier Suarès.
Toutefois, malgré les efforts réalisés pour mieux s’insérer dans le maillage
économique et social de l’Égypte, le patronat européen demeure un patronat colonial.
Ces investisseurs conservent en effet des liens très serrés avec les milieux coloniaux
de leur pays et s’appuient sur l’administration britannique pour garantir leurs
intérêts financiers. Ils profitent, en outre, des avantages fiscaux offerts par le régime
des capitulations. Enfin, les Égyptiens qui parviennent à siéger dans les conseil
d’administration des firmes étrangères sont marginaux, une douzaine
14
environ en
1923. Ces sociétés préfèrent la collaboration avec les minorités locales juives ou
chrétiennes.
B. Les minorités locales : un rôle d’intermédiaire entre le patronat
européen et la société égyptienne
Par minorités locales, on désigne les membres des communautés juive, levantine,
grecque, italienne ou arménienne établies en Égypte depuis des générations.
Beaucoup se sont installées sous le règne de Mohamed Ali en se spécialisant dans les
métiers de l’import-export. Leur intégration au marché égyptien se poursuit sous les
règnes de Saïd et d’Ismaïl, avec les sociétés de coton et les établissements de crédit.
Ces communautés s’illustrent également dans l’industrie textile et agroalimentaire ;
beaucoup d’entreprises sont créées après le boum financier des années 1899-1907,
dans le domaine du sucre, du coton, du tabac, de la bière, du ciment et du sel. Se
forme alors un groupe de banquiers et de marchands d’origines juives, grecques ou
italiennes dont les noms les plus célèbres sont les Menasce, Suarès, Cattaui, Rollo,
Mosseri, Zervudachi, Salvago
15
. Ces communautés se concentrent dans les grandes
villes, Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd et Ismaïlia, surtout à partir des années 1920,
sous l’impact du nationalisme et l’ascension des marchants égyptiens dans les
campagnes et les villes moyennes
16
.
Quelques familles ont laissé des monographies de leur entreprise : c’est le cas des
Zerbini ; ces derniers, originaires de Mytilène, s’installent en Égypte au XIXe siècle et
créent en 1894 une entreprise d’égrenage du coton, The Kaft-el-zayat cotton, qui
prospère
17
jusqu’en 1956. Son conseil d’administration regroupe pour l’essentiel des
Grecs, des juifs et des Syro-Libanais ; on peut citer notamment la présence de René
Cattaui : la famille Cattaui, célèbre famille de banquiers juifs égyptiens, s’illustre
13
Dans les années 1880, seules trois grandes sociétés françaises ayant conservé une direction
en métropole sont encore présentes dans le pays : Suez, Les Monts de Piété et la Banque
franco-égyptienne ; en 1956, elles ne sont plus que eux, les Monts de Piété et Suez. Samir
Saul, La France et l’Égypte, op.cit, p. 31.
14
Robert Tignor, State, Private enterprise and Economic Change in Egypt, op.cit, p. 19.
15
Marius Debb, “The socio-economic role of the local minorities in modern Egypt, 1805-
1961”, in International journal of Middle East Studies, vol.9, 1978, pp. 11-22.
16
Ibidem, p. 18.
17
J. Dimitri Zerbini, Histoire d’une entreprise industrielle : the kafr –el-Zayat cotton Co.,
SAE, 1894-1956, Alexandrie, Société de publications égyptiennes, 1956.

5
5
aussi dans le domaine des sucreries, en dirigeant une des plus grandes concessions
sucrières du pays, la concession de Kom Ombo située en Haute-Égypte. Cette
entreprise, comme la plupart des entreprises sucrières, présente une collaboration
entre agents locaux et banquiers parisiens
18
. Un autre domaine d’épanouissement des
communautés étrangères est le petit commerce : la maison Papazian fournit un bel
exemple : créée par des Arméniens originaires d’Alexandrette, cet établissement est
tenu par des commerçants - horlogers du Caire, installés en 1903 et toujours en
activité
19
. À Port-Saïd, les commerces grecs et italiens colonisent des rues entières
20
;
le plus connu d’entre eux, le Simon Arzt, est créé à la fin du XIXe siècle par des juifs
autrichiens installés en Égypte. Grand magasin situé directement sur la jetée du canal
de Suez, il constitue un énorme de dépôt des marchandises venues d’Orient et
d’Occident. À Alexandrie, les Grecs dominent le commerce des spiritueux et les
industries de cigarettes, quant les Italiens se distinguent dans les métiers du bâtiment
et de l’artisanat
21
.
Cette bourgeoisie locale s’impose comme un élément indispensable à la structure
économique du pays. Bien intégrés, installés depuis des générations en Égypte, les
membres de ces communautés sont pourtant qualifiés d’intrus par le mouvement
national qui les accuse de profiter des richesses de l’Égypte en parasite
22
. Ils sont
considérés comme étrangers car beaucoup relèvent d’une protection européenne.
Dans les années vingt, alors que la loi définit la nationalité égyptienne, très peu font
le choix de la demander et préfèrent conserver une protection étrangère dans le cadre
des capitulations
23
. Or, ce système représente pour les notables égyptiens un régime
de privilèges injuste et préjudiciable à leur propre développement.
C. L’affirmation des acteurs économiques égyptiens
Au début du XXe siècle, les notables et entrepreneurs égyptiens s’affirment comme
une force économique et sociale autochtone par opposition aux minorités étrangères
et au patronat européen. Ce groupe acquiert une dimension éminemment politique,
dans un moment de cristallisation du mouvement national. Toutefois, ces élites
forment un groupe hétérogène. Au XIXe siècle, les grands propriétaires terriens
18
Ces sociétés constituent un domaine prisé des capitaux français mais elles conversent leur
propre logique et une direction locale. Samir Saul, La France et l’Égypte, op.cit, p. 375.
19
“Maison Papazian”, Revue Economic and Business History Research Centre, n°1, October
2005, pp. 10-12.
20
Sylvia Modelski, Port-Said Revisited, Washington, Faros, 2000, pp. 145-146.
21
Sur Alexandrie, se référer à l’ouvrage de Robert Ilbert Alexandrie, 1830-1960. Histoire
d’une communauté citadine, Le Caire, IFAO, 1996. Sur la communauté grecque en Égypte, cf.
Alexander, Kitroeff, The Greeks in Egypt. Ethnicity and Class, London, Ithaca Press, 1989.
Sur les Italiens, Mercédès Volait, « La communauté italienne et ses édiles », in Alexandrie
entre deux mondes, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, Edisud, 4e
trimestre 1987, pp. 137-156.
22
Les discours du nationaliste de Mustafa Kamil s’en prennent virulemment au Syro-
Libanais. Henry Laurens, L’Orient arabe, Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris,
Armand Colin, 2000, pp. 103-105.
23
La nationalité égyptienne est définie en 1926, complétée par la loi de 1929 : 70 % des Syro-
Libanais font le choix de cette nationalité contre seulement 17 % des Grecs d’Égypte. Frédéric
Abécassis et Anne Le Gall Kazazian, « L’identité au miroir du droit. Le statut des personnes
en Égypte (fin XIXe siècle-début du XXe siècle) », in À propos de la nationalité : questions sur
l’identité nationale, Égypte/Monde arabe, n°11, 1992, pp. 11-38.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%