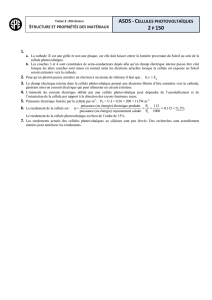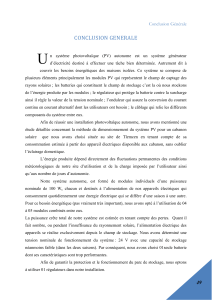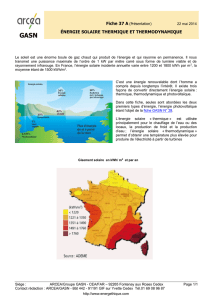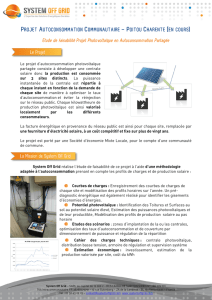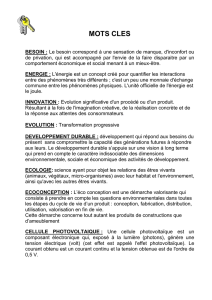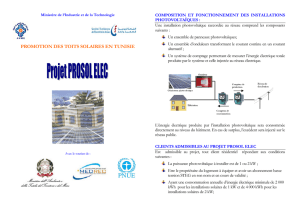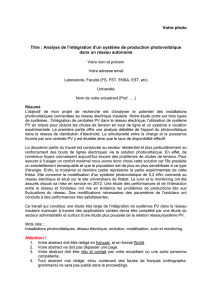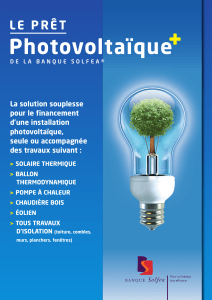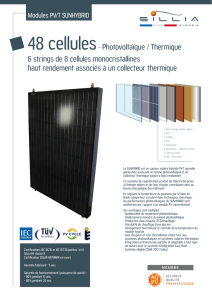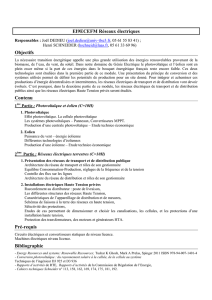2.2 Modes de pose

1 LE PHOTOVOLTAÏQUE, EN THEORIE ________________________________ 1
1.1 HISTORIQUE _________________________________________________________ 1
1.2 FABRICATION ________________________________________________________ 2
1.3 FONCTIONNEMENT _____________________________________________________ 3
1.4 LES TECHNOLOGIES _____________________________________________________ 4
1.4.1 Cellule Silicium Amorphe _________________________________________________________ 4
1.4.2 Cellule Silicium Mono-Cristallin ____________________________________________________ 4
1.4.3 Cellule Silicium Multi-Cristallin _____________________________________________________ 5
1.4.4 Cellule Tandem ________________________________________________________________ 5
1.4.5 Cellule Tellurure de Cadmium (CdTe) : ______________________________________________ 6
1.5 RECYCLAGE __________________________________________________________ 6
1.6 AVENIR ____________________________________________________________ 6
2 LE PHOTOVOLTAÏQUE, PARTIE TECHNIQUE __________________________ 8
2.1 UTILISATIONS ________________________________________________________ 8
2.1.1 La connexion réseau ____________________________________________________________ 8
2.1.2 Le site isolé __________________________________________________________________ 10
2.1.3 Le connecté réseau secouru ______________________________________________________ 14
2.1.4 Les systèmes au fil du soleil ______________________________________________________ 15
2.2 MODES DE POSE ______________________________________________________ 16
2.2.1 Intégration toiture _____________________________________________________________ 16
2.2.2 Intégration bâti _______________________________________________________________ 16
2.2.3 Surimposition toiture ___________________________________________________________ 18
2.2.4 Fixation sur structure ___________________________________________________________ 19
2.2.5 Autres modes de pose __________________________________________________________ 20
2.3 EXEMPLES DE REALISATIONS ______________________________________________ 21
2.3.1 Connexion réseau _____________________________________________________________ 21
2.3.2 Site isolé ____________________________________________________________________ 22
Dossier pédagogique :
Le photovoltaïque : histoire, technologies et utilisations
ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS
280 Rue Edouard Daladier 84973 CARPENTRAS Cedex
Tél : 04 90 60 05 68 - Fax : 04 90 60 66 26
Site : http://www.erm-automatismes.com/
E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

DOSSIER PEDAGOGIQUE Le solaire photovoltaïque Page 1/22
84 973 Carpentras CEDEX
1 LE PHOTOVOLTAÏQUE, EN THEORIE
1.1 Historique
L'effet photoélectrique a été découvert, par le physicien français Antoine BECQUEREL. Il présenta sa
découverte à l’académie des sciences à la fin de l’année 1839 avec l’aide de son fils Alexandre Edmond
BECQUEREL. Leur expérience permet d'observer le comportement électrique modifié par la lumière
d’électrodes de platine et de cuivre plongées dans une solution électrolytique acide.
1873 - Willoughby SMITH (1828/1891), ingénieur électricien anglais, découvre avec son assistant J. MAY les
propriétés photosensibles du sélénium (le sélénium est un semi-conducteur).
4 ans plus tard, William Grylls ADAMS (1836/1915), professeur anglais, met en évidence l’effet photovoltaïque
du sélénium
En 1885, Ernst Werner von SIEMENS (1816/1892), ingénieur et industriel allemand, précise que la conductivité
du sélénium est proportionnelle à la racine carrée de l’intensité de la lumière et imagine les possibilités de
captage de l’énergie solaire.
Albert Einstein fut le premier, en 1905, à proposer une explication théorique de cet effet, en utilisant le
concept de particule de lumière, appelé aujourd'hui photon. Il a expliqué que ce phénomène était provoqué
par l'absorption de photons, lors de l'interaction du matériau avec la lumière. Cette découverte lui valut le
prix Nobel de physique en 1921.
L’explication théorique d’Einstein fut confirmée expérimentalement par Robert Andrews MILLIKAN
(1868/1953) en 1916.
1939 - Russel OHL (1898/1987), ingénieur américain, découvre la jonction P-N et ses travaux le conduisent à
développer la première cellule solaire en silicium. Il déposa un brevet en 1946 pour un appareil sensible à la
lumière (US2402662, "Light sensitive device"), le brevet étant aujourd'hui admis comme celui de la cellule
solaire moderne.
L’âge moderne du photovoltaïque débuta au milieu des années 50, des chercheurs américains (Chapin, Fuller,
Pearson et Prince) travaillant pour les laboratoires Bell Telephone (devenus aujourd’hui Alcatel-Lucent Bell
Labs) découvrirent par accident que lorsque l'on "dopait" le silicium avec certaines impuretés, ce dernier
devenait extrêmement sensible à la lumière. Ils développent grâce à leur découverte une cellule
photovoltaïque à haut rendement de 6 %.
Le premier satellite à énergie photovoltaïque « Vanguard » fut lancé en 1959 il embarquait 6 cellules avec un
rendement de 9%.
L'intérêt que portaient les diverses agences spatiales aux cellules solaires permit alors de financer la recherche
et le développement de nouveaux types de cellule que l’on rencontre aujourd’hui.

DOSSIER PEDAGOGIQUE Le solaire photovoltaïque Page 2/22
84 973 Carpentras CEDEX
1.2 Fabrication
Le constituant principal de la cellule photovoltaïque est le Silicium. C’est l’élément chimique le plus abondant
dans la croute terrestre après l’oxygène. On le trouve sous forme de silice (SiO2 ) dans le sable, le quartz, la
cristobalite, mais aussi sous d’autre formes de silicates (Feldspath, Kaolinite etc.)
Le silicium tel qu’utilisé dans la fabrication de cellules provient du Quartz (il n’y a pas
de solution industrielle pour l’extraire du sable). Ce quartz va subir des traitements
métallurgiques (Réduction SiO2 + C → Si + CO2 réalisée dans un four à arc à 3000°c),
physiques et chimiques pour obtenir un silicium pur à 99,9999%, on parle alors de
SoG-silicium (solar grade silicium / silicium de qualité solaire).
A la fin du processus de fabrication, on obtient des lingots de silicium qui
sont découpés en plaquettes (Wafer) de 0,2 à 0,3 mm.
Les wafers sont ensuite combinés à des impuretés soigneusement choisies qualitativement et
quantitativement. On parle alors de dopage ; ce traitement se passe dans un four et consiste à injecter un gaz
porteur des impuretés qui vont se combiner au silicium sous l’effet de la température. Lors d’une combinaison
avec du Phosphore, de l’arsenic ou de l’antimoine, on parle de dopage de type N (Négatif, ce dopage crée un
surplus d’électrons dont la charge est négative). Lors d’une combinaison avec du Bore, on parle de dopage de
type P (Positif, ce dopage crée un déficit d’électrons donc une charge positive)
Les wafers sont assemblés deux à deux (P+N), puis métallisés afin de permettre la récupération des électrons,
donc de l’énergie.
Cristal de Silicium
Un wafer

DOSSIER PEDAGOGIQUE Le solaire photovoltaïque Page 3/22
84 973 Carpentras CEDEX
1.3 Fonctionnement
Lorsque la cellule photovoltaïque est soumise à la lumière, un photon (grain de lumière) va entrer en contact
avec la zone dopée N, ce contact a pour effet de libérer un électron dans la zone N et de créer un « trou »
(déficit d’électron), les électrons vont s’accumuler en bordure de la zone N à l’opposé du lieu d’accumulation
des trous, en bordure de zone P. Ces accumulations créent une différence de potentiel (une tension
électrique !). Il suffit ensuite de fermer le circuit pour que le courant circule.
En effet, en interne, les électrons ne peuvent pas se recombiner avec les trous, mais si l’on branche par
exemple une ampoule aux bornes de la cellule, les électrons vont se déplacer en direction des trous à travers
l’ampoule. Ce déplacement d’électrons est un courant électrique.
L
i
m
Photons
Trou (+)
Electron (-)
Circulation des
électrons

DOSSIER PEDAGOGIQUE Le solaire photovoltaïque Page 4/22
84 973 Carpentras CEDEX
1.4 Les technologies
1.4.1 Cellule Silicium Amorphe
Le silicium lors de sa transformation, produit un gaz (Le Silane). Ce gaz est
récupéré et projeté sur une feuille de verre. Les dopants sont injectés de la même
manière à l’aide de gaz (phosphine, borane). La cellule est gris très foncé. C'est la
cellule des calculatrices et des montres dites « solaires ».
Avantages :
- fonctionne avec un éclairement faible ou diffus (même par temps couvert, y
compris sous éclairage artificiel de 20 à 3000 lux),
- un peu moins chère que les autres techniques,
- intégration sur supports souples ou rigides.
Inconvénients :
- rendement faible en plein soleil, de 5% à 7%,
- nécessité de couvrir des surfaces plus importantes que lors de l’utilisation de silicium cristallin (ratio Wc/m²
plus faible, environ 60 Wc/m2)
- performances qui diminuent avec le temps dans les premiers temps d'exposition à la lumière naturelle (3-6
mois), pour se stabiliser ensuite (-10 à 20% selon la structure de la jonction).
1.4.2 Cellule Silicium Mono-Cristallin
Lors de leur fabrication, les lingots sont fondus pour prendre leur forme. Le
refroidissement se faisant naturellement, le silicium fondu se solidifie en ne
formant qu'un seul cristal. Ces cellules sont en général d'un bleu uniforme.
Avantages :
- très bon rapport puissance / surface rendement de 150 Wc/m².
Inconvénient :
- coût élevé
Module ASi - Silicium
Amorphe 5%< η<7%
Module Mono-Cristallin
13,5%<η<14,5%
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%