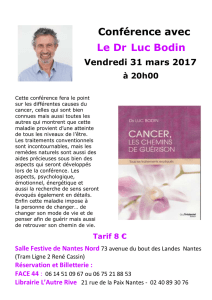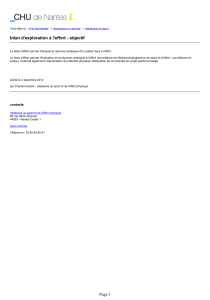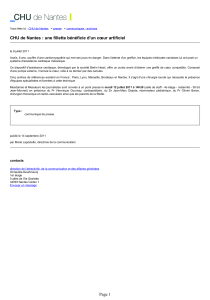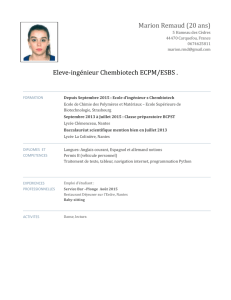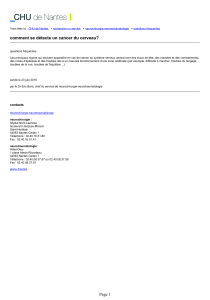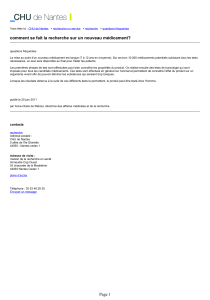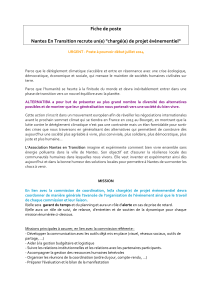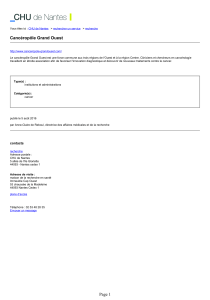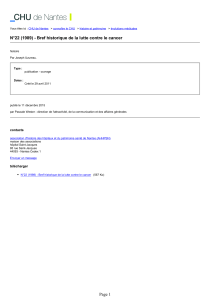L`analyse ethnographique du GPV Malakoff – Pré Gauchet

POPSU 2
PROGRAMME DE RECHERCHE DU CONSORTIUM DE
NANTES

Sommaire
PROGRAMME DE RECHERCHE DU CONSORTIUM DE ........................................................................................ 1
NANTES .......................................................................................................................................................... 1
SOMMAIRE ..................................................................................................................................................... 2
RAPPEL DE LA PREMIERE PHASE POPSU ........................................................................................... 3
« DES POLITIQUES LOCALES SOUS CONDITION D’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE»
[THÈME 5] .............................................................................................................................................................. 3
INTRODUCTION : ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, « CONCEPT » OU MOT « MAGIQUE »? .......................... 3
LES AXES DE L’ANALYSE .............................................................................................................................. 5
Axe 1 : Les activités de l’économie fondée sur la connaissance dans l’agglomération nantaise : quelle
dynamique ? quels dispositifs d’appui ? .......................................................................................................... 5
Axe 2 : Politiques économiques urbaines et aménagement : mise en perspective historique ................ 10
Axe 3 : « Quand l’économie de la connaissance vient au projet urbain de l’Ile de Nantes ». (Enquête
les pieds dans le sol) ...................................................................................................................................... 12
RÉSONANCES ................................................................................................................................................ 15
PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................ 15
TRAVAUX SIGNIFICATIFS DES CHERCHEURS IMPLIQUÉS : ............................................................................ 16
RÉGULATION TERRITORIALE : ACTEURS ET DISPOSITIFS EN SITUATION [THÈME 4] .... 18
INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 18
LES AXES D’ANALYSE .................................................................................................................................. 19
Axe 1 : La régulation urbaine en mode Grand Projet : à la table des puissances invitantes et invitées
........................................................................................................................................................................ 20
Axe 2 : L’articulation logement-urbanisme et les stratégies des opérateurs du logement ..................... 23
Axe 3 : « Soft regulation » : produire des représentations communes ? .............................................. 28
FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE ET IMPLICATIONS DES CHERCHEURS ........................................................ 30
RÉSONANCES ................................................................................................................................................ 32
PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................ 32
ORGANISATION GÉNÉRALE .................................................................................................................. 34
2

RAPPEL DE LA PREMIERE PHASE POPSU
La POPSU 1 a été l’occasion de mettre en place à Nantes un dispositif de recherche
développement associant une équipe de chercheurs et un réseau d’acteurs, concernés à différents
titres par les questions urbaines contemporaines. Ces investigations ont permis de documenter une «
petite et grande fabrique nantaise » à l’aune de différents éclairages thématiques : pouvoirs urbains,
offre urbaine complexe, petite fabrique de l’habitat, les instruments du projet, bonnes pratiques et
cultures professionnelles. Au-delà de la documentation des stratégies de développement et
d’aménagement se comprenant à la grande échelle, trois principaux espaces en projet avaient retenu
l’attention et fait l’objet d’analyses poussées : l’île de Nantes (à la suite également de recherches
menées dans de précédents appels d’offre de recherche), le Nouveau Malakoff dans le cadre initial
d’une procédure GPV de la Politique de la Ville et le projet Bottière-Chênaie, dans le cadre d’une ZAC
de maîtrise d’ouvrage communale – à la différence des deux autres, intercommunaux .
A l’issue de la POPSU 1, les chercheurs et acteurs ayant contribué à ces travaux souhaitent voir
être prolongée l’expérience, tout en élargissant les horizons disciplinaires, l’équipe de travail et en
renouvelant les sujets d’investigation, à partir de deux des thèmes proposés par le GIP : celui de
l’économie de la connaissance et celui des régulations territoriales.
« Des politiques locales sous condition d’économie de la
connaissance» [thème 5]
Cette note aborde tout d’abord la définition de l’économie de la connaissance, en s’interrogeant
sur son origine, sur les déclinaisons territoriales de cette notion et comment celle-ci participe
tendanciellement au reformatage des actions publiques locales. Ensuite, nous proposons une analyse
articulée des champs d’investigation nantais : les activités de l’économie fondée sur la connaissance,
la ville créative et les activités culturelles et présentons les éléments de méthode que requiert cette
recherche.
Introduction : Economie de la connaissance, « concept » ou mot « magique »?
L’économie de la connaissance est une notion introduite par l’OCDE (1996), sous le terme
d’« économie fondée sur le savoir et sur l’apprentissage ». Le succès de ce terme chez les économistes
et les décideurs publics signale que la croissance ne résulte plus de la production de masse effectuée
par de grandes entreprises intégrées verticalement, comme durant l’ère fordiste. Alors que la
performance des entreprises reposait essentiellement sur la réduction des coûts en matière première,
main d’œuvre et transport, désormais, les facteurs de compétitivité, de création d’emplois et de bien-
être ont durablement muté. En effet, une grande partie des différentiels de croissance et de revenus
observés entre les économies nationales et régionales peut être expliquée en considérant le capital
humain et la qualification de la main-d’œuvre (Florida, 2005), ou encore les investissements publics et
privés en recherche-développement (Audretsch et Lehmann, 2005). De plus, la capacité d’innovation
locale, régionale et nationale a également été stimulée par la diffusion des technologies de
l’information et de la communication. Désormais en concurrence directe à une échelle internationale,
« les régions et les villes (…) doivent réinventer sans cesse de nouvelles spécificités productives,
sources de croissance et de création d’emplois » (Liefooghe, 2010, p. 183).
3

La montée inexorable du contenu en connaissances dans les activités productives est synonyme
d’une sélection des participants à la production sur la base de leurs compétences et de leurs
qualifications. Cette « division cognitive du travail » (Pilati et Tremblay, 2007) engendre une
polarisation géographique des activités dans les zones intensives en recherche-développement et
riches en capital humain. Il est donc très important, que dans les grandes agglomérations dotées en
appareil de recherche (privée et publique), l’économie de la connaissance s’organise ou s’optimise, y
compris pour générer des effets de retombée (revenu, formation…) au-delà des individus dotés d’un
capital connaissance important. Cette concrétisation locale peut s’accompagner de dispositifs
originaux, voire d’une redéfinition des contours de l’économie de la connaissance, concept encore
flou.
En ce qui concerne l’action publique, depuis les années 2000, l’investissement dans la R&D, et plus
largement les processus conduisant à l’utilisation de la connaissance sont mis en avant comme
devant constituer de nouveaux objectifs. Un point important est que la capacité d’innovation ne
résulte pas uniquement des entreprises, mais est aussi produite par d’autres acteurs, comme
l’enseignement supérieur et la recherche. Dans ce contexte, tout en reconnaissant les mérites des
approches quantitatives (portant sur les dépenses en recherche-développement, les dépôts de
brevets, les effectifs d’étudiants avancés, le repérage de la « classe créative »…), il nous semble
judicieux, dans le cadre de POPSU 2, de rendre compte d’un certain nombre de dispositifs d’action
publique visant à stimuler l’économie de la connaissance, pour permettre in fine aux acteurs nantais
d’en apprécier la concrétisation ou non, et d’échanger avec les chercheurs.
L’économie de la connaissance recèle plusieurs ambiguïtés qui ont des conséquences importantes
pour l’action publique (Musso, 2005). S'agit-il de pointer l’importance de la connaissance humaine
générale, ou spécifiquement des connaissances scientifiques (issues des sciences dures) et techniques
(maniées par les ingénieurs) ? Dans un cas, l’élévation du niveau général d’éducation d’une classe
d’âge est un objectif prioritaire, dans l’autre le renforcement des enseignements scientifiques, ou le
développement de collaborations entre structures de recherche et industrie, sont mis en avant. Un
deuxième débat, consiste à interroger la place de la connaissance comme facteur majeur de
transformation économique et sociale. N’est-ce pas plutôt la technologie, l’innovation, la
tertiairisation, voire la dérégulation, qui sont déterminants dans les évolutions contemporaines ?
Au niveau théorique, l’économie de la connaissance connait des débats nombreux (Pilati et
Tremblay, 2007). Nous en retrouverons certainement des traces sur le terrain nantais, dans des
dilemmes auxquels sont confrontés les acteurs publics, des tensions possibles entre orientations, voire
entre identités. Considérant que l’économie de la connaissance est un concept flou plus qu’une réalité
repérable, donc qu’elle constitue une référence non stabilisée pour l’action publique, nous proposons
de balayer un large champ, allant des activités d’innovation scientifique à l’économie de la culture
et des arts. Il s’agit de considérer que la capacité d’innovation se situe pour partie dans l’organisation
du croisement de connaissances et de besoins jusque-là compartimentés. La production de
connaissances scientifiques et techniques est une activité sociale, qui demande notamment des
capacités à maximiser les interactions (Latour, 1989). De son côté, le potentiel économique et social
des activités culturelles, avéré dans le cas nantais, signale peut-être une nouvelle phase de
développement. La recherche de la créativité et de la transdisciplinarité amènent à déplacer les
frontières de l’activité, au profit de réseaux collaboratifs, d’expérimentations, de dispositifs
temporaires, dans lesquels les individus jouent un rôle moteur.
Au fond, le thème de l’économie de la connaissance invite à réinterroger ce qui fait le
développement métropolitain. Il s’agit de donner corps à l’intuition de M. Roncayolo il y a quelques
années : le rang métropolitain se mesure peut-être moins aux équipements, que l’on trouve
banalement dans chaque grande ville, qu’à la détection de volontés de changement et d’innovation.
4

Les axes de l’analyse
Le premier programme POPSU a montré avec force que les acteurs publics des grandes
agglomérations françaises opèrent des choix véritables en matière d’urbanisme, de services urbains
ou encore d’offre d’aménités. Introduite par le thème de l’économie de la connaissance, proposé pour
POPSU2, la question de l’action économique locale se pose dans des termes légèrement différents.
Comme l’écrit G. Antier dans son ouvrage sur les grandes métropoles mondiales, « on peut décider de
réaliser une ligne de transport en commun, mais on ne décrète pas la présence de dizaines ou de
centaines d’entreprises sur un technopôle » (Antier, 2005, p. 189). Autrement dit, le développement
économique est plus un enjeu qu’un levier d’action. Attirer ou retenir des activités économiques
emprunte souvent des moyens indirects : provision d’équipements et services collectifs, amélioration
du cadre de vie, etc. Dans nos investigations sur l’économie de la connaissance à Nantes, repérer
d’éventuels éléments de stratégie supposera de bien sélectionner les dispositifs et les scènes de
construction de l’action locale en faveur de l’économie de la connaissance.
Trois axes de recherche seront poursuivis. Un premier volet cherchera à qualifier la dynamique
des activités de l’économie fondée sur la connaissance, en portant notamment éclairage sur les
dispositifs d’appui dédiés (axe 1). Un deuxième volet mettra en perspective historique ce que
l’économie de la connaissance fait à la ville, en revenant sur quelques concrétions spatiales des
précédents modèles économiques. Il apparaît en effet important de situer l’action publique locale
dans un temps long, pour apprécier non seulement les intentions, mais aussi les effets des
réalisations. La concrétisation spatiale du développement économique nantais (à travers, par
exemple, les parcs technopolitains), comme l’organisation des acteurs (entre concurrence, évitement
et coopération), sont un héritage pour des politiques contemporaines d’appui à l’économie de la
connaissance (axe 2). L’analyse des tentatives, réussites ou échecs, vise in fine à permettre aux
chercheurs et aux praticiens concernés de mettre en relief les particularités de l’actuel projet phare
nantais : le Quartier de la création. Le troisième axe de la recherche ira interroger la fabrique plurielle
et collective du cluster culturel qui s’aménage aujourd’hui au sein du projet urbain de l’Ile de Nantes
(axe 3).
Axe 1 : Les activités de l’économie fondée sur la connaissance dans l’agglomération
nantaise : quelle dynamique ? quels dispositifs d’appui ?
Chercheurs impliqués : Christophe DEMAZIERE, Jacques FACHE.
Il n’existe pas de définition stabilisée de l’économie de la connaissance, mais on peut d’emblée
convenir que cette partie de l’économie ne renvoie pas seulement (et peut-être pas principalement) à
des aménagements concrets (centres d’affaires, parcs technopolitains…), pour lesquels des savoir-
faire, des opérateurs et des modalités de production urbaine existent et ont fait l’objet de travaux.
Lors du premier programme POPSU, G. Crague (2009) avait déjà fait le constat d’une intersection
réduite (mais néanmoins fructueuse) entre économie et aménagement. Pour cerner les réalités et
paradoxes que recouvre l’économie de la connaissance dans l’agglomération nantaise, nous
proposons donc une analyse itérative allant des documents stratégiques aux projets circonscrits dans
le temps ou l’espace. L’analyse des stratégies permet de voir quelle place est (a été) donnée à
l’économie de la connaissance par rapport à d’autres champs ou secteurs d’activités. Elle mettra en
évidence l’évolution des réflexions, mais aussi, éventuellement, la pluralité des acteurs. Avec l’analyse
de projets circonscrits, c’est la possibilité de territorialiser l’économie de la connaissance que nous
souhaitons interroger.
Globalement, cet axe met en miroir les principes du modèle de développement économique et
d’organisation territoriale, dans lequel Nantes Métropole est l’auteur d’énoncés dominants, et des
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%