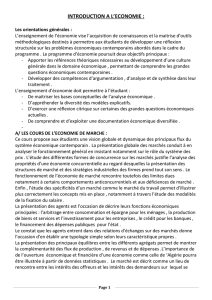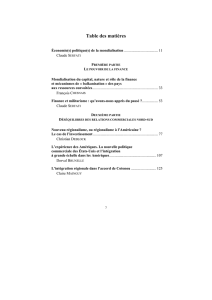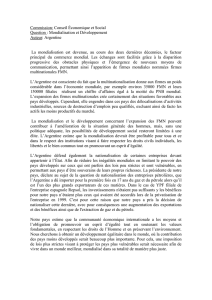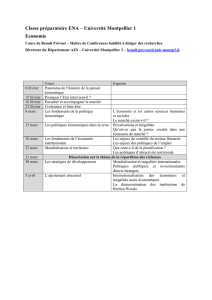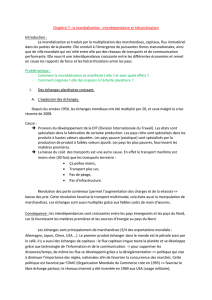L`Apprentissage dans la mondialisation

LES ÉTUDES DU CFA
OUVERTURES.ORG N° 23 – FÉVRIER 2009
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : ALAIN BERNARD – RÉDACTEUR EN CHEF : JEAN SAAVEDRA
L’apprentissage
dans la
mondialisation
Une interview de Pierre-Noël GIRAUD,
Professeur d’économie à l’Ecole des Mines (MINES - Paris Tech)
La mondia lisation. Emergences et fragmentations

Pouvez-vous rappeler votre
trajectoire professionnelle ?
Comment un polytechnicien
devient-il économiste ?
OUVERTURES.ORG – LES ÉTUDES DU CFA – N° 23 – FÉVRIER 2009
Quelle est votre méthode
de travail ?
2
L’inégalité du MondeLe Commerce des promesses
La mondialisation. Emergences et fragmen-
tations

OUVERTURES.ORG – LES ÉTUDES DU CFA – N° 23 – FÉVRIER 2009
3
On pourrait dire
que le monde
s’est mondialisé
en permanence
depuis qu’on est
sorti de l’époque
où les grandes
civilisations
s’ignoraient
entre elles.
L’inégalité du
monde
Le commerce
des promesses
Pouvez-vous préciser
la place de « l’inégalité »
dans votre réexion ?

OUVERTURES.ORG – LES ÉTUDES DU CFA – N° 23 – FÉVRIER 2009
4
Pourriez-vous revenir
sur ce paradoxe
que la mondialisation
morcelle le monde,
que la globalisation
le fragmente ?

OUVERTURES.ORG – LES ÉTUDES DU CFA – N° 23 – FÉVRIER 2009
5
Pouvez-vous nous
donner un exemple ?
Peut-on dire que l’économie
politique est née
avec la mondialisation
au début du XIXe siècle ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%