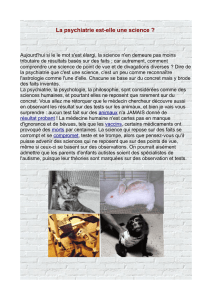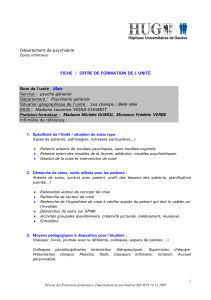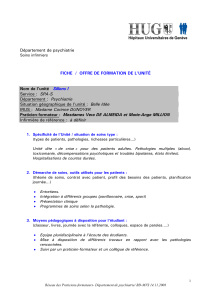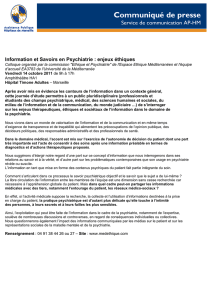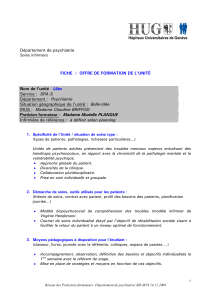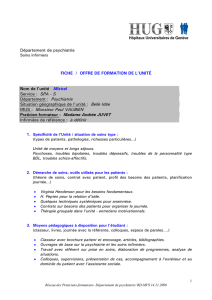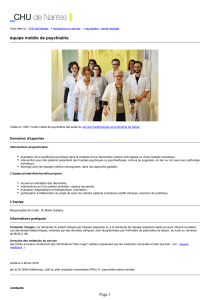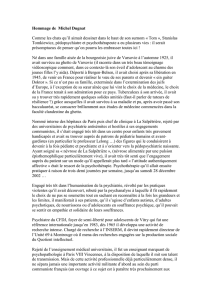LE DÉCLIN DE L`EMPIRE PSYCHIATRIQUE JACQUES

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE PSYCHIATRIQUE
JACQUES HOCHMANN1
On s’en va répétant que la psychiatrie française est en crise, crise des moyens, aujourd’hui
en régression, mais aussi crise des valeurs et crise de doctrine. Des drames spectaculaires
ont porté ce malaise devant l’opinion publique et fait tomber une « nuit sécuritaire » dont les
politiques ont aussitôt profité pour annoncer leur intention de légiférer, en affirmant le besoin
d’une « réforme en profondeur » de la psychiatrie, mais en faisant craindre un retour à des
pratiques d’enfermement qu’on espérait définitivement disparues. Prenant la suite des États
Généraux de Montpellier, des appels sur Internet ont fait largement écho à ces
préoccupations, reprises depuis par diverses instances syndicales ou associatives et par la
mobilisation d’un vaste mouvement de protestation. Cependant les attaques
antipsychiatriques et antipsychanalytiques se multiplient : livre noir, église de scientologie,
mouvement de certaines associations de parents d’enfants autistes qui, curieusement,
tiennent le même langage.
Le mythe de l’âge d’or
Elle est loin l’époque où un syndicat de psychiatres, unique et puissant, associé à des
administrateurs visionnaires, soutenu par l’intelligentsia « de gauche » et les organisations
politiques et syndicales avancées, faisait signer à des ministres, qui n’étaient pas toujours
spécialement progressistes, des circulaires et des décrets fondant une nouvelle approche
plus humaine et plus compréhensive du destin des malades mentaux. Elle est loin l’époque
où la représentation nationale se préoccupait plus d’assurer à ces malades une extension de
leurs droits sociaux et la défense de leurs libertés, que de faire face, de manière irrationnelle,
à une dangerosité largement surévaluée.2 Un accord semblait alors s’être réalisé entre,
d’une part, une psychiatrie qui trouvait son sens dans une éthique du sujet, en concevant
les troubles psychiques comme une « pathologie de la liberté » (Henri Ey) et, d’autre part,
une société plus ouverte au respect d’un pluralisme des conduites admises. Après la
découverte des horreurs de l’univers concentrationnaire et du totalitarisme, avec la remise
en cause de l’oppression coloniale et de l’exploitation de l’homme par l’homme, avec la
reconnaissance des droits de la femme, avec une aspiration à un assouplissement des
normes sexuelles, la lutte des psychiatres les plus militants pour rendre leur dignité d’homme
aux victimes de l’aliénation asilaire, parfois survivants d’une hécatombe liée à la négligence
et aux restrictions alimentaires de la guerre3, rencontrait un état d’esprit libertaire alors dans
l’air du temps. La psychanalyse, malgré l’entretien d’inévitables résistances, était devenue,
sous diverses formes, d’abord aux États-Unis puis en Europe, un objet culturel à la mode,
marquée comme une idéologie de libération. Il n’était plus honteux, il était au contraire
recommandé de s’interroger sur soi, de ressentir une souffrance psychique et de réclamer
une aide pour analyser et apaiser cette souffrance. Avec le recul de l’eugénisme, dont le
nazisme, en l’appliquant à la lettre, avait révélé les sombres soubassements et les
redoutables conséquences, l’héréditarisme battait de l’aile. On attribuait moins les désordres
mentaux à une tare génétique, héritage laïc du péché originel4, et plus à une réaction aux
facteurs d’environnement sociaux ou familiaux. En outre, poursuivant une évolution
esquissée dans l’entre-deux guerres avec la découverte des thérapeutiques de choc, la
psychiatrie devenait plus active. De nouveaux médicaments faisaient la preuve de leur
efficacité (sinon de leur inocuité). Ils changeaient l’atmosphère des divisions hospitalières et
permettaient un abord relationnel individualisé. Associée aux développements de
l’anthropologie et de la psychologie des groupes restreints, ainsi qu’à une critique sociale
1 Professeur émérite de pédopsychiatrie à l’Université Claude Bernard
Médecin honoraire des Hôpitaux de Lyon. Article à paraître dans Psychiatre Française, janvier 2010
2 J. Hochmann (2004), Histoire de la psychiatrie, Paris, PUF, coll. Que Sais-je ?
3 I. von Bueltzingsloewen (2007), L’Hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français
sous l’Occupation, Paris, Aubier.
4 J. Hochmann (2009), Histoire de l’autisme, Paris, Odile Jacob.

2
plus large, d’inspiration souvent marxiste, une psychopathologie dynamique offrait des bases
théoriques aux tentatives de réforme. Dans quelques établissements de petite taille, où une
direction médicale avait donné plus d’aise pour transformer l’organisation de la vie dans
l’institution, des expérimentations de thérapie collective s’étaient ainsi développées qui, en
utilisant toutes les situations de la vie quotidienne, élaborées dans une imbrication de
réunions d’équipe, de pavillon, de club, reconnaissaient au personnel infirmier un pouvoir
psychothérapique jusque là mal utilisé et offraient aux malades des possibilités d’expression
autonome nouvelle, ce que l’un des pionniers, François Tosquelles, appelait une « école de
liberté ». D’abord très limité, ce renouveau du traitement moral de Pinel et d’Esquirol, sous
une forme démocratique peu habituelle dans les services médicaux, s’étendait petit à petit à
un nombre croissant d’hôpitaux psychiatriques. Promulguée par la célèbre circulaire du 15
mars 1960, la politique de secteur permettait alors la mise en place d’une continuité des
soins en incitant à généraliser à l’ensemble du territoire l’ouverture de consultations de
dépistage, de post-cure puis de soins substitutifs à l’hospitalisation. On vit, peu après, se
multiplier les psychiatres, dont la formation, en 1968, s’était séparée de celle des
neurologues. Répondant à une demande nouvelle et croissante, ils s’installaient en nombre
dans le privé pour y exercer, le plus souvent, comme psychanalystes ou comme
psychothérapeutes. Dans le service public, ils dirigeaient des équipes multidisciplinaires plus
étoffées et bénéficiaient de crédits conséquents pour améliorer considérablement les
conditions d’accueil des centres spécialisés. Ils obtenaient la possibilité d’ouvrir des services
dans les hôpitaux généraux et surtout de développer des « alternatives » à l’hospitalisation,
en maillant leurs « secteurs » d’un réseau de dispositifs de proximité souples, diversifiés et
ouverts sur la communauté. Les besoins spécifiques des enfants et des adolescents en
difficulté psychologique, longtemps abandonnés, pour les plus lourdement atteints, dans des
garderies sans espoir, au fond des asiles, étaient enfin pris en compte. Des secteurs de
psychiatrie infanto-juvénile venaient compléter les rares consultations hospitalières
existantes et tentaient de s’articuler avec l’école et avec un ensemble d’institutions
médicosociales, souvent mises en place à l’initiative des associations de parents. En 1952,
un numéro de la revue Esprit avait pu dénoncer la « misère de la psychiatrie ». Vingt ans
plus tard, la situation avait radicalement changé et les années 70 et 80 virent la réalisation
de la plupart des préconisations des Livres Blancs des années 60.
Certes, tout n’était pas ou ne devait pas rester glorieux dans ces trente et quelques années
d’expansion. Sentiment aigre-doux, qui peut être agréable, la nostalgie, si on la cultive trop,
n’est pas bonne conseillère. Elle enjolive le passé, elle paralyse les efforts pour changer le
présent. Il faut regarder notre histoire récente avec plus d’objectivité. Ce qu’on a appelé, un
peu vite, la révolution psychiatrique, avait d’abord mis du temps à s’appliquer. Quinze
années séparent les Journées psychiatriques, organisées dans l’immédiat après-guerre à
l’initiative du Syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques, de la circulaire de 1960.
Celle-ci n’eut, au départ, que peu d’effets et, en dehors de quelques rares expériences
novatrices, se limita, dans la plupart des cas, à tracer, pour chaque service, les frontières
d’une aire de recrutement, au terme d’une série d’échanges difficiles : « je te donne cette
vallée de montagne éloignée mais peu peuplée, contre ce quartier de ville plus proche mais
surchargé en problèmes de toutes sortes ». Ce jeu de Monopoly prolongé était en effet plus
destiné à égaliser les avantages et les inconvénients rencontrés par les équipes dans leur
travail auprès de diverses populations, qu’à se soucier de la cohérence géographique,
sociologique et économique de la zone desservie. Il fallut attendre encore douze années
pour que des décrets offrant aux psychiatres qui s’engageaient dans la pratique de secteur
des compensations financières permettent enfin une application du principe de la continuité
des soins et l’ouverture, hors les murs, de structures intermédiaires entre l'hospitalisation et
la suspension du traitement. Malgré une posture empruntée à l’Éducation Nationale, qui
prétendait installer en tous les points du territoire national un dispositif identique obéissant
aux mêmes critères et aux mêmes principes de fonctionnement, les inégalités allaient
longtemps persister d’un département à l’autre, en fonction de leur orientation politique ou de
leur proximité avec les centres de décision. La loi de 1985, qui légalisa enfin le secteur, un
quart de siècle après la circulaire, en donnant aux hôpitaux la gestion du dispositif
extrahospitalier jusque-là en partie financé par les Conseils Généraux et placé sous leur

3
tutelle, corrigea certaines de ces inégalités. Mais le développement de l’appareil sectoriel et
le redéploiement du personnel vers de nouvelles structures dépendaient désormais du
volontarisme des équipes médicales et de leur capacité à imposer leurs vues, avec le
soutien des tutelles, dans une négociation avec les directions administratives et les
organisations syndicales. Les directeurs étaient très diversement préparés à accepter une
dissémination hors de leur contrôle de leurs personnels sur une ville ou un arrondissement.
En dehors de quelques personnalités d’exception, ils peinaient à comprendre l’organisation
particulière de la psychiatrie si différente de celle des hôpitaux généraux, plus en phase avec
leur culture. Leurs réticences entraient en résonance avec celles de certains syndicats du
personnel infirmier, technique et administratif, qui redoutaient de perdre leur capacité de
mobilisation auprès des agents des centres médico-pédagogiques ou des centres de jour, à
la fois plus éloignés des cellules centrales et plus indépendants dans leur travail. Cette
« alliance objective » reçut épisodiquement, au moins au début, le renfort de quelques
conseils généraux plus soucieux de construire encore de nouveaux hôpitaux que d’inaugurer
des réalisations moins visibles : un appartement thérapeutique, un service d’hospitalisation à
domicile. Il résulta de tous ces éléments une grande disparité quantitative.
Sur le plan qualitatif, la disparité (plus que la diversité souhaitable) était également la règle.
Établis sans contrepouvoirs, à la tête de petites baronnies, avec peu de liens entre elles
autres que purement administratifs, les chefs de secteurs pouvaient, sans souci de
coordination avec leurs voisins, s’adonner à leurs caprices institutionnels ou à leurs
toquades théoriques. Malgré l’existence de conseils départementaux de santé mentale, les
frontières étanches entre secteurs n’étaient guère favorables à l’intersectorialité et laissaient
s’installer des doublons. Il suffisait, par ailleurs, de traverser une rue pour trouver ici des
soignants férus de psychanalyse lacanienne, soumis au Grand Autre et aux jeux du
signifiant, et là un stipendié des compagnies pharmaceutiques ne connaissant que les
psychotropes et méprisant la parole. Une mutation, le départ à la retraite ou le décès d’un
responsable, en changeant brutalement l’orientation d’un service, laissaient alors sombrer
une expérience vivante dans la banalité et la bureaucratie, au prix de conflits paralysants
source d’absentéisme, de désengagement ou de démission.
Le secteur souffrait surtout de défauts structuraux. Conçu, au départ, dans la perspective
d’une société encore peu urbanisée et relativement stable, il était mal adapté pour affronter
la mobilité des usagers, d’où, au fil des déménagements ou des pertes d’ancrage territorial,
des changements de prise en charge, voire des ruptures préjudiciables à la continuité des
soins dont les équipes persistaient à se réclamer. Parfois machine à exclure les
indésirables, sous le prétexte du « hors secteur », le dispositif sectoriel restait sans réponse
devant la marée montante des « sans domicile fixe », dont le nombre devait s’accroître avec
la crise économique, le chômage et la précarité de l’emploi, mais aussi avec l’apparition
d’une nouvelle politique dite de « désinstitutionalisation ». Cette politique, qui ne figurait pas
dans les objectifs premiers, avait obtenu, pour des raisons différentes, toutes les faveurs de
deux groupes habituellement antagonistes : les professionnels ordonnateurs des dépenses
et les pouvoirs publics gardiens de l’équilibre budgétaire. Les uns y voyaient l’occasion,
longtemps espérée, d’un dépérissement de l’asile, dont de nombreuses études avaient
montré le caractère inévitablement « totalitaire » et qu’ils tenaient pour responsable d’une
aliénation sociale surajoutée à l’aliénation mentale. Les autres cherchaient à diminuer un
nombre de lits excédentaires, avec le but avoué de faire des économies. Rapidement, les
structures plus légères mises en place pour remplacer les lits hospitaliers, réduits souvent de
plus de la moitié et parfois ramenés au tiers, se révélèrent insuffisantes, cependant que leur
accroissement était freiné, dans la mesure où elles apparaissaient, à l’expérience, très
consommatrices en personnel bien formé et, tout compte fait, aussi onéreuses que
l’hospitalisation classique. Il s’en suivit un raccourcissement considérable des durées
d’hospitalisation, mais sans poursuite, hors de l’hôpital, des soins ou de l’hébergement, et
donc l’apparition, avec le système de rotation dit « de la porte tournante », de clochards
schizophrènes, laissés à eux-mêmes dans les rues des cités ou renvoyés à des organismes
caritatifs ou d’assistance sociale, qui se jugeaient incompétents.
D’autre part, comme jadis l’asile de Pinel et d’Esquirol, le secteur était victime de son
succès. Toute une population qui, quelques années auparavant, n’aurait jamais eu recours

4
aux services d’une équipe psychiatrique, attirée par la gratuité totale et le besoin nouveau
de trouver une écoute, venait désormais consulter dans les centres médico-psychologiques.
Des sujets déprimés ou anxieux, des victimes de stress ou d’attentats sexuels, des patients
souffrant de troubles du comportement alimentaires, d’addiction, de phobies ou
d’obsessions, des enfants ou des adolescents en difficulté scolaire ou de conduite, des
couples ou des familles en détresse, s’inscrivaient sur des listes d’attente de plus en plus
longues, au détriment des pathologies plus graves, notamment psychotiques, pour
lesquelles l’organisation de secteur avait été conçue. La tentation était alors grande de se
centrer sur ces clientèles nouvelles moins difficiles à contenir et avec lesquelles on pouvait
se contenter de quelques consultations plus ou moins espacées assorties de médicaments
ou de psychothérapies brèves, à visée cathartique ou de modification du comportement, en
se désengageant de l’accueil et du traitement de la folie dans tous ses états, dans l’urgence
de la crise, comme dans le soin au long cours des états chroniques. D’autant que l’absence
quasi totale de liens avec le secteur privé (considéré par certains des initiateurs du secteur
avec une hostilité analogue à celle des militants laïcs envers l’école libre, dans la guerre
scolaire qui, peu avant, avait fait rage) ne favorisait pas les transferts de clientèle et les
complémentarités. L’antagonisme traditionnel, l’atmosphère de concurrence ou, au mieux,
l’ignorance mutuelle dans laquelle, en dépit des textes officiels, continuaient à se tenir, dans
bien des cas, les dispositifs sanitaires et les dispositifs médicosociaux, la crainte des
premiers de perdre des moyens en acceptant de convertir une partie de leurs outils en
institutions relevant des seconds, contribuaient encore à un manque de collaboration et à un
engorgement des secteurs. Certains surent y trouver des remèdes efficaces et continuer à
répondre aux besoins de la population en soins mais aussi en accompagnement social et en
réhabilitation. Mais ces expériences de pointe, reposant souvent sur une créativité et un
engagement peu communs, difficiles à maintenir longtemps, ne firent pas facilement école.
Qu’elle correspondît ou non à la réalité, progressivement s’imposait, auprès des usagers,
l’image d’une psychiatrie publique de secteur enraidie dans ses convictions doctrinales, peu
efficace et surtout peu accessible et peu disponible. La proclamation de la nécessité d’une
demande préalable à toute intervention, au nom du respect de la liberté individuelle, le refus
de l’action concrète au prétexte de privilégier la seule écoute du discours, la sacralisation du
secret médical imposant des barrières à toute collaboration efficace avec les familles et les
autres interlocuteurs sociaux et interdisant toute pratique de réseau, bref une caricature des
principes de la cure type de psychanalyse, transposés sans nuance aux dispositifs de
secteur, fonctionnaient comme des remparts derrière lesquels les équipes soignantes, plus
exposées par leur insertion dans la cité, retrouvaient l’abri protecteur des anciens murs de
l’asile. Les grands principes initiaux de la psychiatrie communautaire : la conception de la
psychose comme une sociopathie, une souffrance à plusieurs dont celle du malade identifié
n’est que le témoin le plus voyant, la nécessité d’incarner le travail avec les psychotiques
dans une aide concrète, avaient fait long feu. Les médias, en résonance au malaise des
usagers, multiplièrent alors leurs critiques. Plus sensibles aux échecs qu’aux succès, ils
trouvèrent dans les insuffisances du secteur une occasion d’émouvoir l’opinion publique.
Devant la montée des mises en cause et pour compenser ce déficit d’image, les équipes
psychiatriques, qui pourtant jamais n’avaient été aussi nombreuses, oubliant le temps qu’il
avait fallu pour que la politique de secteur sorte de ses limbes, ignorant le caractère très
localisé et très inégal de son application ainsi que ses défauts originels, se laissèrent alors
aller au découragement et, arguant du manque de moyens, cultivèrent, de plus en plus, le
mythe de l’âge d’or. Un malin esprit aurait pu prétendre que le secteur était pleuré avant
d’avoir existé.
Le courant de libéralisation qui l’avait porté avait, de plus, par certains de ses excès,
engendré une réaction qui risquait de l’atteindre profondèment. Il faut ici parler de ce
gauchisme de la psychiatrie moderne qui s’est appelé l’antipsychiatrie.
Les antipsychiatries
On devrait dire plutôt les antipsychiatries : un phénomène récurrent qui accompagne, depuis
ses débuts, l’histoire de la psychiatrie et qui a entraîné, aux différentes époques, la crispation
défensive des psychiatres sur des positions qui leur faisaient perdre leur identité.

5
La psychiatrie n’est jamais allée de soi et a, de tout temps, engendré son contraire. Créée au
départ pour donner au fou un statut d’être humain, cette « médecine spéciale » a été
continuellement attaquée dans ce qui faisait sa spécificité ; elle a connu, par réaction, des
inflexions multiples qui tendaient à protéger ses agents d’une disparition programmée, en
cherchant dans leurs racines médicales une légitimité souvent en contradiction avec leurs
objectifs initiaux de soutenir l’aliéné dans sa marche vers l’humanité et la socialisation.
Dès leur origine, à l’aube du 19ème siècle, les psychiatres ont osé affronter la peur
immémoriale du fou. Ils ont découvert, jusque dans son aliénation extrême, le « sujet de la
folie », un être humain parlant, qu’ils ont arraché tant à la dérision du bouffon qu’à l’animalité
de l’insensé (quelquefois, il est vrai, pour l’y replonger quand sa parole devenait trop
dérangeante et qu’il leur fallait obéir aux impératifs sociaux de normalisation). Mais, à leur
tour, comme leurs patients, à la fois objet de rejet et de fascination, ils ont soulevé, eux
aussi, des sentiments mélangés. On les a accusés tantôt de réprimer trop énergiquement
des semblables, qu’ils ont pourtant été parmi les premiers à reconnaître comme tels, tantôt
de se montrer trop naïfs et trop laxistes et de laisser vaquer des bêtes féroces. Tantôt on
s’est indigné qu’ils fassent échapper, sous prétexte de « démence », des criminels à une
légitime sanction, tantôt on leur a fait le procès d’enfermer abusivement des personnes pour
la vie. Cette première antipsychiatrie, déclenchée d’abord par des juristes et par des
publicistes qui trouvaient de nombreux échos dans l’opinion, a conduit les deuxièmes et
troisièmes générations d’aliénistes, les successeurs de Pinel et d’Esquirol, à adopter des
positions organicistes qui se sont opposées à une première médecine des passions et ont
progressivement fossilisé le traitement moral des pionniers en une pratique de pure
gardiennage. Dans cet asile, utopie sociale qui avait dégénéré, une théorie fatale, la théorie
de la dégénérescence, a condamné, pour longtemps, les aliénés devenus des « malades
mentaux » à un sombre pronostic d’incurabilité et de transmission inéluctable du mal à leur
descendance. Qu’importe, les psychiatres avaient sauvé leur respectabilité et purent,
pendant presque un siècle, justifier, au nom de la protection de la race et de la société, les
internements à vie, avant d’expérimenter, sans beaucoup de soucis éthiques, quand
l’absence de thérapeutique efficace leur devint pesante, les traitements de choc et la
psychochirurgie. L’antipsychiatrie se maintenait mais restait discrète et sans effet notables.
Paradoxalement, elle s’est réveillée au moment où le secteur s’ébauchait et où de nouvelles
générations de psychiatres remettaient vigoureusement en cause l’ancien asile et ses
pratiques de ségrégation et de deshumanisation. Des sociologues et des philosophes de
renom, renouant avec une tradition ancienne, ont repris la dénonciation de la psychiatrie,
alors qu’elle libérait ses patients de la camisole et, changeant de fondement théorique,
trouvait dans la psychanalyse et dans ses dérivés l’inspiration de pratiques relationnelles
nouvelles. Considérant ce réformisme comme une manœuvre de diversion, les nouveaux
censeurs de la psychiatrie ont vu dans les pratiques libérales qui s’esquissaient une forme
plus subtile et plus moderne de répression, au service de l’ordre public, une « fliquiatrie de
secteur » pour les uns, un contrôle social infiltré dans les replis les plus secrets de la vie
intime, pour les autres.
Quelques professionnels ont alors tiré de cette antipsychiatrie des philosophes des
conclusions pratiques et, conscients de l’existence d’une souffrance chez certains sujets, ont
proposé des lieux d’accueil démédicalisés et dépsychiatrisés où néanmoins l’expérience du
voyage psychotique pourrait être vécue jusqu’à ses ultimes limites, dans un climat
bienveillant et sécurisé qui rappelait celui des « retraites » ouvertes au 19ème siècle par des
quakers anglais. Valorisant la psychose dans une perspective surréaliste, ces
« antipsychiatres » stricto sensu, ont refusé d’assumer les dimensions sociales du métier, la
protection de la société concomitante au soin du malade, cette double vocation qui fait toute
la difficulté de la psychiatrie surtout publique. Si nombre de leurs tentatives ont versé dans
un méli-mélo anarchique et se sont éteintes avec la disparition de leurs fondateurs, elles ont
apporté à l’ensemble des expérimentations qui se développaient alors au sein des
« institutions intermédiaires » un souci d’accompagner le malade dans une grande proximité
avec lui et un respect pour la fonction réparatrice du symptôme. Au même moment, ces
institutions bénéficiaient, sur le plan théorique, des critiques des philosophes qui invitaient à
replacer la psychiatrie dans son histoire et à dépister, grâce aux enseignements historiques,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%