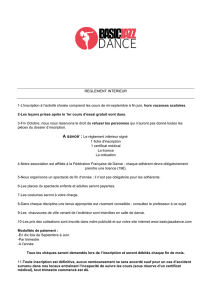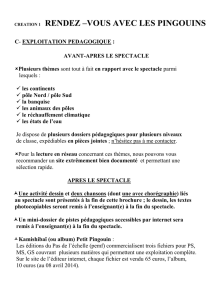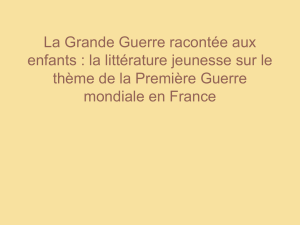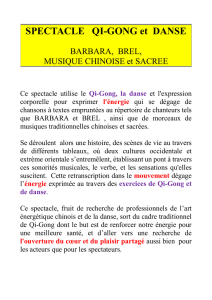la scène et la terre - Maison des Cultures du Monde

LA SCÈNE ET LA TERRE
QUESTIONS D’ETHNOSCÉNOLOGIE

Collection dirigée par Hubert Nyssen et Sabine Wespieser
© Maison des cultures du monde, 1996
ISBN 2-7427-0661-5
Illustration de couverture :
Louis Soutter, Souplesse (détail), 1939
Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts
INTERNATIONALE DE L’IMAGINAIRE
NOUVELLE SÉRIE – N° 5
LA SCÈNE
ET LA TERRE
QUESTIONS D’ETHNOSCÉNOLOGIE
MAISON DES CULTURES DU MONDE

SOMMAIRE
Préface par Chérif Khaznadar
et Jean Duvignaud...................................................... 9
OUVERTURE....................................................................................... 11
Jean-Marie Pradier :
Ethnoscénologie : la profondeur des émergences
....... 13
Gilbert Rouget :
Questions posées à l’ethnoscénologie ....................... 43
Mike Pearson :
Réflexions sur l’ethnoscénologie......................... 55
Patrice Pavis :
Analyse du spectacle interculturel....................... 65
Lucia Calamaro :
Ethnoscénologie : notes sur une avant-première......
81
Rafaël Mandressi :
L’ethnoscénologie ou la cartographie de
Terra incognita............................................................ 91
Jean Duvignaud :
Une piste nouvelle ............................................... 107
TERRITOIRES ............................................................................ 111
André-Marcel d’Ans :
Imiter pour ne pas comprendre............................ 113
Mercédès Iturbe :
Le théâtre paysan au Mexique ............................ 137
Armindo Bião :
Questions posées à la théorie – une approche
bahianaise de l’ethnoscénologie .......................... 145
Mel Gordon :
Ethnoscénologie et performance studies ............. 153
Françoise Gründ :
Le tchiloli de São Tomé (Inventer un territoire
pour exister) ........................................................ 159
Aboubakar Njassé N’joya :
Fêtes des funérailles chez les Bamum .................. 177
Jacques Binet :
Métissages culturels au Gabon............................ 185
Jean-Pierre Corbeau :
Les acteurs du partage alimentaire répètent-ils ? 195
Roger Assaf :
Al-hakawati......................................................... 205
Jamil Ahmed :
Le Bangladesh, scènes mêlées ............................. 211
Marian Pastor Roches :
Le sublik des Philippines .................................... 231
Françoise Champault :
Japon et ethnoscénologie, quelques
considérations linguistiques ................................ 237
Thomas Richards :
Travail au Workcenter de Jerzy Grotowski ......... 245
Piergiorgio Giacche :
De l’anthropologie du théâtre à l’ethnoscénologie 249
Farid Paya :
L’espace du visible .............................................. 255
Stefka Kaleva :
Les médias en question ....................................... 259
L’ACTE DE FONDATION.......................................................... 263
Allocutions de Claude Planson, Lourdes Arizpe,
Irène
Sokologorsky, Jacques Baillon, Chérif Khaznadar
Conclusion par Lourdes Arizpe........................... 281
LA SCÈNE ET LA TERRE
Au fil des siècles, l’Homme, dit-on, a construit plus de
tombes pour les morts que de maisons pour les vivants.
Pas seulement des tombes – des temples pour les puis-
sances cachées ou pour un dieu inconnu, des formes,
des figures, des sons rythmés et de multiples dramatisa-
tions rituelles. Comme si l’imagination répondait d’une
manière chaque fois différente aux énigmes d’un Sphinx
menaçant…
Toutes les cultures esquissent ainsi les scénarios, tan-
tôt sommaires, tantôt sophistiqués de l’inquiète conju-
ration de la nature, de l’inconcevable, parfois du néant :
une théâtralisation collective contre l’innommable.
Ce serait une tâche exaltante que celle de recueillir,
de comparer, de comprendre ces multiples représen -
tations – d’où germent peut-être ensuite les mythes, les
légendes, les aspects divers de la création artistique.
On
peut tenter l’étude de ces matrices avec lesquelles
l’homme, après tout, devient humain.
CHÉRIF KHAZNADAR & JEAN DUVIGNAUD

OUVERTURE

JEAN-MARIE PRADIER
ETHNOSCENOLOGIE :
LA PROFONDEUR DES EMERGENCES
Le fonds commun de l’humanité est à la disposition de
chacun. Il donne la chance de multiplier les voies de la
connaissance dont aucune à elle seule n’est en mesure de
conduire au cœur de la complexité humaine. Aussi,
convient-il de ne pas s’arrêter outre mesure à la dénomi-
nation de l’ethnoscénologie, cadeau des Grecs évocateur
de la dimension organique de l’activité symbolique, et de
l’extrême diversité de ses formes. Ce néologisme a été
forgé selon les conventions coutumières qui entretiennent
l’extension du vocabulaire savant lorsque la nécessité
apparaît de désigner un objet, une méthode, un champ
nouveaux. Des trois formants qui composent le mot
ethno-scéno-logie, le déterminé central (scéno) est le plus
charnu sémantiquement, et partant, le plus problématique.
Il fallait que le signe précise l’objet de la discipline dans
une perspective universelle qui transcende les particula-
rismes culturels. C’est pourquoi, toute référence à une
forme particulière a-t-elle été rejetée pour garder l’idée
centrale d’incarnation du symbolique, insistant sur le fait
que “rien d’humain n’est tout à fait incorporel1”
(Mer
leau-Ponty). Le terme grec
¨
κηνη (skênê) a paru
satisfaisant y compris par son histoire qui l’a conduit à
s’associer à certaines pratiques spectaculaires. A l’ori-
gine, il signifie un bâtiment provisoire, une tente, un
pavillon, une hutte, une baraque. Par la suite le mot a
pris parfois le sens de temple et de scène théâtrale. La
¨
κηνη (skênê) était le lieu couvert invisible aux yeux
du spectateur, où les acteurs mettaient leurs masques.
Les sens dérivés sont nombreux. Le banquet fut l’un
d’eux, et les repas pris sous la tente. La greffe de la
nourriture n’est pas ici sans intérêt si l’on songe à la
liaison qu’elle entretient avec le spectacle dans de nom-
breuses cultures. L’espace théâtral au Japon ne fut-il
pas celui d’un banquet1?
La métaphore engendrée par le substantif féminin
a donné le mot masculin de
¨
κηνο
¨
(skénos) : le
corps humain, en tant que l’âme y loge temporaire-
ment. En quelque sorte le “tabernacle de l’âme”,
l’habitat de la ψυχη (psukhê), le “corps de l’esprit”
(Valéry). Ce sens apparaît chez les présocratiques.
Démocrite et Hippocrate y ont recours (Anatomie, I).
La racine a également donné le mot skhnwma (ské-
noma) qui signifie aussi le corps humain. Quant aux
mimes, jongleurs et acrobates, femmes ou hommes
ils se produisaient au moment des fêtes dans des
baraques provisoires
¨
κηνωματα (skénomata), équi-
valents de nos “théâtres forains” (Xénophon, Hellé-
niques, VII, 4, 32).
Εθνο
¨
(ethnos) souligne l’extrême diversité des
pratiques et leur valeur, en dehors de toute référence
à un modèle dominant. Toutefois la banalisation de
ce formant dans de nombreux composés ne doit pas
faire esquiver l’ambiguïté et les malentendus dont il
est porteur. D’usage ecclésiastique, l’expression
ethnie a longtemps dénoté les peuples païens, par
opposition aux chrétiens. La laïcisation du terme
n’a pas effacé les traces d’exclusion dont il est por-
teur. L’exotisme restant une valeur sûre, même pour
les anthropologues1(Michel Panoff, 1986), il est
nécessaire de préciser : ethnos, dans ethnoscénolo-
gie, ne désigne pas les “formes traditionnelles”, ni
les pratiques des autres. Tout au contraire, le pré-
fixe écarte a priori toute tentation ethnocentriste2
pour inclure un corpus universel riche de “l’aventure
de milliers de civilisations, de sociétés, de langues,
de religions, de coutumes à travers 4 millions
d’années, 70 milliards d’hommes et 200 000 géné-
rations3”.
Pour ce qui est du formant “logie” – Λογια (logia)
–,
les ombres de la compréhension s’effacent dans
l’une de ses acceptions courantes qui implique l’idée
d’étude, de description, de discours, d’art et de
science.
13 14 15
1. Michel Panoff, “Une valeur sûre : l’exotisme”, L’Homme, n° 97-
98, janvier-juin 1986, XXVI (1-2), p. 287-296.
2. A laquelle il est difficile d’échapper, comme le montrent les pre-
mières définitions de l’ethnomusicologie ou de l’ethnochorégraphie
(La Meri, “The Ethnological Dance Arts”, in Walter Sorell [ed.],
The Dance has Many Faces, Columbia University Press, New
York & London, 1951, second edition, p. 3-11.)
3. Yves Coppens, Leçon inaugurale au Collège de France, chaire
de paléoanthropologie et préhistoire, vendredi 2 décembre 1983,
Collège de France, 1984, p. 32.
1. Maurice Merleau-Ponty, La Nature, notes de cours du Collège de
France (établi et annoté par Dominique Séglard), coll. “Traces
écrites”, Le Seuil, 1995, p. 380.
1. Masao Yamaguchi, “La dimension cosmologique du théâtre japo-
nais” (Fondation Wenner-Gren, New York, mai 1982), Internatio-
nale de l’imaginaire, n° 4, hiver 1985-1986, p. 12.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%