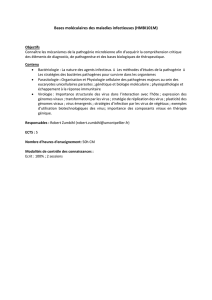Risque xénozoonotique viral et xénotransplantation

Le Courrier de la Transplantation - Volume I - n
o
1 - avril-mai-juin 2001
28
!L. Bélec1, 2, A. Szalat 2
Recherche
a xénotrans-
plantation, ou
transplantation
d’organes, de tissus
ou de cellules
d’une espèce à une
autre (i.e. de pri-
mates non humains
ou du porc à
l’homme), est consi-
dérée comme une solution possible
pour pallier le déficit d’organes dispo-
nibles en allotransplantation. La xéno-
transplantation possède, a priori, certains
avantages par rapport à l’allotransplanta-
tion (1) :
"elle offre une source d’organes vir-
tuellement inépuisable ;
"elle permet de planifier parfaitement la
transplantation, sans attendre la disponi-
bilité aléatoire du don d’organe ;
"elle n’utilise que des animaux sources
d’organes connus, sélectionnés et contrô-
lés, sur les plans génétique, immunolo-
gique et surtout infectieux ;
"elle permet d’offrir des organes non
humains réfractaires à l’infection par des
virus humains, comme le virus de l’im-
munodéficience humaine (VIH) ou le
virus de l’hépatite B, ce qui pourrait
constituer un avantage, voire une solution
thérapeutique élégante pour certaines
pathologies.
Cependant, la xénotransplantation n’a
pas encore franchi le stade expérimental
des protocoles de recherche préthéra-
peutiques, car de nombreux problèmes,
notamment éthiques, immunologiques
(risque de rejet hyperaigu) et infectieux,
ne sont encore que partiellement résolus.
En effet, comme pour l’allotransplanta-
tion, le succès de la xénotransplantation
réside dans l’instauration d’une immu-
nodépression suffisante pour assurer
l’absence de rejet, tout en évitant ou
contrôlant le risque infectieux. Or, la
xénotransplantation réalise une situation
très particulière de court-circuit radical
entre les barrières cutanéo-muqueuses
humaines et animales, ce qui abolit les
défenses inter-espèces naturelles, et réa-
lise une situation quasiment expérimen-
tale d’inoculation à l’homme d’agents
infectieux d’origine animale. De plus, en
xénotransplantation, le risque de contrac-
ter une infection ou de développer une
maladie clinique chez le receveur est, a
priori, plus élevé qu’en allotransplanta-
tion, car l’immunosuppression médica-
menteuse nécessaire à la tolérance de
l’organe greffé doit être plus importante ;
l’immunodépression induite favorisera
indirectement l’adaptation du virus à son
hôte. L’expression de gènes humains
introduits chez des porcs transgéniques
pourrait également faciliter l’adaptation
des virus animaux aux tissus humains de
façon anticipée. Enfin, les conséquences
infectieuses de la xénotransplantation ne
sont pas seulement individuelles : elles
présentent également une dimension col-
lective, qui laisse profondément dubita-
tif (2-7). En effet, l’émergence chez
l’homme de nouvelles maladies infec-
tieuses virales ou apparentées est géné-
ralement due au passage d’agents patho-
gènes du réservoir animal naturel à
l’homme (8). Des exemples récents, frap-
pants et spectaculaires, sont l’émergence
de l’épidémie d’infection à VIH, ou
encore de cas de maladie de Creutzfeldt-
Jakob à nouveau variant. À ce titre, de
nombreuses anthropozoonoses poten-
tielles pourraient émerger du réservoir de
virus abrité par la forêt tropicale. Le pas-
sage d’un virus à l’homme est un événe-
ment rare, car il existe de puissantes bar-
rières d’espèces naturelles. Une fois
passé à l’homme, le virus s’adapte à la
niche écologique, pour devenir rapide-
ment un nouvel agent pathogène de l’es-
pèce humaine, possédant ses propres
voies de transmission interindividuelle.
La probabilité de passage à l’homme
d’un agent pathogène animal dans le cas
de la xénotransplantation est infiniment
plus élevée que celle d’émergence d’une
zoonose inédite à partir d’un virus pré-
sent au sein de la forêt intertropicale. En
effet, dans ce contexte très particulier, les
barrières naturelles inter-espèces sont
abolies, les défenses de l’hôte sont
diminuées durablement (immunodépres-
sion iatrogène) et le nombre de virus ani-
maux potentiellement xénozoonotiques,
notamment les rétrovirus endogènes
(RVE), est énorme. En conclusion, tout
laisse à penser que le risque infectieux
potentiel lié à la xénotransplantation
pourrait être supérieur à celui lié à l’allo-
transplantation.
Le risque infectieux en xénotransplanta-
tion concerne, d’une part, les agents
infectieux classiques présents chez le
receveur, qui développent une virulence
de nature opportuniste, comme en allo-
transplantation, et, d’autre part, les agents
infectieux, connus ou inconnus, propres
à l’espèce animale source d’organe, qui
passent chez le receveur. La transmission
inter-espèces d’agents infectieux de l’ani-
mal à l’homme dans des conditions natu-
relles est à l’origine de nombreuses zoo-
noses bien connues (comme la rage, la
fièvre jaune, les infections à Monkeypox
ou à hantavirus), ou inédites (comme
celle associée au nouveau variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob). La trans-
mission d’agents infectieux de l’animal
à l’homme au cours de la xénotransplan-
tation, qui n’est pas une situation de zoo-
nose naturelle, est à l’origine de “xéno-
zoonoses”,dont les xénozoonoses virales
sont les plus fréquentes (1, 9, 10).
1Service de microbiologie, hôpital européen
Georges-Pompidou, 75015 Paris.
2Unité INSERM U430, hôpital Broussais,
75014 Paris.
L
Risque xénozoonotique viral
et xénotransplantation

Le Courrier de la Transplantation - Volume I - n
o
1 - avril-mai-juin 2001
29
Recherche
Les xénozoonoses virales montrent
d’emblée des caractéristiques préoccu-
pantes, comme la possibilité de persis-
tance virale, les facultés de dérive géné-
tique et d’adaptation à l’hôte, la
transmission interindividuelle et verticale
et le manque de thérapie réellement effi-
cace. Les xénozoonoses virales peuvent
être schématiquement classées en trois
catégories : les xénozoonoses virales
classiques de l’animal à l’homme, les
xénozoonoses à micro-organismes ani-
maux qui ne sont pas impliqués dans une
zoonose naturelle et les xénozoonoses à
micro-organismes inconnus, émergents
ou inédits.
Nous détaillerons par la suite les xéno-
zoonoses virales au cours des greffes à
partir d’organes du porc, qui sont les ani-
maux représentant actuellement la
meilleure source potentielle d’organes
pour l’homme, et à partir du babouin, en
insistant sur la problématique des infec-
tions rétrovirales endogènes.
XÉNOZOONOSES À AGENTS
ZOONOTIQUES CONVENTIONNELS
Elles sont occasionnées par des agents
infectieux d’origine animale associés à
des zoonoses naturelles. Les consé-
quences cliniques et biologiques de ces
infections sont connues chez l’animal
comme chez l’homme, et des techniques
de diagnostic validées sont souvent dis-
ponibles. En pratique, il est possible de
sélectionner les animaux sources d’or-
ganes en xénotransplantation, indemnes
de ces agents infectieux, selon des recom-
mandations très précises mises à jour
régulièrement (11).
Les principaux agents infectieux en cause
chez le porc sont le virus herpétique por-
cin, le virus influenza, le virus de la peste
porcine. Le virus de l’hépatite E porcine
(HEVP), appartenant à la famille des
Caliciviridae, est de découverte récente.
Chez le porc, ce virus est latent et asymp-
tomatique. Il constitue un agent zoono-
tique (12). En effet, il se transmet à
l’homme, soit de façon latente et asymp-
tomatique, soit en provoquant une hépa-
tite virale. À Taiwan, le HEVP pourrait
constituer un réservoir d’infection pour
l’homme, et la transmission inter-espèces
pourrait expliquer la forte prévalence de
la séropositivité vis-à-vis des antigènes
du virus de l’hépatite E dans la popula-
tion générale (13). Chez deux malades
vivant aux États-Unis, les HEVP
(souches US-1 et US-2) présentaient
97 % d’homologie génétique avec le
virus de l’hépatite E (12). La transmis-
sion inter-espèces de l’HEVP est prou-
vée, et pourrait aussi avoir lieu en cas de
xénotransplantation.
Chez le singe, le Simian Immunodefi-
ciency Virus (SIV) est capable d’infec-
ter in vitro les lymphocytes et macro-
phages humains ; in vivo, deux cas de
contamination asymptomatique chez
des laborantins ont été rapportés (14).
L’imputabilité du SIV dans l’émergence
de l’épidémie d’infection à VIH est
actuellement une des hypothèses les plus
solides qui ferait du sida une zoonose,
puisque la souche SIVcpz serait à l’ori-
gine du VIH de type 1, et que la souche
SIVsm serait à l’origine du VIH de
type 2. Ces observations indiquent clai-
rement que la transmission du SIV lors
d’une xénotransplantation est suscep-
tible d’aboutir à une xénozoonose virale
grave. Le Simian T-Lymphotropic Virus
de type 1 (STLV-1) est génétiquement
apparenté au Human T-Lymphotropic
Virus ; les transmissions inter-espèces
entre singes, et du singe à l’homme, du
STLV-1 sont prouvées. Ainsi, les SIV et
STLV sont des virus potentiellement
transmissibles lors d’une xénotrans-
plantation : ils doivent être systémati-
quement dépistés chez l’animal donneur
d’organe. La prévalence du Simian
Foamy Virus (SFV), un virus de la sous-
famille des Spumaviridae, est impor-
tante chez les primates non humains :
elle est de l’ordre de 90 % dans les colo-
nies de babouins capturés et placés en
élevage. Il s’agit d’un agent zoonotique
transmis fréquemment chez les indivi-
dus exposés professionnellement aux
primates non humains. Bien que l’in-
fection à SFV chez l’homme soit
bénigne à court terme, l’apparition tar-
dive d’une maladie spécifique n’est pas
exclue. Les xénotransplantations utili-
sant des organes de babouins infectés
par le SFV transmettraient probable-
ment le virus, avec un risque ultérieur
d’expression clinique qui demeure
inconnu.
XÉNOZOONOSES À AGENTS
ZOONOTIQUES POSSIBLES
Il peut s’agir d’infections occasionnées
par des micro-organismes pathogènes
(comme le cytomégalovirus porcin ou le
cytomégalovirus du babouin) ou non
pathogènes (comme le circovirus porcin),
considérés comme spécifiques de leur
hôte animal naturel, mais qui seraient
susceptibles d’acquérir un caractère viru-
lent pour l’homme. Il s’agit, de fait, d’une
pseudo-spécificité d’espèce, avec un
risque de développement et de dissémi-
nation de zoonose chez le receveur de
xénotransplant.
Xénozoonose associée
aux rétrovirus endogènes
du primate et du porc
Le risque de contamination du receveur
par un rétrovirus endogène provenant du
greffon animal constitue le risque infec-
tieux lié à la xénotransplantation dont les
conséquences pourraient être des plus
graves.
Les RVE constituent des génomes rétro-
viraux fossiles, secondaires à d’anciennes
infections des cellules de la lignée ger-
minale (15). Des RVE sont intégrés dans
le génome de tous les mammifères sous
la forme d’un provirus à ADN. Ils sont
hérités de façon permanente et transmis
verticalement de façon mendélienne, des
parents aux enfants. Les RVE sont sou-
mis à la même fréquence de mutations
que les gènes cellulaires. Chaque espèce
de mammifère en abrite plusieurs cen-
taines. Les RVE représentent, par
exemple, environ 2 % du génome
humain. Les RVE proviennent d’une
transmission inter-espèces qui s’est pro-
duite à des moments différents selon l’es-
pèce concernée, de sorte que, sur le
plan génétique, les RVE peuvent être
distingués en RVE anciens, insérés au

sein d’une même région du génome de
tous les individus d’une espèce donnée,
et en RVE récents, qui présentent une
grande hétérogénéité quant à leur zone
d’insertion dans le génome des différents
individus d’une même espèce. L’hôte
d’un RVE a développé des mécanismes
variés de résistance, ce qui a pour consé-
quence une expression clinique généra-
lement silencieuse des RVE chez leurs
hôtes naturels. Soulignons que les RVE
de type C ont un pouvoir oncogène en
activant des proto-oncogènes en cisaprès
leur intégration. Les RVE peuvent se
répliquer au sein de leur hôte, et être à
l’origine d’une virémie mesurable.
La présence de RVE dans le génome
des mammifères a des conséquences
variables pour l’hôte, notamment en ce
qui concerne sa sensibilité vis-à-vis des
rétrovirus exogènes. Ainsi, les RVE peu-
vent conférer une résistance de leur hôte
vis-à-vis de rétrovirus exogènes appa-
rentés, par exemple grâce à l’expression
de leur protéine d’enveloppe codée pour
le gène env, qui bloquerait l’interaction
entre le virus exogène et son récepteur
cellulaire. Par ailleurs, un RVE peut deve-
nir exogène dans certaines conditions, la
transmission inter-espèces d’un RVE
entraînant une modification de son poten-
tiel pathogénique. Par exemple, le RVE
de type C de la souris Mus caroli est
directement à l’origine du Gibbon Ape
Leukemia Virus (GALV), un rétrovirus
exogène de type C des primates ; le
GALV est responsable d’une leucémie
pour son hôte secondaire, alors que le
RVE parental est non pathogène pour la
souris (16).
Au cours d’une xénotransplantation,
l’existence de RVE fait craindre la pos-
sibilité de recombinaisons génétiques
entre les génomes de RVE des deux
espèces, avec l’apparition de virus inédits
éventuellement pathogènes pour le rece-
veur. Le passage inter-espèces des RVE
existe naturellement. Comme les condi-
tions associées aux xénotransplantations
sont, a priori, très permissives par rapport
aux conditions naturelles, il est licite de
penser qu’un RVE du singe ou du porc
passera aisément chez l’homme trans-
planté. De plus, le pouvoir pathogène du
RVE xénotransplanté, très souvent (mais
pas toujours) bénin pour son hôte animal
naturel, pourrait être modifié chez son
hôte secondaire. Actuellement, aucune
contamination humaine par un RVE de
babouin ou de porc n’a pu être identifiée,
bien que ces deux espèces animales ren-
ferment un grand nombre de RVE. Ces
constatations ne doivent pas faire sous-
estimer le risque de passage d’un RVE
animal à l’homme ou de la sélection de
variants recombinés en cas de xéno-
transplantation à l’homme d’organes de
babouin ou de porc. Nous allons par la
suite analyser les données récentes
concernant les RVE du babouin et du
porc, afin d’évaluer le risque potentiel
associé aux xénozoonoses rétrovirales
endogènes, si la xénotransplantation
devait être utilisée en thérapeutique
humaine.
!Rétrovirus endogènes du babouin
(BaEV, SERV, PcEV). Au moins trois
RVE ont été identifiés chez le babouin.
Le Baboon Endogenous Retrovirus
(BaEV) est un rétrovirus endogène de
type C présent chez de nombreuses
espèces de primates du vieux monde. Le
BaEV est bénin pour son hôte naturel, et
aucun virus analogue humain n’a été
identifié (17). Cependant, ce virus est
capable de se répliquer in vitro dans les
cellules humaines, suggérant un poten-
tiel infectieux chez l’homme (18,19). De
plus, plusieurs observations in vivo sug-
gèrent que le BaEV possède un potentiel
de transmission inter-espèces (virus
amphotropique). En premier lieu, deux
génotypes de BaEV ont été identifiés au
sein d’espèces simiennes différentes, ce
qui suggère que la transmission entre dif-
férentes espèces de singes habitant la
même région géographique existe (17).
En second lieu, le RD114, un RVE du
félin, est phylogénétiquement très proche
du BaEV, tout en étant éloigné des autres
REV des félins, ce qui suggère une trans-
mission inter-espèces d’un ancêtre du
BaEV au félin il y a plus de 3 millions
d’années (20). Ces observations suggè-
rent que la xénotransplantation à partir
d’organes de babouins pourrait être asso-
ciée à la transmission à l’homme de RVE
ayant un tropisme pour les cellules
humaines, donc potentiellement patho-
gènes, voire oncogènes, et dont la trans-
mission intra- comme inter-espèces est
possible.
Le Simian Endogenous Retrovirus
(SERV) de type D, jusqu’alors trouvé
uniquement chez les macaques atteints
du syndrome d’immunodéficience
acquise simienne, a été identifié chez les
babouins destinés à la recherche biomé-
dicale (21). Le SERV précède phylogé-
nétiquement le BaEV, et lui a fourni une
partie du gène env.Le SERV pourrait être
transmissible à l’homme au cours de la
xénotransplantation, puisqu’il présente
une charge provirale élevée chez le
babouin infecté, et que près de 5 % des
babouins d’élevage en sont infectés (22).
Enfin, un autre rétrovirus de type C, le
Papio Cynocephalus Endogenous Retro-
virus (PcEV), a été récemment décrit
chez le babouin (23) ; ce virus ferait
partie des “ancêtres” du BaEV.
En conclusion, de nombreux RVE ont été
trouvés chez le babouin. Il en existe cer-
tainement d’autres. Si leur caractère
transmissible à l’homme est probable,
leur caractère pathogène pour l’homme
n’est pas connu. Le babouin a été désor-
mais écarté des protocoles de xéno-
transplantation, notamment en raison
des risques infectieux potentiels pour
l’homme, surtout ceux associés aux RVE.
!Rétrovirus endogènes du porc
(PERV)
"Infection in vitro de cellules
humaines par les PERV. Le porc appa-
raît comme l’animal le plus adapté pour
la xénotransplantation, pour des raisons
à la fois économiques (coût raisonnable)
et physiologiques (adaptation des organes
transplantés à la physiologie humaine).
Ce choix pourrait être remis en question
du fait de la découverte de nombreux
RVE porcins, encore dénommés
“PERV”, et de la démonstration récente
que les PERV pouvaient infecter les cel-
lules humaines in vitro (24, 25).Ainsi, le
“PERV-PK”, un RVE de type C isolé à
partir des lignées cellulaires PK15 de rein
Le Courrier de la Transplantation - Volume I - n
o
1 - avril-mai-juin 2001
30
Recherche

Le Courrier de la Transplantation - Volume I - n
o
1 - avril-mai-juin 2001
31
Recherche
porcin, a un tropisme pour les cellules
humaines (caractère amphotropique).
Deux variants du PERV-PK (PERV-A et
PERV-B), divergeant dans le gène env,
sont ainsi capables d’infecter producti-
vement in vitro des cellules humaines,
incluant des lymphocytes B et T. Ces
deux variants sont ubiquitaires, présents
dans les lignées cellulaires porcines de
cœur et de rein. De plus, les cellules
mononucléées périphériques sanguines
de porc répliquent activement le PERV in
vitro ; le virus produit est capable d’in-
fecter les cellules de rein embryonnaire
humaines U293 (photo) et les cellules de
lignée Hela (26). Les cellules endothé-
liales aortiques porcines produisent des
particules de PERV (27). Enfin,des ARN
messagers des PERV-A et -B peuvent être
mis en évidence au sein des cellules
endothéliales aortiques porcines, et aussi
au sein des hépatocytes et des cellules
épithéliales pulmonaires provenant de
plusieurs espèces de porcs élevés dans
des conditions différentes et en des lieux
différents, ce qui démontre le caractère
ubiquitaire de l’infection à PERV chez le
porc. Mentionnons que le PERV-MP
(PERV-C), un autre RVE génétiquement
proche du PERV-PK, n’infecte que les
cellules d’origine porcine (caractère éco-
tropique).
La présence de PERV au sein des cellules
endothéliales aortiques porcines est
importante à considérer, puisque l’endo-
thélium du réseau vasculaire du tissu por-
cin greffé constituera la principale inter-
face avec les lymphocytes du receveur,
ce qui pourrait constituer une source de
RVE porcins chez le receveur. Notons
que la xénotransplantation de cellules
endothéliales aortiques porcines au
babouin ne semble pas être associée à la
transmission de PERV, même en cas de
forte immunosuppression ; de fait, les
expérimentations in vitro ont montré que
les lignées lymphocytaires du babouin
sont résistantes aux PERV (10).
"Études in vivo du pouvoir pathogène
pour l’homme des PERV. Le caractère
pathogène in vivo des PERV est un élé-
ment fondamental à prendre en considé-
ration pour évaluer le risque associé à ces
virus en xénotransplantation. Chez le
porc, les PERV sont orphelins de mala-
dies identifiées ; cependant, le dévelop-
pement de lymphomes est corrélé au
niveau de réplication des RVE de type C,
en cas d’irradiation de l’animal. D’une
façon générale, les RVE de type C ont un
potentiel oncogène, comme certains RVE
génétiquement proches des PERV asso-
ciés à des tumeurs myéloïdes chez leur
hôte naturel (28).
Chez l’homme, l’utilisation d’organes de
porc en xénotransplantation semble théo-
riquement moins risquée que celle d’or-
ganes de babouin en termes de transmis-
sion de RVE, le babouin étant plus proche
de l’homme que le porc.
Cependant, il existe encore
trop peu d’informations à ce
sujet.
Patience et al. n’ont pas mis
en évidence d’infection à
PERV chez deux personnes
ayant été mises en contact
par dialyse avec un rein por-
cin avant de bénéficier
d’une allogreffe : il n’existait pas de cel-
lules porcines circulantes, ni d’évidence
d’une séroconversion en anticorps spéci-
fiques dirigés contre des antigènes de
PERV chez les deux malades dialysés
(29). Ces deux observations ne corres-
pondent cependant pas à une véritable
xénotransplantation : non seulement les
deux malades n’étaient pas immunodé-
primés, mais, de plus, les contacts tran-
sitoires entre tissus porcins et tissus
humains furent relativement courts (15 à
65 minutes).
Heneine et al. n’ont rapporté aucun
stigmate d’infection à PERV chez
10 malades diabétiques, près de 7 ans
après qu’ils aient reçu des cellules pan-
créatiques provenant de porcs non trans-
géniques, et malgré l’immunodépression
iatrogène (30). En particulier, la détec-
tion en PCR de deux séquences des gènes
gag et pol spécifiques des PERV demeu-
rait négative dans les lymphocytes san-
guins 4 à 7 ans après la xénotransplanta-
tion. Les marqueurs de réplication du
PERV (activité transcriptase inverse et
détection de l’ARN génomique par
amplification génique) étaient négatifs
dans le plasma prélevé précocement (3 à
180 jours) ou tardivement (4 à 7 ans)
après la greffe.
Paradis et al. ont évalué la possibilité de
transmission inter-espèces de PERV
chez 160 malades âgés de 2 à 77 ans
ayant été en contact pendant un temps
variable (de quelques minutes à plus de
450 jours) avec différents tissus ou
organes porcins au cours d’une perfusion
hépatique extracorporelle (n = 1), de per-
fusions rénales extracorporelles (n = 2),
d’utilisations de foies bioartificiels
(n = 28), de greffes d’îlots de pancréas
(n = 14), de greffes de peau (n = 15) et
de perfusions spléniques extracorpo-
relles (n = 100) (31). Des échantillons de
Photo. Particules de rétrovirus endogène porcin (PERV-A) bourgeonnant à partir
d’une culture de cellules rénales embryonnaires humaines.

Le Courrier de la Transplantation - Volume I - n
o
1 - avril-mai-juin 2001
32
Recherche
sang et de salive ont été analysés jusqu’à
12 ans après la fin de l’exposition aux
tissus porcins. L’infection à PERV
a été recherchée par PCR détectant
l’ADN proviral, RT-PCR détectant le
génome viral ARN, et Western-Blot à la
recherche d’anticorps spécifiques contre
le PERV. Aucun de ces marqueurs ne
s’est révélé positif, même chez les
malades immunodéprimés. Cependant,
l’ADNmt porcin et des séquences cen-
tromériques porcines pouvaient être
identifiés par PCR dans les cellules
mononucléées circulantes de 23 des
100 malades ayant bénéficié d’une
circulation splénique extracorporelle,
incluant un malade pour lequel l’inter-
vention avait eu lieu plus de 8 ans aupa-
ravant. Ces observations témoignent
d’un microchimérisme (i.e. de la pré-
sence de cellules porcines chez le rece-
veur), d’autant plus inattendu qu’aucun
des malades n’avait reçu de traitement
immunosuppresseur, et probablement lié
à la persistance de cellules porcines, den-
dritiques ou précurseurs d’origine splé-
nique connues pour exprimer un moindre
niveau de l’antigène de surface αGal.
Si les trois études précédentes sont ras-
surantes sur le risque de transmission à
l’homme de PERV, les travaux publiés
en 2000 par van der Laan et al. relancent
les inquiétudes concernant le risque
infectieux lié aux PERV en xénotrans-
plantation (32). En effet, ces auteurs ont
démontré pour la première fois qu’un
PERV pouvait se transmettre in vivo
d’une espèce à une autre, et se répliquer
activement chez son nouvel hôte. Ainsi,
des îlots de Langerhans porcins ont été
greffés chez des souris SCID (Severe
Combined Immunodeficiency) non
obèses et diabétiques. Ces îlots porcins
étaient infectés par le PERV ; ils étaient
capables d’infecter in vitro les cellules
humaines U293. La production de PERV
a été évaluée 18 à 56 jours après une
xénogreffe sous-capsulaire d’îlots de
Langerhans porcins. La production
d’ARN messagers viraux secondaires à
la transcription de l’ADN proviral était
décuplée in vivo au décours de la trans-
plantation, avec un pic au septième jour,
de façon parallèle à l’expression de la
protéine de core p30 de PERV. De plus,
un microchimérisme existait chez 70 %
des souris transplantées, non seulement
dans le tissu transplanté, mais aussi dans
d’autres tissus. Cette étude confirme que
les PERV peuvent infecter des cellules
cibles humaines. Elle démontre que les
PERV sont transmissibles in vivo après
xénotransplantation de tissus porcins
chez la souris SCID, donc dans une autre
espèce, et que plusieurs tissus de la sou-
ris greffée, en dehors du site de trans-
plantation, s’infectent progressivement
au cours du temps, probablement par
propagation de proche en proche à par-
tir de cellules infectées. Ces résultats
constituent un modèle animal de xéno-
transplantation dont les principales
conclusions ne sont pas obligatoirement
applicables à l’homme. Il n’est pas exclu,
en effet, que la souris soit naturellement
plus réceptive à l’infection à PERV que
l’homme.
"Conclusion : PERV et xénotrans-
plantation. La question du risque de
xénorétrovirozoonose à PERV demeure
controversée. La seule étude prouvant la
transmission inter-espèces de PERV in
vivo concerne la souris. Les trois études
rétrospectives in vivo évaluant le risque
de transmission de l’infection à PERV
chez l’homme tirent des conclusions
négatives, ce qui ne prouve pas l’absence
de risque. De fait, le risque d’infection
humaine à PERV au décours d’une xéno-
transplantation est réel pour plusieurs
raisons (10, 15) :
–Les différents variants de PERV sont
capables d’infecter in vitro les cellules
humaines.
– Les PERV sont difficiles à éradiquer du
porc, malgré la constitution d’élevages
exclusivement destinés à la xénotrans-
plantation, en raison de leur caractère
stable et de leur transmission mendé-
lienne.
–Les PERV sont ubiquitaires dans les
organes, tissus ou cellules à transplanter.
–Le diagnostic de l’infection à PERV
reste difficile, l’optimisation de tech-
niques de dépistage fiables est nécessaire
pour le suivi des malades exposés à ce
virus, tout en sachant qu’il est difficile de
faire la part entre le microchimérisme
(identification de PERV secondaires à la
présence de cellules porcines xénogref-
fées) et l’infection des cellules humaines.
–Les RVE de type C sont potentielle-
ment oncogènes.
–La transmission horizontale et verticale
des RVE est possible.
–Enfin, l’identification d’une infection
productive à PERV chez un patient xéno-
transplanté pourrait n’être possible qu’à
distance du contage.
D’autres études prospectives de suivi de
malades xénogreffés avec des organes ou
tissus porcins seront nécessaires pour
évaluer avec précision le risque de trans-
mission des PERV à l’homme ainsi que
leur pathogénicité éventuelle. Des
modèles animaux (souris, rat, chien ou
vison, sans inclure les primates, dont les
cellules sont dépourvues de récepteurs
pour les protéines env des PERV) pour-
raient également être utilisés pour éva-
luer expérimentalement la transmissibi-
lité et la pathogénicité des PERV.
Le passage à l’homme des PERV pour-
rait avoir des conséquences délètères.
D’une part, l’infection humaine à PERV
pourrait être pathogène pour le receveur,
directement ou par la sélection de
variants recombinants inédits. D’autre
part, l’infection humaine à PERV pour-
rait s’accompagner d’une transmission
horizontale et verticale de PERV ou de
variants adaptés parmi les sujets contacts.
Le risque d’infection humaine à PERV
pose donc non seulement le problème du
risque individuel pour les malades xéno-
transplantés, mais aussi le problème
encore plus fondamental des risques col-
lectifs pour les personnes en contact avec
les malades, voire pour l’ensemble de
l’humanité (33). Seule une approche à la
fois scientifique et éthique permettra de
résoudre cette quadrature de l’évaluation
du risque de transmission à l’homme des
RVE au décours des xénotransplanta-
tions.
Xénozoonoses associées
aux Herpetoviridae
De nombreux herpèsvirus sont décrits
chez les primates et le porc ; de nom-
breux autres restent à découvrir. Si cer-
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%