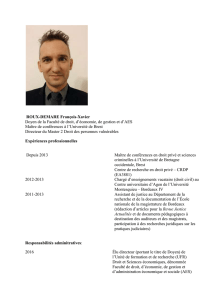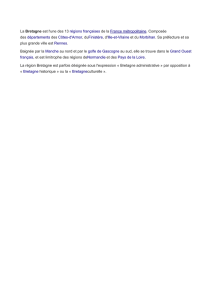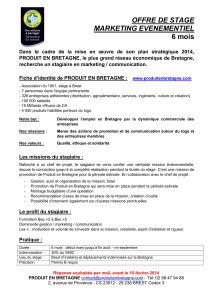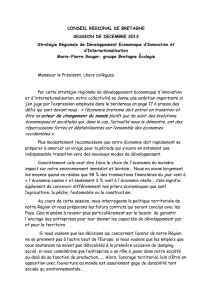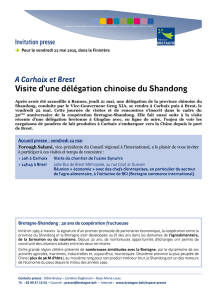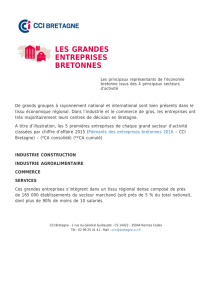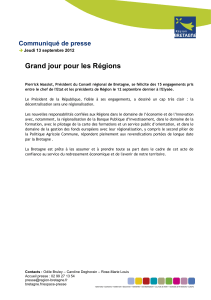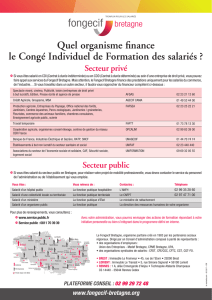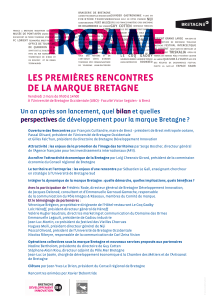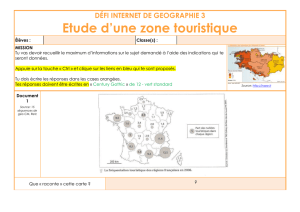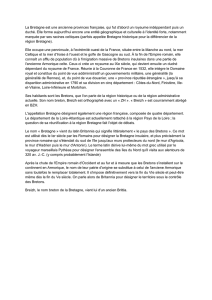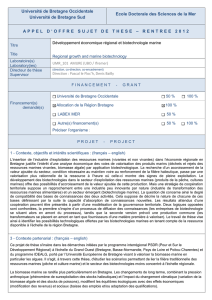lire la suite [DOCX - 79 Ko ]

1
PRIGENT Lionel
Maître de Conférences
Institut de Géoarchitecture,
Université de Bretagne occidentale
6 avenue Le Gorgeu CS 93837
28238 Brest Cedex 3
Mobile : + 33 6 10 13 07 21
Tél. Bureau : + 33 2 98 01 65 81
Fax Bureau : +33 2 98 01 67 21
e-mail : lionel.prigent@univ-brest.fr
État civil
46 ans,
Équipe
24e section (Aménagement et urbanisme)
EA 2219 (Géoarchi : conception, aménagement et gestion
du cadre bâti et de l’environnement : doctrines et
pratiques)
TABLE DES MATIERES
PUBLICATIONS, TRAVAUX DE RECHERCHE ET COMMUNICATIONS
AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
ENSEIGNEMENT
GESTION ADMINISTRATIVE
ÉTUDES ET RECHERCHE
FORMATION
Urbaniste, économiste.
Les thèmes de recherche portent sur les questions relatives aux stratégies de développement des territoires qui reposent
sur leurs caractéristiques et actifs propres, généralement non marchands, comme le patrimoine, le paysage ou les
espaces naturels, traduits en pratiques marchandes (commerce, tourisme). Comment les acteurs des territoires sont-ils
conduits à exploiter les ressources propres de leurs territoires ? Comment utilisent-ils ces aménités dans leurs stratégies
d’aménagement ? Quelles démarches innovantes participent-elles à une meilleure cohésion locale (économie sociale et
solidaire, etc.) ?
L’analyse conduit à rechercher, en présentant des situations nombreuses et singulières, la cohérence et l’uniformité des
pratiques dans un environnement de plus en plus concurrentiel et de plus en plus balisé par des normes de
consommation et de production. Mais cette forme locale de globalisation trouve également ses limites et conduit à
réviser les stratégies de développement. Il s’agit, en définitive, de trouver, dans l’aménagement du territoire, une
dynamique schumpétérienne d’innovations et d’imitations et d’éclairer les décideurs publics sur les risques et les atouts
des modèles qu’ils entendent mettre en œuvre.
Les travaux actuels portent sur les politiques de valorisation et de requalification des actifs patrimoniaux. De nouvelles
réflexions s’attachent aux pratiques commerciales ou aux systèmes de transport public.

2
PUBLICATIONS, TRAVAUX DE RECHERCHE ET COMMUNICATIONS
Publications à comité de lecture
1 « Les caractères affichés et subliminaux du paysage breton. Ou comment l’espace breton qui se donne à
voir aujourd’hui est plus ancien qu’on ne pense et moins « authentique » que l’on croit. Article pour
l’ouvrage collectif « Produire la Bretagne », Belin, à paraître 2016. Co-auteur : Daniel Le Couédic
2 « L’urbanisation profuse saisie par la longue durée. Le cas de la Bretagne ». Article pour les Cahiers de
Géographie du Québec. Numéro de printemps 2014, n° 165, p. 491-508. Co-auteur : Daniel Le Couédic
Résumé : L’acculturation en France du concept américain d’urban sprawl advint tardivement, au terme d’un
cheminement cahoteux qui a fait de l’expression - comme de sa cadette, la périurbanisation -, un épouvantail
visant à bannir toute pratique considérée comme indûment centrifuge eu égard à la conception dominante de
la ville durable. Cette culpabilisation fait généralement litière de la longue durée de l’occupation et du
façonnage des territoires, qui leur confère pourtant de fortes particularités imposant la nuance. Le trajet et les
raisons de cette dérive sont exposés, en préalable à une démonstration, appuyée sur le cas singulier de la
Bretagne, prouvant que l’usage inapproprié de l’expression comme du concept fait porter un opprobre
largement injustifié sur « les villes invisibles » qui caractérisent désormais cette région.
3 « La mise en tourisme de l’imaginaire cinématographique : une promesse audacieuse ». Colloque
interdisciplinaire « Les territoires du cinéma », Angers, 21-24 janvier 2014. Publication à venir. Co-auteur :
Georges-Henry Laffont
Résumé : L’impact du cinéma sur la fréquentation touristique est-elle une nouveauté ? Sans doute pas si l’on
remonte un peu dans le passé. Mais le phénomène semble avoir pris de l’ampleur ces dernières années. Les
catalogues des voyagistes s’enrichissent de ce nouveau thème. Des articles de presse paraissent régulièrement
pour relever un engouement. Enfin, les collectivités locales et même les pays s’organisent pour attirer les
tournages. Le cinéma est-il bien cette vitrine qui peut magnifier l’image d’un territoire et séduire des milliers
de touristes ? Les pratiques de visite qu’il peut favoriser sont-elles signifiantes et relèvent-elles d’un processus
si mécanique qu’il en est avidement espéré ? Les territoires trouvent-t-ils ici un moyen de résister à une
concurrence croissante entre les destinations
4 « La mise en marché du patrimoine mondial : démarche économique ou discours de justification ? ».
Colloque interdisciplinaire « Discours économique, discours du travail, discours du management :
représentation / fiction », Strasbourg, 5-7 mai 2013. In Corinne Grenouillet et Catherine Vuillermot-Febvet
(dir.), La Langue du management et de l’économie à l’ère néo-libérale : formes sociales et littéraires, Presses
Universitaires de Strasbourg, coll. « Formes et savoirs », 2015, p. 129-140.
Résumé : La question générale posée est celle de la force attribuée au discours économique. À partir de ce
thème général du colloque, la communication a tenté de revenir sur les liens complexes entre économie et
patrimoine… En particulier, est interrogée l’idée régulièrement affirmée aujourd’hui d’une exigence plus forte
de mise en valeur, en particulier touristique, des biens patrimoniaux.
5 « Les enjeux touristiques (et économiques) de la reconnaissance au Patrimoine mondial de l’Unesco »,
Revue internationale et stratégique, n° 90, été 2013, p. 127-135.
Résumé : Forte de 962 biens répartis dans 157 États, la liste du patrimoine mondial, portée par l’Unesco,
apparaît comme un incontestable succès pour la promotion et la conservation du patrimoine culturel et
naturel. Malgré des critiques, l’Unesco semble être parvenue à institutionnaliser son rôle et la notion de
patrimoine mondial. Dans une perspective de mondialisation, l’enjeu est devenu essentiel pour nombre de
territoires. L’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial est accueillie avec fierté au sein des États.
Les lauréats, tant à l’échelle nationale que locale, se félicitent de l’annonce qui impliquerait: une
augmentation de la fréquentation touristique et une source de développement économique. Mais alors que l’on
reconnaît l’impact positif sur la protection et la signalisation des sites, on méconnaît l’impact réel sur le
développement économique et social. Il convient donc de revenir sur les caractéristiques de ces biens
patrimoniaux, avant d’apprécier les effets favorables qui sont largement mis en avant par les porteurs des
projets d’inscription, puis d’en discuter la mesure.
6 « Rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel : ambitions et limites d’un projet
d’aménagement ». 2e Conférence internationale « Patrimonium », Clermont-Ferrand, 26-28 septembre 2012.
Texte publié en Actes.
Résumé : À travers une approche économique, qui s’appuie sur l’analyse institutionnaliste, cette
communication se propose d’interroger le processus qui a conduit à dégager au Mont-Saint-Michel un
consensus pour l’action, puis d’évoquer les questions, voire les conflits qui ont été retardés dans le processus.

3
Enfin, il s’agit d’envisager les hypothèses de résolution des problèmes posés et leurs conséquences pour une
gestion et un développement durable du site.
7 « Le Mont-Saint-Michel au péril de la terre ». Notice pour l’Encyclopédie de Bretagne. À paraître.
Résumé : L’opération de « rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel » en cours de
réalisation est le fruit d’une gestion plus que millénaire du site et des discussions plus récentes qui ont
accompagné l’objectif d’un désensablement. Les conséquences sur les activités humaines et les milieux
naturels traduisent la complexité des écosystèmes de la baie.
8 « À qui appartient le Mont-Saint-Michel ? Analyse des controverses autour d’un patrimoine mondial de
l’humanité ». 3e Journées scientifiques du Tourisme Durable, Tours, 21-22 juin 2012. Texte publié en Actes.
Résumé : Depuis quelques mois, le Mont-Saint-Michel fait l’objet d’articles de presse nombreux à propos de
deux sujets : le lieu de départ des navettes entre le stationnement des touristes et l’îlot, la construction
d’éoliennes au large de la baie. Chaque fois, les oppositions se cristallisent sur les effets des décisions pour la
fréquentation touristique. Mais c’est aussi la qualité du site et son image en tant que patrimoine mondial qui
sont invoquées. Ces deux récentes controverses illustrent les problèmes de gestion posés par les sites
patrimoniaux majeurs. Une multitude d’acteurs est impliquée ; chacun détient une forme de légitimité et
exprime des intérêts parfois contradictoires : les opérateurs de l’industrie touristique, les touristes, les
habitants, les élus locaux, les associations militantes, etc. Entre ces partis, les débats sont nombreux pour
concilier aspirations et pratiques, mais le registre mobilisé revendique le plus souvent une défense de l’intérêt
général. De ce point de vue, le cas du Mont-Saint-Michel se révèle particulièrement édifiant. Le
« rétablissement du caractère maritime » est un projet ambitieux qui est le résultat de plus de trente ans
d’enquêtes, d’études, d’engagements et de polémiques. Aujourd’hui, les principes de sa mise en œuvre
éclairent sur les objectifs partagés et les attentes particulières sur un site prestigieux qui accueille chaque
année près de trois millions de visiteurs. À travers une approche économique qui s’appuie sur l’analyse
institutionnaliste, cette communication se propose d’examiner le processus par lequel les motivations
particulières conduisent simultanément à dégager un projet commun, à entretenir des sources potentielles de
conflit, à rendre inopérantes les évaluations classiques pour éclairer les prises de décision.
9 « Le projet urbain du plateau des Capucins à Brest : une aventure patrimoniale pour une ambition
métropolitaine ». In Lucie K. Morisset (dir.), S’approprier la ville. Le devenir-ensemble, du patrimoine
urbain aux paysages culturels, Montréal, 2015, 215-235.
Résumé : Le projet brestois du plateau des Capucins fait surgir de nombreuses interrogations que la
communication se propose d’aborder : sur la démarche de patrimonialisation en cours qui conduit à la
préservation et à la requalification des ateliers des Capucins, mais aussi à y édifier un centre d’interprétation
des savoir-faire techniques brestois liés à la marine ; sur le travail d’appropriation/réappropriation du
territoire par les habitants qui passe par la dimension patrimoniale ; sur la capacité à atteindre les objectifs
de réalisations programmatiques ; enfin, sur la production d’une nouvelle image qui accorde plus d’espace à
la culture et à la création. L’enjeu est clairement ici celui de l’identité de la ville, et de sa capacité à assumer
le statut désormais revendiqué de pôle métropolitain.
10 « L'analyse pluridisciplinaire du paysage : un atout pour l'élaboration des politiques paysagères »,
Poster. Colloque Territoires et environnement, Tours, 8-9 décembre 2011. Co-auteurs : Sébastien Gallet,
Frédérique Chlous, Patrick Dieudonné, Lionel Prigent, Claire Jusseau.
11 « Les villes dans le patrimoine mondial : ambiguïté économique d’une démarche de mercatique
urbaine ». Colloque international & interdisciplinaire « Labellisation et mise en marque des territoires »,
Clermont-Ferrand, 8, 9 et 10 novembre 2011. Actes publiés en 2014. Ouvrage collectif, sous la direction de
Mauricete Fournier, CERAMAC, décembre 2014, 636 p., p. 169-183.
Résumé : La ferveur patrimoniale a-t-elle favorisé un regain d’intérêt pour les centres historiques qui se
traduit par des évolutions sociales et économiques. Si les villes inscrites au patrimoine mondial ne sont pas les
seules à connaître de telles évolutions, la labellisation, et les processus préparatoires qui l’ont accompagnée,
semblent avoir renforcé le phénomène. Mais les transformations se sont aussi accompagnées de pratiques
foncières et commerciales qui ont conduit au paradoxe d’une homogénéisation de l’offre dans des cadres
pourtant singuliers.
C’est pourquoi, revenir sur les multiples dimensions économiques du patrimoine, mais aussi sur les dispositifs
spécifiques du signal que constitue une labellisation, permet, dans cette communication, d’interroger les effets
induits, non plus seulement sur le tourisme ou l’image de la ville, mais sur les dimensions commerciales et
immobilières. Les cas de Lyon et de Bordeaux pourront être particulièrement observés, en comparaison de
Rennes, qui a réhabilité son centre historique sans démarche de labellisation.

4
12 «Des « Vieilles Charrues » à la démarche technopolitaine. Comment le Centre Ouest Bretagne échappe-
t-il à un développement conventionnel ? », Conférence devant les élus du pays du Centre Ouest Bretagne, à
l’occasion de la journée annuelle de formation, Rostrenen, 19 octobre 2011.
Résumé : Le centre Ouest Bretagne a une longue tradition de résistance au déclin annoncé. La conférence,
prononcée devant les élus du territoire comprend trois parties : un résumé des statistiques et des images
habituelles du territoires, confortant l’idée d’un déclin ; le relevé de tendances plus positives, traduisant un
possible retournement en cours ; enfin, la dernière partie tente d’expliquer les raisons possibles de ces
retournements et de donner sens, dans une lecture économique et historique, aux démarches nombreuses qui
ont animé le territoire depuis près de 50 ans.
13 « Le Patrimoine mondial est-il un mirage économique ? Les enjeux contrastés du développement
touristique », Revue Téoros (2011, vol. 30, n° 2, p. 6-16), Université du Québec à Montréal.
Résumé : La liste du patrimoine mondial de l’UNESCO est réputé reposer sur des principes d’universalité.
Mais ses contempteurs observent que la multiplication des sites inscrits par l’organisation internationale, puis
l’élargissement des critères d’inscription, s’accompagnent d’une spécialisation de plus en plus forte vers le
tourisme. Bien que le phénomène touristique semble prendre une place croissante dans les préoccupations
patrimoniales, il reste insuffisant pour expliquer l’inflation patrimoniale dans laquelle l’UNESCO a pris sa
part. La complexité de la dimension patrimoniale ne saurait se réduire à une préoccupation économique,
même si les questions de mise en valeur et d’utilisation du patrimoine restent plus que jamais posées.
14 « Pourquoi faut-il sauver Venise des eaux ? Pourquoi faut-il rendre au Mont-Saint-Michel son
insularité ? Panser le passé comme un présent pour demain », Actes du second colloque fédérateur de
l’Institut des Sciences de l’Homme de la Société « Penser le présent comme un passé pour demain », Brest, 15
et 16 décembre 2010.
Résumé : Pourquoi faut-il sauver Venise des eaux ou le Mont-Saint-Michel de l’ensablement ? Les possibilités
de controverse sur un tel sujet ne manquent pas. Leurs évitements impliquent de trouver un arbitrage sur la
place de la nature à la fois revendiquée et dépassée. Mais il faut aussi envisager le bon équilibre entre les
mises en valeur économique et la conservation, autrement dit entre exploitation et sanctuarisation, démarches
souvent hâtivement résumées par le développement d’un tourisme de masse, dans le premier cas, et la
préservation d’un héritage culturel et d’une authenticité par une sévère protection, dans le second cas. Tant
pour l’exemple de Venise que pour celui du Mont-Saint-Michel, il devient essentiel d’interroger les raisons qui
conduisent à un apparent mais fragile consensus pour passer à l’action.
15 « Des Vieilles Charrues à l’écopôle écoconstruction, comment Carhaix tente d’échapper à l’économie
résidentielle ? », Colloque international « Villes petites et moyennes, un regard renouvelé ». Tours, 9 et 10
décembre 2010.
Résumé : Proches de grandes villes bretonnes (Quimper, Brest, Lorient, Saint-Brieuc), Carhaix-Plouguer
cherche son destin. Elle s’est d’abord inventé un territoire : le centre Ouest Bretagne. Elle multiplie depuis les
initiatives de structuration et d’animation, depuis le festival des Vieilles Charrues, dont la place dépasse
largement celle d’une fête annuelle, jusqu’à la mise en œuvre d’une démarche technopolitaine sur
l’écoconstruction. La communication est un éclairage porté sur les différentes initiatives qui ont été menées et
son espace d’influence à partir du croisement d’une analyse historique et d’une analyse économique et
politique qui a pour but de mieux cerner les enjeux, les attentes et les stratégies, dans un contexte
contemporain qui promet un avenir difficile. Il s’agit de comprendre l’originalité d’une démarche, en évoquant
les moyens mis en œuvres, les motivations, mais aussi les résultats observés.
16 « Le savant, l’ingénieur et le marchand. Une fable contemporaine sur la gestion patrimoniale », Actes du
colloque « Villes et territoires réversibles », Cerisy-la-Salle, du 20 au 27 septembre 2010, sous la direction de
Franck Scherrer et Martin Vanier. Paru en 2013.
Résumé : Le projet de gestion patrimoniale du Mont-Saint-Michel a mis plus de trente ans à devenir réalité.
De nombreux conflits ont émaillé le processus de décision, portés par les acteurs qui portaient, à un titre ou un
autre, une appropriation du territoire. Pourtant, aujourd’hui, ces conflits sont en passe de s’estomper afin de
laisser place à un consensus minimal, sans discussion sur les finalités du projet.
17 « Paris nous appartient. La ville peut-elle se transformer en décor urbain ? », Revue Téoros (2011, vol.
30, n° 1, p. 108-118), Université du Québec à Montréal. Co-auteur : Georges-Henry Laffont.
Résumé : Dans un mouvement de plus en plus suivi, de nombreuses agglomérations et régions françaises
tendent à développer un secteur économique local consacré au cinéma et, dans le même temps, un tourisme
inspiré de ce cinéma. Les lieux les plus représentatifs d’une ville deviennent ainsi des décors et des images
diffusés sur grand écran. Cependant, l’exposition ainsi offerte renforce-t-elle l’attractivité touristique ? Ou
bien l’industrie du film se saisit-elle des sites emblématiques pour créer l’émotion ? Ces questions symétriques

5
conduisent à analyser les stratégies de développement économique dans un contexte local, et à comprendre
comment un lieu est utilisé (et mis en valeur) par le cinéma.
18 « Mont-Saint-Michel : ambitions et passions autour d’un projet patrimonial », Place publique, n° 6, Juin
2010.
Résumé : Les travaux du « rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel » visent-ils à restaurer
ce site exceptionnel ou à le réinventer ? Il s’agit en fait de faire coïncider le Mont avec l’image attendue par le
visiteur, qui est davantage une production sociale que la résurgence d’une image historique précise.
19 « Étude de sensibilisation paysagère : de l'analyse paysagère au paysage culturellement partagé sur le
territoire du Trégor-goëlo », Rapport d’études pour la DDEA des Côtes d’Armor, 2009, Rapport 100 p. Co-
auteurs : Frédérique Chlous-Ducharme, Nazaré Das Nevez-Bicho, Patrick Dieudonné, Sébastien Gallet, Claire
Jusseau.
Résumé : L’étude de sensibilisation paysagère tente, dans une approche renouvelée de l’analyse du paysage,
de montrer comment concilier l’analyse de l’écologie du paysage et les considérations politiques et
sociologiques. Les traits caractéristiques du territoire sont ainsi revisités au travers des données
cartographiques, des images officielles publiées par les porteurs de projets territoriaux
20 « Delivering Professional Planning Education across National and Professional Boundaries –
reflections on the AESOP Excellence in Teaching Prize 2009 », CEBE Transactions, vol. 7, Issue 1,
co-auteur : Olivier Sykes
Résumé : comment appréhender avec un groupe d’étudiants en Master d’aménagement les programmes
européens de développement local. Cet article reprend l’expérience menée pendant un an par trois
enseignants et 42 étudiants.
21 « Les tribulations économiques d’une approche patrimoniale en faveur du développement touristique »,
Conférence dans le cadre du programme universitaire « Culture et tourisme ». Université du Québec à
Montréal. Responsable : Lucie Morisset.
Résumé : Il est commun d’imaginer que le tourisme est une source de développement pour les territoires. Et la
présence d’un patrimoine vient renforcer cette conviction. Cependant, une analyse plus précise des relations
entre patrimoine, tourisme et développement montre que les conditions de succès sont parfois difficiles à
réunir. La nature économique du patrimoine, la dynamique spécifique du marché touristique patrimonial et les
effets de la mondialisation sont autant de sujets qui doivent être compris pour aider à des politiques
véritablement pertinentes. Les quelques expériences présentées permettent de mesurer les bénéfices, mais aussi
les risques de l’industrie du tourisme.
22 « Des taxis-motos au tramway. Penser la mobilité dans les villes africaines », Séminaire international
« Villes et environnement durables en Afrique et au Moyen-Orient ». Casablanca, 19-21 novembre 2009.
Séminaire organisé par APERAU Afrique-Moyen-Orient. Publications de la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Rabat, Université Mohammed V – Agdal, Colloques et séminaires n° 171, p. 283-294.
Résumé : les taxis-motos de Lomé ou de Ouagadougou sont le moyen original trouvé par les habitants de ces
villes africaines pour palier l’absence d’investissements et d’infrastructures publiques. Cependant, ce
dispositif apparaît correspondre davantage à l’économie informelle qu’à une réelle perspective de
développement. Une autre solution est-elle alors dans la mise en œuvre des programmes de tramway lancés
par beaucoup de capitales du Maghreb ? Si les perspectives à long terme et les capacités d’investissements et
d’accumulation semblent mieux assurées, la réponse n’est cependant pas totalement satisfaisante : l’étude des
différents programmes montrent en effet une dépendance technologique accrue et un service uniforme, sans
prise en compte des besoins locaux.
23 « Les villes, un défi africain. Essai d’interprétation économique d’un urbanisme spontané », Séminaire
international « Urbanisations en Afrique: Permanences et Ruptures ». Lomé, 26-29 novembre 2008. Séminaire
organisé par l’EAMAU (École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme).
Résumé :
24 « Participation, gouvernance, Emporwerment… Quel processus démocratique pour les
intercommunalités ? L’exemple de Brest métropole Océance », Communication au colloque international
pluridisciplinaire« Espaces de vie, espaces-enjeux : entre investissements ordinaires et mobilisations
politiques », Rennes, 5-7 novembre 2008.
Résumé :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%