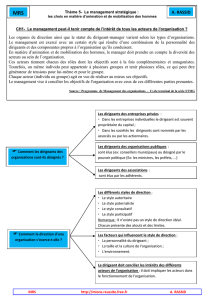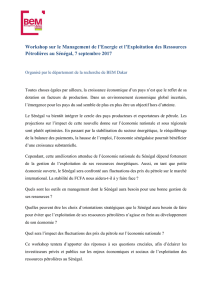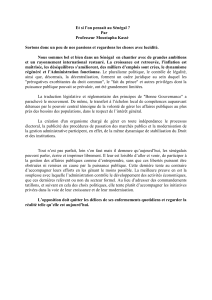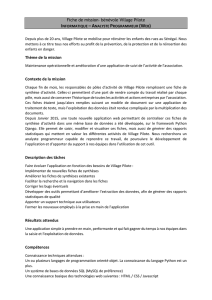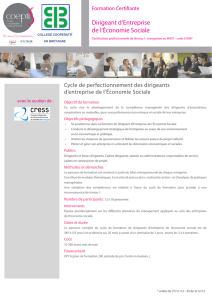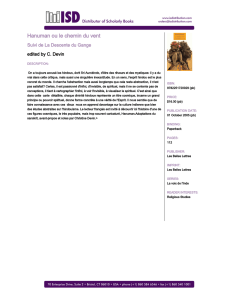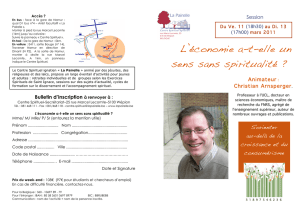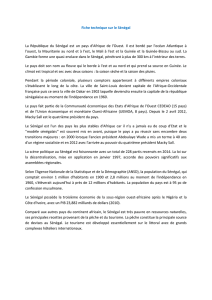Management éthique et spirituel de l`entreprise Sénégal

Lettre ouverte aux autorités, aux dirigeants, aux personnels de « l’entreprise Sénégal » sa et à la société civile
Pour un management éthique et spirituel
de « l’entreprise Sénégal »
Ou comment instaurer dans les structures économiques et sociales de l’Etat
une gestion vertueuse, économiquement performante et socialement efficace (1)
Paul KHOURY eca, mba***
Les appels à la transparence dans le mode de gestion de l’Etat
et de rupture dans la qualité des dirigeants se sont mués en de
vigoureuses exigences, voire en ultimatum à l’encontre des
nouvelles autorités issues des récentes élections
présidentielles. D’un côté, les intellectuels, qu’ils soient
politiques ou civils, réclament des ministres et des dirigeants
d’entreprises publiques à la probité sans faille, compétents en
matière de gestion des ressources de l’Etat et conscients de
leur mission d’intérêt général. De l’autre, les citoyens exigent
des réponses appropriés à leurs besoins (plus de mieux-être et
de justice) et à leurs attentes pour des institutions d’Etat
économiquement efficaces et socialement vertueuses. Mais
comment répondre à de telles demandes et atteindre les
objectifs qui y sont rattachés ? Par une gouvernance
rigoureuse et des institutions transparentes ! Telle est, à juste
titre, la réponse unanime qu’apporteront, avec des
expressions et termes différents, les citoyens et intellectuels
précités. Telle est également la réponse que des autorités
gouvernementales, religieuses, économique et sociales
apporteront.
… Prétendre qu’une volonté fermement exercée sur les ressources
humaines et organisationnelles qui prévalent présentement, fondée
sur une rationalisation contrôlée des ressources de l’Etat garantira
l’atteinte des objectifs évoqués ci-dessus c’est, que l’on pardonne
l’expression, se bercer d’une douce illusion …
Les choses ne sont malheureusement ni aussi simples, ni
aussi claires qu’il n’y paraît. D’abord, il y a le fait que la
solution est, en l’état actuel des choses, plus une intention
qu’un processus clairement défini et opérationnel de suite. Il
y a ensuite le fait que les modalités, conditions et ressources
nécessaires à sa mise en œuvre ne sont ni connues, moins
encore arrêtées. Prétendre qu’une volonté fermement exercée
sur les ressources humaines et organisationnelles qui
prévalent présentement, fondée sur une rationalisation
contrôlée des ressources de l’Etat garantira l’atteinte des
objectifs évoqués ci-dessus c’est, que l’on pardonne
l’expression, se bercer d’une douce illusion.
I. LES RACINES DU MAL ETRE, DU MAL FAIRE ET DE
LA MAL GOUVERNANCE DE SENEGAL SA
, En effet, l’emploi de tels outils ne traitera tout au plus que
les symptômes. Les racines de la mal gouvernance, du mal
faire et du mal être seront laissées intactes. Par ailleurs, ils
sont impuissants devant la profondeur de l’ancrage, au sein
des structures organisationnelles de l’Etat, des paradigmes
socioéconomiques au travers desquels les dirigeants et les
personnels perçoivent et ce dernier et les institutions qui en
forment le prolongement dans la société et dans la vie
économique. Une telle assertion n’est pas un déni de la
qualité des lois et règlements qui régissent ces entités et leurs
relations avec l’Etat, ni un jugement négatif de la qualité en
soi des méthodes et règles de gouvernance publique en
vigueur au sein des démembrements de l’Etat, moins encore
de toutes les voies recommandées par des professionnels et
des citoyens autorisés en matière d’administration et de
gouvernance publiques.
.. Les causes profondes résident fondamentalement dans l’absence,
en milieu de travail des entités relevant de l’Etat, de paradigmes
inspirants, de valeurs et principes élevés fédérateurs des
comportements et des énergies …
La raison majeure qui explique l’inefficacité ou l’insuffisante
réussite des solutions et voies évoquées ci-dessus tient
essentiellement au fait qu’elles n’intègrent pas les deux
paramètres déterminants qui, seuls, sont en mesure d’assurer
un succès durable. Le premier de ces paramètres réside dans
la non intégration, dans ces solutions, de valeurs
motivatrices. Le second réside dans le fait que les règles et
solutions précitées, qui sont essentiellement dédiées à
l’efficacité organisationnelle ou économique, considèrent le
personnel comme une ressource objective, une ressource
« objet », alors qu’il est une communauté vivante faite de
dignités, de désirs, d’ambitions, de besoins de
reconnaissance ou de respect. En d’autres termes, nous ce
n’est pas dans l’inefficacité organisationnelle, l’application
permissive ou insuffisante des lois, règlements et règles de
gouvernance publique ni même dans le choix des dirigeants –
où il y aurait beaucoup à dire et à redire que résident les
causes profondes de la corruption, des détournements, du
manque de transparence, de la piètre qualité des services
offerts et des performances financières et sociales, etc.. Nous
déclarons que c’est fondamentalement dans l’absence, en
milieu de travail des entités relevant de l’Etat, de paradigmes
inspirants, de valeurs et principes élevés fédérateurs des
comportements et des énergies. Parce que aujourd’hui le
climat organisationnel interne et le cadre dans lequel
s’inscrivent les relations entretenues avec les parties
prenantes est vicié par les enjeux politiques, politiciens,
personnels ou de groupes, les références sectaires, les passe-
droits, parce que les valeurs sociales de base, comme
l’honneur, sur lesquelles ont toujours été fondées l’éducation
la vie en société, ont été reléguées au second plan, il est donc
illusoire, abusif même, d’attendre d’un tel environnement
autre chose que contre productivité économique, sociale et
morale, défiance et, pire, résignation. Le temps est donc venu
de (re)penser et de (re)mettre en place un plan de
redressement de « l’entreprise Sénégal sa ». Par celle-ci, il
y a lieu de comprendre toutes les structures organisées, à but

lucratif ou non, relevant en tout ou partie, directement ou
indirectement de l’Etat, par voie juridique, administrative ou
financière, quel que soit leur statut, ayant pour mission
d’offrir des services gratuits ou payants aux citoyens
(établissements et entreprises publics parapublics ou
organismes assimilés, écoles, hôpitaux, sociétés nationales,
agences, commissions, délégations, et mêmes ministères, etc.)
ou ayant pour vocation de gérer des ressources ou du
personnel publics (santé, éducation, etc.). Le choix du terme
générique « entreprise » se justifie ainsi en raison du fait que
les structures organisées susvisées qui la composent sont
perçues comme des entités ou activités dotées de ressources
économiques et ayant en charge la réalisation d’objectifs
économiques ou sociaux assignés par l’Etat ou pour son
compte. Considérer le Sénégal comme une sa (société
anonyme) propriété des 12 millions de sénégalais qui en sont
« les actionnaires » est une métaphore utile à plusieurs titres.
En premier lieu, elle permet, au regard des performances
attendues, de préférer les termes management ou gestion,
plus dynamiques et proactifs, à ceux d’administration ou de
gouvernance jugés chargés pour le premier terme d’une
tradition peut-être obsolète, vagues ou sujet à des définitions
incontrôlables ou contestables pour le second.
Deuxièmement, une telle métaphore, qui a valeur
pédagogique, intègre mieux et avec plus de force l’obligation
faite aux dirigeants (les mandataires) de rendre compte, aux
« actionnaires susvisés» (les mandants), ainsi que le « droit »
de ces derniers à demander leur maintien ou leur révocation,
de façon analogue à ce qui est vigueur dans les sociétés
relevant du droit privé, autant que cela est envisageable dans
un contexte régi par des règles administrative.
II. DE LA BONNE GOUVERNANCE A LA SAINE
GESTION DE L’ENTREPRISE SENEGAL
Dans le cadre du « redressement » de l’entreprise Sénégal,
par management, il y a lieu d’entendre saine gestion, concept
plus approprié « au cas » de l’entreprise précitée, plus
complet, plus précis, plus dynamique et plus expressif que
celui de bonne gouvernance, comme on le verra ci-après. La
saine gestion consiste à appliquer les principes de la bonne
gestion assortie du strict respect de trois engagements
personnels. La bonne gestion consiste en l’implantation et
l’exécution orientée de quatre fonctions de gestion revisitées
aux fins de leur intégration dans l’environnement de
l’entreprise sous revue. Les quatre fonctions sont
impersonnelles et leur implantation tient compte, s’il y a lieu,
des règles administratives. Elles s’appliquent aux structures
et aux ressources, alors que les trois engagements sont
personnels aux dirigeants. Les fonctions ont pour finalité de
garantir l’efficacité organisationnelle, tandis que les
engagements sont le gage de l’exécution responsable par les
dirigeants, de leur mandat. Les fonctions correspondent à des
obligations managériales auxquelles aucun dirigeant relevant
de l’entreprise Sénégal ne doit être autorisé à se soustraire, au
risque d’engager sa propre responsabilité et d’être révoqué
pour incompétence ou faute professionnelle.
Quatre fonctions orientées, quatre exigences de compétence
Elles consistent à planifier, organiser, diriger et contrôler,
traditionnellement exprimées par l’acronyme P.O.D.C.
Toutefois, il y a lieu de noter que le sens et le contenu qui
sont donné aux concepts de PODC et de bonne gestion dans
le contexte de l’entreprise Sénégal sont, à certains égards,
différent du sens ou contenu usuel qu’ils revêtent dans
l’entreprise privée. La planification au sein des entités
constitutives de l’entreprise Sénégal n‘y est pas tant la
formulation traditionnelle, si elle existe, des lettres de
mission, stratégies et budgets que la détermination des
résultats concrets et réalistes visés, en accord avec le
personnel chargé de les atteindre, au regard des activités
essentielles pouvant être menées et des ressources qui sont ou
seront disponibles avec une certitude raisonnable. La
planification, version saine gestion de l’entreprise Sénégal,
est une activité renouvelée, presque permanente. Elle doit
reposer non pas sur une logique ponctuelle
objectifs/ressources ou l’inverse, mais sur le processus
séquentiel et dynamique de rupture suivant :
besoins/compétences/résultats/ressources/plans/budgets. En
d’autres termes, la qualité du personnel est le déterminant
majeur de la fonction planification. La fonction organisation,
même si elle doit être mise en œuvre sur la base de
procédures, statuts, règlements et autres textes de nature
administrative – ce qui n’est pas peut-être toujours le choix
idéal, doit être conçue, exécutée et suivie, autant que faire se
peut, en vue de l’accomplissement des 3E (efficacité ou
atteinte des objectifs assignés, efficience pour traduire l’idée
de productivité ou de faire plus ou mieux avec moins et
économie en termes de ressources utilisées). Ces 3E sont des
concepts familiers dans le secteur public, où la recherche de
l’optimisation des ressources devrait être un sacerdoce pour
les dirigeants. Enfin, devant impérativement refléter les
processus opératoires réels et la façon dont les compétences
essentielles qui font les résultats s’exercent, les
organigrammes, procédures, responsabilités, pouvoirs et
rémunérations associés doivent être pensés et implantés de
façon conséquente et cohérente avec ce qui précède.
… La saine gestion de l’entreprise Sénégal est la marque
d’honneur de dirigeants et managers de qualité, c’est-à-dire
d’hommes et de femmes « développés », donc dotés d’un niveau
élevé de conscience de leurs responsabilités, d’un fort potentiel
évolutif et d’un sens profond du bien commun …
La fonction Direction réside, dans l’entreprise Sénégal,
moins dans l’exercice des pouvoirs conférés (fixer les
objectifs, commander, décider, autoriser/interdire, etc.) que
dans le fait de veiller, en y prenant une part personnelle
active, à l’exécution effective des activités et responsabilités
essentielles, conformément à la mission assignée et à ce qui a
été planifié. Elle est également dans la coordination effective
et cohérente des activités et responsabilités de façon à
atteindre les 3E. Diriger y est aussi l’art de prendre les
décisions courageuses qui s’imposent et l’humilité pour
conférer le pouvoir suffisant et les ressources nécessaires à
ceux qui sont les plus à même pour accomplir les objectifs et
réaliser les résultats escomptés. C’est, enfin, motiver pour
susciter l’implication de tous et de chacun par l’exemple, et
reconnaître le mérite. La fonction Contrôle, dans le contexte
sous revue y a un contenu spécifique. Si elle consiste
d’abord à assurer le suivi d’exécution, en qualité et quantité,
des résultats planifiés, elle veille avec une priorité égale à
l’atteinte des objectifs visés en matière de 3E , à la
préservation préventive du patrimoine et à l’affectation des
ressources aux seules fins recherchées . Contrôler n’y est

plus le privilège ou le rôle exclusif des « corps de contrôle »,
ni une menace, moins encore une routine. Il devient, pour
chaque membre du personnel ayant une responsabilité dans
l’atteinte des 3E, dans la sauvegarde du patrimoine et
l’utilisation des ressources qui lui sont confiées, une sorte de
devoir permanent, pleinement consenti et assumé selon des
méthodes et critères adéquats au niveau opérationnel qui est
le sien. Contrôler dans l’entreprise Sénégal, c’est (ré) évaluer
pour informer et (ré)agir, contribuer et rendre compte. C’est
finalement comprendre pour apprendre et éduquer.
Trois engagements personnels, trois vertus managériales
La saine gestion ne sera réalisée que si d’une part les règles
de bonne gestion brièvement décrites ci-avant sont appliquées
et effectives, et si d’autre part le management des entités
constitutives de l’entreprise Sénégal est confié à des
dirigeants compétents en gestion, qui s’engagent
formellement à accomplir leur mandat en fondant leurs
décisions et actes sur la prudence, l’intégrité et le courage
céder la place le moment venu.
… Nommer à un poste de dirigeant un incompétent, c’est dans une
certaine mesure faire preuve d’incompétence ou d’irresponsabilité.
L’y maintenir relève au mieux de la négligence et au pire de la
complicité…
La responsabilité de s’assurer au préalable de la compétence
(savoir+savoir faire) des dirigeants nommés à la tête et au
sein de ces entités relève de la responsabilité totale de ceux
qui les y ont portés. Dans l’entreprise Sénégal, où les
ressources proviennent des deniers publics, la prudence à
laquelle nous faisons allusion est de nature économique. Elle
est cet état d’esprit permanent qui habite les dirigeants et leur
permettent de « réfléchir à la portée et aux conséquences de
leurs actes, de choisir les moyens appropriés pour atteindre
les objectifs et de prendre les dispositions nécessaires pour
éviter les erreurs et s’abstenir de tout ce qu’ils croient
pouvoir être source de dommages » pour les deniers publics,
le bien commun, les ressources de l’organisation ou la
pérennité de celle-ci. L’intégrité, en matière de saine gestion,
est à comprendre comme la convergence de deux sous
qualités attendues des dirigeants et managers de l’entreprise
Sénégal : le sens des responsabilités (conscience claire des
devoirs attachés au mandat, capacité à reconnaître et à
assumer ses erreurs) et, la volonté affirmée de gérer de façon
transparente. Plus que dans toute autre entreprise, la
transparence est une exigence d’actualité permanente tant
l’intérêt général, le bien commun et le désir légitime des
citoyens d’être informés sur l’usage fait des ressources de
l’Etat sont omniprésents. La transparence y régit la relation
de confiance qui doit prévaloir entre la communauté des
citoyens ou des partes prenantes à une entité donnée (les
mandants) et les dirigeants de celle-ci (les mandataires). Elle
doit être notamment dans les actes et décisions prises de
bonne foi, dans l’absence de conflits d’intérêt (le cas échéant
les révéler), dans l’engagement personnel de fournir ou de
rendre accessible à temps une information pertinente, dénuée
de toute intention trompeuse et dans la volonté de ne rien
omettre des responsabilités engagées et conséquences qui y
sont rattachées (reddition transparente des comptes et
imputabilité). Outre la prudence et l’intégrité, la saine gestion
requiert des dirigeants qu’ils sachent « rendre à César ce qui
est à César », le moment venu. En d’autres termes, savoir se
retirer avec élégance quand les circonstances le requièrent
(fin de mandat, révocation, sanction, insuffisance de résultats,
incompétence, etc.) et céder la place de façon honorable dans
des conditions transparentes. C’est dire que la saine gestion
de l’entreprise Sénégal la marque d’honneur des dirigeants et
managers de qualité, c’est-à-dire d’ hommes et de femmes
« développés », donc dotés d’un niveau élevé de conscience
de leurs responsabilités, d’un fort potentiel évolutif et d’un
sens élevé du bien commun. Nommer à un poste de dirigeant
un incompétent, c’est dans une certaine mesure faire preuve
d’incompétence ou d’irresponsabilité. L’y maintenir relève au
mieux de la négligence et au pire de la complicité. Dans les
deux cas, il serait légitime de sanctionner les deux
responsabilités incriminées et, à défaut, leur demander
réparation pour les préjudices financiers, économiques ou
sociaux subis.
… La saine gestion n’est pas à elle seule suffisante pour redresser
l’entreprise Sénégal en raison de la force paralysante des
paradigmes qui y prévalent et surtout des contre-valeurs qu’ils ont
engendrées …
Après lecture des développements ci-dessus, le lecteur averti
est fondé à en conclure qu’en définitive la gestion efficace de
l’entreprise Sénégal est affaire de compétence, de
responsabilités, d’implantation et d’application soutenue des
règles de saine gestion exposées ci-dessus. Il n’en est
malheureusement pas ainsi, et il n’en sera jamais ainsi nulle
part dans l’entreprise Sénégal, à de trop rares exceptions, en
raison de la force paralysante des paradigmes qui y prévalent
et surtout des contre-valeurs qu’ils ont engendrées. Un
paradigme, rappelons-le, est, dans le contexte sous revue, une
façon de percevoir la réalité et au moyen de laquelle on
donne une signification à ses actes ou un sens à sa vie. Il est
le résultat d’un ensemble de croyances, de valeurs et
d’expériences signifiantes profondément inscrits en nous.
Parmi les paradigmes les plus nuisibles qui gangrènent
l’entreprise Sénégal et ont rendu inapplicables la saine
gestion, et même la bonne gestion tout court, on peut citer à
titre illustratif « les vérités » établies suivantes communément
partagées par les dirigeants et les personnels de l’entreprise
Sénégal : toute responsabilité ou pouvoir au sein de celle-ci
sont des occasions pour s’enrichir ; la reconnaissance
commande à tout dirigeant d’une entité nationale ou
publique le devoir social et l’obligation politique d’utiliser le
patrimoine et le pouvoir qui lui sont confiés pour favoriser
ses proches, retourner l’ascenseur, se mettre aux ordres et
élargir son cercle d’influence ; l’obligation de rendre compte
est due au chef et à lui seul et non à l’entreprise, aux
travailleurs ou aux citoyens, etc. De tels paradigmes ont
engendré une constellation de contre-valeurs qui ont fini par
empoisonner l’environnement interne et externe de
l’entreprise Sénégal. Elles ont pour noms cupidité, égoïsme,
corruption, sectarisme, jalousie, détournements, concussion,
prévarication, favoritisme, népotisme, méchanceté,
hypocrisie, déloyauté, défiance, laxisme, indignité, orgueil,
impunité, complicité, querelles de chapelles, etc., pour n’en
citer que quelques unes. Dans un tel contexte, un processus
implacable et bien connu, que nous dramatisons à peine, est
enclenché ici et à là à des degrés divers. 1. Les volontés de
bien gérer finissent par devenir impuissantes et, quelques
fois, font place à un «réalisme» quelquefois indigne et
pusillanime, les procédures de bonne gestion et règles de
contrôle sont progressivement inappliquées quand elles ne

sont pas dévoyées au profit de celles informelles ou taillées
sur mesure pour certains dirigeants. 2. La défiance prévaut
à l’intérieur du personnel et des syndicats, les récalcitrants et
autres résistants sont écartés ou « mis au frais », le moral et
la motivation sont au plus bas. 3. L’insécurité et la
frustration renforcent les paradigmes négatifs évoqués plus
hauts et installent le personnel dans une ambiance et une
économie de survie où chacun est préoccupé à obtenir des
privilèges, négocier les parcelles de pouvoir ou d’influence à
sa disposition et à s’aménager un ilot de préservation de soi
et de ses intérêts. Ce qui devait être l’exception devient la
règle. 4. Le système entre dans une spirale d’auto négation
de valeurs sociales-clés (éthique, justice, dignité, intérêt
général, etc.). La volonté de (bien) gérer fait place à celle de
(bien) survivre. 5. Les sanctions, rares, tardives ou de faible
portée, les menaces des autorités, les dénonciations de la
presse, les audits souvent très en retard et systématiquement
contestés, et même les peines de prison n’y auront en
définitive rien changé.
… Le mal est très profond qui est dans le déficit de conscience
morale et la pauvre qualité de la conscience de soi. Le remède
réside dans un management économiquement performant qui
intègre un modèle éthique et spirituel de conduite des
organisations…
On se sera tout simplement attaqué aux symptômes et non
aux causes profondes. Le mal est très profond. Les deux vrais
« coupables » d’un tel gâchis que l’on appelle mal
gouvernance ou mauvaise gestion sont connus de tous et de
chacun, mais qu’une certaine myopie sociale et économique
empêche de voir. Le premier est le déficit de conscience
morale et le second est la pauvre qualité de la conscience de
soi, qui animent la très grande majorité des acteurs qui
interviennent au sein de la l‘entreprise Sénégal. La
conscience morale doit être comprise ici comme le
fondement de ce qui fait la différence entre ce qui est
socialement bien ou mal dans les rapports que nous
entretenons entre nous au sein de la société au sein dans
laquelle nous vivons et, de façon spécifique, au sein des
micros communautés que constituent les organisations
économiques et sociales. Elle est la somme des valeurs
positives partagées par lesquelles nous prenons conscience
notamment du bien commun, de l’intérêt général et de nos
obligations civiques. La conscience de soi détermine notre
état d’esprit dominant, notre façon d’être et conséquemment
notre façon d’agir et de réagir. Constituée des valeurs et
principes majeurs inscrits en nous par choix ou du fait des
« contraintes » de notre milieu de référence, elle est l’outil
par lequel nous apportons, quand notre environnement nous
sollicite directement, des réponses dites « justes »
(responsabilité, intégrité, courage, détermination, etc.) ou
négatives, dites dévalorisantes (prévarication, corruption,
orgueil, cupidité, démotivation, etc.). La conscience morale
est le fruit de la façon dont on appréhende notre
environnement social ou religieux. La conscience de soi est
acquise au travers de nos paradigmes et de la rationalisation
de nos vécus et habitudes. Pour illustrer cela, quelqu’un a dit
que les pensées engendrent les croyances qui justifient les
actes. Les actes font les habitudes qui créent les caractères,
et les caractères forgent les destins.
III. DU MANAGEMENT RATIONNEL AU
MANAGEMENT SPIRITUEL
Pour lutter contre ces calamités sociales et économiques que
sont les contre valeurs évoquées ci-dessus, la mal
gouvernance, la mal administration et la mauvaise gestion de
l’entreprise Sénégal, les audits, les sanctions et les
changements de dirigeants, les réorganisations ou les
volontés de bonne gouvernance ne suffisent pas et ne
suffiront jamais tant qu’une solution de fond, de rupture et de
crise, pertinente et durable, ne sera pas mise en œuvre. Une
telle solution ne peut revêtir que deux formes. La première
est celle de la tyrannie répressive d’Etat, qui est à exclure
dans une démocratie. La seconde, étudiée de façon
approfondie, expérimentée et formalisée depuis plus d’une
vingtaine d’année (Cf. les auteurs cités à la fin de cette
contribution) constitue le véritable remède. Elle repose sur un
management économiquement performant qui intègre un
modèle éthique et spirituel de conduite des organisations. Le
nom donné à ce modèle est management éthique et spirituel,
ou pour faire court, management spirituel. Implanté avec
succès, au niveau mondial dans de nombreuses entreprises
du secteur privé ou public, notamment à partir de la fin des
années 70/80 aux Etats unis, en Inde, au Brésil, au Canada,
au Kenya, en Australie, au Japon , etc., le management
spirituel est passé du stade de recherche à celui d’applications
réussies. Dans le contexte de l’entreprise Sénégal, le
management spirituel doit s’articuler sur a) la saine gestion
décrite plus haut, b) un cadre spirituel commun et c) des
règles éthiques spécifiques. Le cadre spirituel doit
nécessairement s’identifier à l’environnement religieux et
social propre au Sénégal. Les règles éthiques, pour être
pertinentes, ne sauraient être autre chose que le reflet fidèle
des exigences en la matière des parties prenantes dominantes
spécifiques à chaque structure.. Le management, dans
l’expression management spirituel, est ici l’art d’atteindre les
objectifs par une gestion engagée, rationnelle et systémique
des organisations, des hommes et des ressources. Dans le
contexte sous revue, nous lui avons donné le nom de saine
gestion, terme que nous jugeons, pour des raisons
précédemment expliquées, plus approprié à celui de bonne
gouvernance. L’éthique est une discipline personnelle ou
collective constituée d’un certain nombre de principes par
lesquels sont guidés nos comportements, décisions, actes et
rôles vis-à-vis des autres.
… La loi oblige, la morale commande, l’éthique
recommande…
Dans un contexte donné de vie commune ou de travail,
l’éthique consistera en l’ensemble de règles volontairement
inscrites en nous qui permettent de déterminer, dans nos
relations avec les autres, ce qui est juste, légitime et
équitable. Ne confondons pas éthique avec morale ou loi. La
morale traduit l’ensemble des critères, généralement
universels, souvent d’origine religieuse, qui établissent ce qui
est bien ou mal, vertu ou vice. La loi, qui repose sur le droit,
est cet ensemble de règles et limites impersonnelles, à
validité temporelle ou circonstancielle, applicables à tous, qui
définissent ce qui est autorisé ou permis (légal), interdit
(illégal) et la façon dont les litiges sont résolus et les
sanctions infligées (la justice des cours et tribunaux). A cet
égard, ne dit-on pas que la loi oblige, la morale commande,
l’éthique recommande… et que si la loi est évolutive et la
morale universelle, l’éthique est plurielle… L’éthique
s’alimente à plusieurs sources (morale, religion, loi,
humanisme, philosophie, etc.) mais jamais à une seule d’entre

elles. Elle est une démarche propre à un environnement
donné, librement consentie vers le juste, le légitime et
l’équitable. Quant à la spiritualité, elle est l’ingrédient
« salvateur », si l’on peut dire. Elle caractérise le nouveau
type de management qui fait l’objet de la présente
contribution. Définissons-la, en simplifiant, comme cette
guidance intérieure qui nous transcende. Elle est cette
aspiration profonde, d’origine religieuse ou humaniste,
qu’alimente un « système », personnel ou partagé, de pensée,
de croyances, de principes et d’attitudes par lesquels nous
donnons du sens à la vie et à notre vie, et grâce auxquels nous
espérons élever notre humanité ou atteindre le divin.
Précisons d’emblée que spiritualité ne signifie pas ici
religion, même si cette dernière est la source première (mais
non la seule) de toute spiritualité, ce qui est indéniablement
le cas au Sénégal. La religion se définit par la sacralité et la
centralité du divin, de ses envoyés et des écritures saintes et
par les déclarations de foi. Elle s’organise autour de la
pratique de prières, rituels ou rites d’appartenance,
d’obligations communautaires et lieux de cultes. Autant de
caractéristiques absentes ou non requises, pour la plupart,
dans une démarche spirituelle. En effet, la spiritualité qui est
une voie d’élevation personnelle et d’essence intérieure est
fondée sur des principes, des vertus, sur l’expérience et la
recherche d’une relation directe entre soi et le divin.
… Les valeurs fondatrices du management spirituel sont
l’humilité, la justice, la vérité, la droiture et la
compassion…
. Il reste toutefois que dans un pays de croyants comme le
Sénégal où la foi religieuse, toujours présente et renouvelée,
rythme la vie des hommes et de la nation elle-même, la liste,
qui est très longue des principes et valeurs qui peuvent fonder
la spiritualité à incorporer dans le management de l’entreprise
Sénégal sera fondamentalement inspirée par la religion. Et
c’est tant mieux ainsi ! Mais quelles que soient les
préférences et sensibilités des uns et des autres, les valeurs
spirituelles fondatrices seront l’humilité, la justice, la vérité,
la droiture et la compassion. L’humilité, un précepte divin
nous a-t-on dit, est en même temps acte de foi et devoir.
Dirigeants et personnels de l’entreprise Sénégal étant d’abord
des croyants avant d’être des citoyens, l’acte de foi doit
résulter naturellement de leurs convictions et pratiques
religieuses. Le devoir d’humilité tient par ailleurs plus
simplement de la condition humaine: chaque être humain est
en définitive redevable de tout à son Créateur et à son
milieu; sans eux, il n’est rien, ne peut rien et ne sait rien.
L’humilité est en conséquence la simple reconnaissance de la
juste estime de soi et de la faiblesse de la condition humaine.
C’est en ce sens qu’il est devoir et dette qui doivent annihiler
toute suffisance ou orgueil. Dans la perspective spirituelle du
management … il n’y a point d’autorité ou pouvoir qui ne
viennent de Dieu…, les exercer avec humilité est un
témoignage de sa foi et de soumission à Dieu : devoir et
dette auxquels aucun manager ou dirigeant croyant d’une
structure publique ne saurait se soustraire. Dans un tel ordre
d’idée, ils sont des serviteurs et des coopérateurs de Dieu au
service de la communauté des citoyens que servent les
institutions qu’ils dirigent. En fondant leurs décisions et leurs
actions sur la justice et la vérité, les managers et dirigeants
spirituellement inspirés sont non seulement cohérents avec
leur foi et les commandements divins, mais c’est par elles
qu’ils acquièrent les « biens » les plus précieux dont un
dirigeant puisse rêver : la confiance indéfectible et l’amour de
ceux qu’il a la charge de conduire. En matière de
management spirituel, « la justice » n’est pas à entendre au
sens d’une application rigoureuse, déterminée, impersonnelle
et égale pour tous des règlements et lois, ni ce moyen de faire
respecter les droits des uns et des autres. Dans le même ordre
d’idée, « la vérité » n’y est pas celle du vrai ou du faux, et
n’y correspond pas non plus à celle des faits crus. Justice et
vérité y sont plutôt les deux sources inséparables
d’authenticité, de transparence et d’adhésion sans lesquelles
aucun projet d’entreprise ou organisation économique et
sociale ne sauraient être durablement efficaces et
performants. Si ces trois qualités sont des exigences qui
interpellent de façon égale les dirigeants et les personnels,
c’est aux premiers qu’incombent l’obligation spirituelle de
donner le ton et de créer l’environnement approprié à leur
développement. La justice à laquelle nous faisons allusion
dans le contexte du management spirituel, est moins l’équité,
l’éthique ou le respect des droits et libertés que celle qui est
fondée sur l’écoute permanente et le souci de (ré)concilier,
afin de donner à tous et à l’organisation la chance de pouvoir
vivre ensemble dans sécurité et dans la dignité. C’est par la
vérité, c’est-à-dire par l’authenticité des dirigeants, qu’on
accomplit plus surement ce qui précède : se comporter vrai,
agir vrai, écouter vrai, communiquer vrai et parler vrai ! Dans
le management spirituel, la justice est protectrice, généreuse
et bienfaisante. La vérité qui affranchit y est cohérence
intérieure et ouverture aux autres, deux liants indispensables
à des relations saines entre dirigeants et dirigés. La droiture,
qui constitue le quatrième principe spirituel de base est, dans
un pays aussi religieux que le Sénégal, une obligation de
cohérence avec sa foi. Elle est cette source d’épanouissement
personnel inscrite dans les enseignements des religions
révélées par laquelle on atteint la sérénité du cœur, la
tranquillité de l’âme et la plénitude intérieure. La droiture est
une qualité indispensable pour susciter la confiance, gérer
dans la transparence le bien commun et rendre compte avec
détachement de l’accomplissement de son mandat. La
compassion, enfin, comme déterminant et expression
essentiels de toute spiritualité, consiste pour les dirigeants de
l’entreprise Sénégal, à introduire leur cœur dans le milieu du
travail et à susciter la même ouverture chez leurs personnels.
Pratiquer la compassion, qu’elle prenne la forme de la
prévenance, de la courtoisie, de la considération, de la
compréhension, de la bonté, de la patience, ou qu’elle
s’exprime par un sens élevé du pardon, la dignité ou
l’humanité avec lesquelles sont traitées les personnes, etc.,
c’est servir le divin, reconnaître sa propre vulnérabilité, faire
acte d’humilité et agir envers les autres comme on aimerait
qu’ils agissent envers soi. Mais plus encore, c’est instaurer la
confiance et la loyauté, c’est enfin motiver et créer avec le
personnel une relation fondée non pas sur le méprisant
« moi/eux », mais sur une relation d’estime réciproque fondée
sur le « nous ».
… En quoi fonder les relations de travail sur la dignité et
chercher à promouvoir l’épanouissement personnel des
membres d’une organisation qui a des responsabilités
économiques et sociales sont-ils idéalisme ou naïveté ? En
quoi travailler à instaurer la confiance, le respect mutuel et
la solidarité est-il faiblesse ?...
Les sceptiques pourraient arguer que tout cela relève d’un
idéalisme naïf et n’a guère de chance de réussir ; qu’il faut
 6
6
 7
7
1
/
7
100%