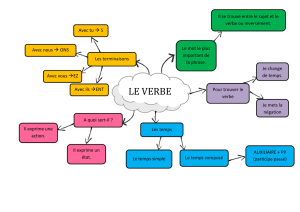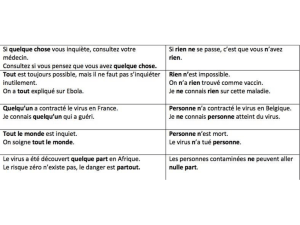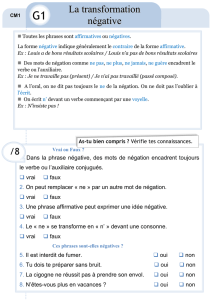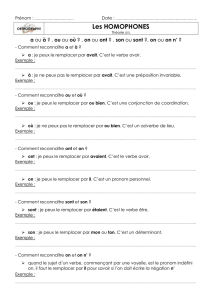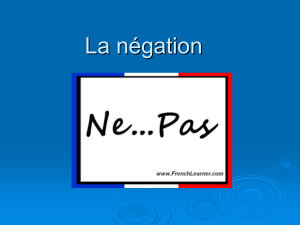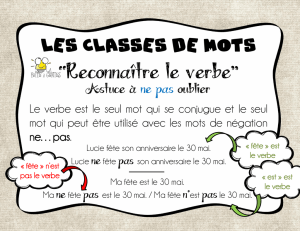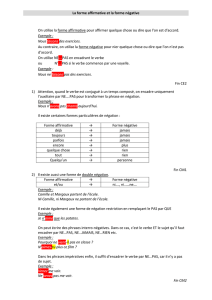Le complément de possibilité Priscilla Ngan Yuk Han

Le complément de possibilité
Priscilla Ngan Yuk
Han *
L'étude des constructions « verbe + complément » {dongbu jiegou StlMIo
f#) a été l'un des sujets-clés de la recherche en linguistique chinoise depuis
le début des années 1950. Plusieurs hypothèses ont été émises sur l'origine
et la période d'apparition des structures « verbe + complément ». Aucune
d'entre elles n'est actuellement prédominante. Le terme « verbe + complé-
ment» n'est pas non plus communément défini. Aussi nous
a-t-il
paru
nécessaire de revenir dans un premier temps sur ces problèmes de
définition et d'origine.
Des différents types de constructions « verbe + complément », nous avons
choisi le suivant, qui compte parmi les structures fondamentales de la
langue chinoise : « verbe + complément de possibilité » (keneng buyu
"BTiëliiS). Nous allons d'abord présenter de #, élément primordial de
cette structure, la définition de cet élément et sa situation du chinois bas-
médiéval au chinois contemporain (du VIe siècle à nos jours). Ensuite,
nous allons rechercher l'origine du complément de possibilité et examiner
1 Priscilla Ngan Yuk Han (CRLAO-EHESS - Université de Lyon III) est responsable
du séminaire de Linguistique comparative chinois-cantonais organisé par le CRLAO,
dans le cadre de la formation doctorale à l'EHESS. Elle est l'auteur d'une thèse inti-
tulée « Évolution des constructions "verbe + complément" du chinois bas-archaïque au
chinois haut-médiéval (Ve - VIe siècles). Analyse diachronique », sous la direction de
Alain Peyraube, soutenue le 17 décembre
2001
à l'EHESS.
Études
chinoises,
vol. XXI, n° 1-2, printemps-automne 2002

Journée d'études de l'AFEC du 16 mars 2001
son évolution. Notre étude couvrira trois périodes : bas-archaïque (Ve - IIIe
siècle avant J.-C), pré-médiéval (IIe siècle avant - IIIe siècle après
J.-C.)
et
haut-médiéval (IIIe - VIe siècles). Les documents que nous choisissons sont
supposés être représentatifs de la langue vernaculaire de l'époque2.
A. Présentation de l'élément de #
Le mot de est à l'origine un verbe signifiant « obtenir ». Au cours de son
évolution, il a pris deux chemins parallèles : il garde toujours sa fonction
verbale et en même temps, il perd son sens plein, change de fonction
syntaxique, et devient un complément de possibilité.
Comme de traduit à la fois l'épistémique, le déontique et le dynamique, il
est difficile de l'interpréter objectivement. Pour cela, plusieurs théories ont
été proposées pour déterminer le sens de ce complément. Elles permettent
également d'expliquer le changement de fonction syntaxique de ce mot3.
Définition et analyse du complément de possibilité de #
En tant que complément, l'élément de se place derrière un verbe, et révèle
la possibilité de réaliser l'action de ce verbe. De plus, s'il est utilisé dans
une question, il sert aussi à mettre la possibilité en doute.
Puisque cet élément a une valeur épistémique, déontique ou dynamique, il
est difficile de distinguer son usage. Pour cette raison, nous examinerons
avec prudence trois exemples sémantiques différents de de 4 :
zuo zai houbian kan dejian ma
?
s'asseoir
préposition derrière voir
CP
voir marque-interrogative
2 Peyraube (1988) p. 9.
3 Zhou Chiming J^iSHJ(1957), Wang Li i^j(1958) vol. 2, p. 301-304, 404. Pan
Yunzhong «A* (1980), Li Ping 3£2p(1984), Li Xiaoqi ^^^(1985), Yang Ping
«^(1989), Yang Bojun »{Ê«t, He Leshi fà5g±r(1992).
4 Les exemples
1
et 2 sont extraits de Li Xiaoqi (1985) p. 17-18.
226

Le complément de possibilité
Est-il possible de voir (si on s') assoit derrière ?
2.
fltit/h,
latt^ft
»
ni /rai
xi'ao,
zhe zhong
shu
kan bu de.
tu encore petit ce genre livre lire négation de
(Comme) tu es encore petit, (tu) ne dois pas lire ce genre de livre.
3.
flfewiwj«*,
&iam?F&
•
tade
shili
hen
da,
wo
zhaore bu de.
son pouvoir très grand je se-frotter-à négation de
(Comme) il est très puissant, je ne peux pas me frotter à (lui).
Dans l'exemple 1, le fait que l'on
s'assoit
derrière entraîne peut-être
l'impossibilité de voir. Le de dans cette phrase est donc manifestement un
complément de possibilité et il appartient à la catégorie épistémique.
Dans l'exemple 2, comme l'enfant est encore petit, il est censé se
conformer à une certaine moralité : ne pas lire n'importe quel genre de
livre.
À cause de cela, il n'a pas eu la permission de le faire. Ce fait est
exprimé par la construction bu + de. L'usage de de dans cet exemple est
donc déontique.
Quant à la phrase 3, le sujet n'est pas capable d'attaquer l'objet
puissant. La structure bu + de exprime le pouvoir faible de ce premier.
Dans ce cas, l'élément de fait partie de la catégorie dynamique s'agissant
de la capacité.
Situation du complément de possibilité en chinois bas-médiéval (du VIe
siècle à 1250)
À cette époque, la négation du complément de possibilité bu ^f (non.) + de
est déjà apparue. Voici deux exemples montrant le fonctionnement de de et
son contraire 5 :
5 Les exemples 4 et 5 sont extraits de Wu Fuxiang (1996).
227

Journée d'études de l'APEC du 16 mars 2001
4.
verbe
1
+ verbe 2 + de
^F ffl?feltë|giJM»
(P56,
p.
409)
bu wen wei neng zi
shuo
de
négation demander négation pouvoir discuter parler complément
(Comme on ne m'a pas demandé, je) n'ai pas pu discuter, parler (de cette
affaire).
5.
verbe + négation, bu ^ + de
[...] K(*)M^a (P221,p.410)
[...]
guan (shi)
yin bu de !
en-fait boire négation complément
[Le moine taoïste dit à son maître :] « Le vin
s'est
aigri et on] ne peut pas le
boire. »
Dans l'exemple 4, l'adverbe négatif wei + neng montre l'impossi-
bilité de réaliser les actions zi et shuo. Si l'on enlève cet adverbe, on aura zi
shuo de (discuter + parler + complément), structure de sens
positif,
dont les
trois éléments zi
+
shuo
+
de forment une unité syntaxiquement et sémanti-
quement complète.
Quant à la phrase 5, la négation bu entre le verbe yin et le complé-
ment de rend l'action « boire » irréalisable. Grâce à cette négation, le sens
opposé du verbe yin est exprimé parfaitement. Il n'est donc plus nécessaire
d'avoir recours à l'adverbe négatif wei + neng pour traduire la négation.
Au niveau structural et sémantique, les trois éléments yin + bu + de for-
ment un tout, et par conséquent, l'élément bu est indispensable, à l'opposé
de l'adverbe négatif wei + neng que l'on peut supprimer pour rendre une
phrase positive. Dans l'exemple n° 4, après la suppression de wei + neng,
la structure zi + shuo + de resterait syntaxiquement et sémantiquement
invariable tandis que dans la phrase 5, ce n'est pas le cas pour yin bu de : la
suppression de bu changerait complètement le sens de la phrase.
À propos de l'élément de, il n'est plus un verbe dans ces deux
phrases. Il a perdu son sens plein « obtenir », est devenu un complément et
révèle la possibilité de réaliser l'action du verbe précédent. De plus, à
l'aide de wei
+
neng ou de bu, il exprime parfaitement l'impossibilité de la
réalisation de cette action.
228

Le complément de possibilité
Situation du complément de possibilité en chinois pré-moderne (1250-
1400)
La grammaticalisation
du
verbe
de
s'est
effectuée pendant
l'époque
précédente,
et le
complément
de
continue
à
jouer
son
rôle dans cette
période. Exemples6
:
6.[...]^mMS.
(P-10)
[...] bu nengpo de.
négation pouvoir vaincre complément
(On) ne put vaincre [les Turbans Jaunes, tellement ils étaient puissants].
7.
[...] imm^mm ?
(P.
25)
[.,.]
ruhe zhao 'an de
Liu Bei ?
comment octoyer
-
une
-
amnistie
-
aux
-
rebelles
-
et
-
les
-
inviter
- à
-
se
-
soumettre - honorablement complément Liu-Bei
[L'empereur demanda :] « Comment pouvons-nous octroyer une amnistie à Liu
Bei et
l'inviter
à se soumettre honorablement ? »
Situation
du
complément
de
possibilité
en
chinois moderne (XVe
-
XVIIIe siècles)
Arrivant
à
cette phase,
le
complément
de
fonctionne sans ambiguïté,
comme dans les phrases suivantes7 :
8.r...Tft#Aifi
(P-8)
[...]
hong de ren
guo
duper complément gens CD-simple
[Comme les peintures étaient très bien copiées, il] a pu duper des gens.
9.[...1i?fefe^#ft!
(p.
11)
[...] yuanlai
shi
chi de de !
Les exemples 6 et 7 sont extraits de Sanguozhipinghua (1955).
Les exemples 8 etlO sont extraits de Pai anjing qi de Ling Mengchu (1580-1644).
229
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%