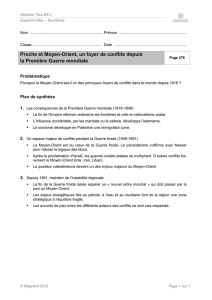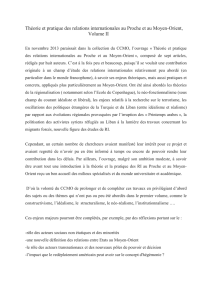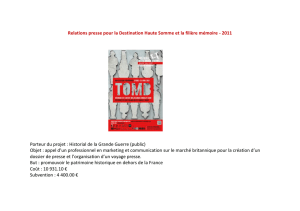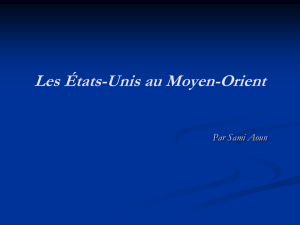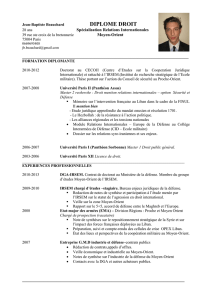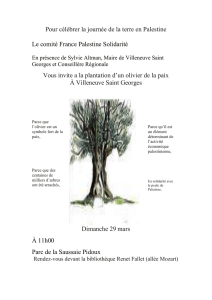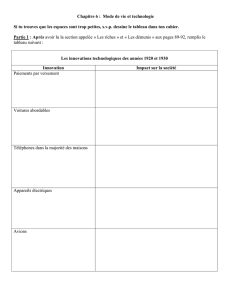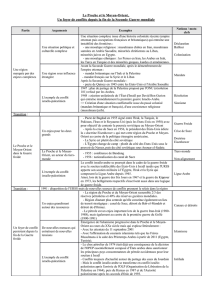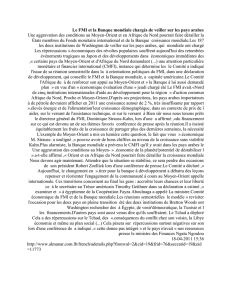p24-26 Copy

Nationalismes, autoritarismes, crises
et conflits : retour de la géopolitique ?
dossier
24 / avril 2015 / n°450
Les bouleversements que connaît le
Moyen-Orient sont venus rappeler que
les configurations étatiques actuelles sont
issues du partage d’influence que les
grandes puissances coloniales – la France
et la Grande-Bretagne – ont imposé aux
peuples de cette région dans les années
1920. Si cette référence est beaucoup plus
complexe qu’il n’y paraît, elle contribue à
éclairer ce qui se passe aujourd’hui dans
cette région. On retiendra ici trois idées : les
accords Sykes-Picot sont l’aboutissement
d’un compromis entre deux stratégies
d’ampleur inégale ; leur application sur
le terrain a été remise en question par
les rapports de force sur le terrain ; et, en
définitive, cela a produit des États sans
nation et des nations sans État.
Le partage du Moyen-Orient
Les deux diplomates ne sont pas de simples
fonctionnaires mais bien des personnalités
qui ont vraiment pesé sur les choix arrêtés
dans ces accords signés en mai 1916 par
Paul Cambon, ambassadeur de France à
Londres, et Edward Grey, ministre des
Affaires étrangères de Grande-Bretagne.
Mark Sykes est un expert influent de la
politique britannique
au du Moyen-Orient et
François George-Picot,
consul à Beyrouth
avant la guerre, est très
impliqué dans la réflexion
sur la politique française
au Levant. Tous les deux
ont une haute idée de
l’Empire qu’ils servent.
La vision britannique
est claire. Le Moyen-
Orient est un espace géopolitique d’une
importance capitale pour l’Empire puisqu’il
se trouve sur la route des Indes aussi bien
par mer en passant par le canal de Suez,
depuis son ouverture en 1869, que par
terre, via Bassorah, où les Britanniques
sont présents depuis le XIXe siècle. Leur
contrôle de l’Égypte depuis 1882 leur
assure la maîtrise par la mer, il faut donc
qu’il en soit de même pour la terre. D’où
l’absolue nécessité pour eux de pouvoir
exercer une domination territoriale du
Moyen-Orient allant sans discontinuer du
Golfe arabo-persique à la Méditerranée,
de Bassorah à Haïfa. Pour atteindre de
tels objectifs, il leur faut trouver des alliés
dans la région contre l’Empire ottoman,
dont l’armée, à cette époque, demeure
puissante. C’est pourquoi, dès l’été 1915,
ils ont entamé une importante négociation
avec les Arabes par un échange de lettres
entre Henry McMahon, haut-commissaire
britannique au Caire, et le chérif Hussein,
de La Mecque qui, en tant que descendant
du Prophète, jouissait d’un grand prestige
dans le monde arabe. L’idée était d’obtenir
un engagement militaire de sa part contre
l’Empire ottoman en échange de la
promesse de la création d’un vaste État
dont la délimitation territoriale restera
volontairement très vague dans les lettres
de McMahon.
La France est loin d’avoir une vision globale
comparable, tout simplement parce que le
Moyen-Orient n’a pas la même importance
stratégique. Les intérêts
de l’Empire sont en
Afrique et au Maghreb,
pas au Moyen-Orient,
même si la France exerce
depuis longtemps une
forte influence culturelle
et, dans une moindre
mesure, économique
dans ce qu’on appelle
alors le Levant, où la
langue française est celle
d’une partie des élites. Par ailleurs, il
est évident que, pour les gouvernements
français successifs avec Aristide Briand
(octobre 1915-mars 1917) puis Georges
Clemenceau (novembre 1917-janvier
1920), la priorité absolue, vitale même, est
la guerre contre l’Allemagne. Ces accords
Vous avez dit Sykes-Picot ?
Il y a une relative spécificité
de l’histoire dans l’espace
imaginé par les accords
Sykes-Picot pour des
raisons qui dépassent
évidemment de très loin
ces fameux accords. Cela
renvoie globalement au
profond traumatisme que
ces sociétés ont connu
quand il leur a été imposé
de passer brutalement
d’un système politique
impérial à un autre, l’État,
qui repose, au moins en
partie, sur des logiques
radicalement différentes.
Par Jean-Paul Chagnollaud1
Professeur émérite des universités
La vision britannique
est claire. Le Moyen-
Orient est un espace
géopolitique d’une
importance capitale
pour l’Empire
puisqu’il se trouve sur
la route des Indes

dossier
25
/ avril 2015 / n°450
interviennent en pleine guerre : 1916 est
l’année de la terrible bataille de Verdun, qui
commence en février et va durer jusqu’en
décembre...
L’accord aboutit à un partage de la région
avec une ligne qui court de la ville d’Acre
à celle de Kirkouk. Au nord de cette ligne,
les territoires relèvent de la France, au sud
de la Grande-Bretagne. La zone française
comprend donc le Levant, de Damas au
littoral méditerranéen avec Beyrouth et
s’étend loin au nord en englobant la Cilicie.
La zone britannique est d’un seul tenant
du Golfe arabo-persique à la Méditerranée
en laissant de côté l’Arabie, qui n’est donc
pas concernée.
Dans chacune de ces deux zones, on doit,
en principe, distinguer les régions qui
seront sous contrôle direct de la puissance
coloniale de celles qui auront seulement
des conseillers auprès d’une administration
autochtone. À l’exception du port d’Acre
sous contrôle britannique, la Palestine
n’est pas incluse dans ce partage, puisqu’il
est alors convenu, non sans de multiples
arrière-pensées de part et d’autre, qu’elle
aura un statut international dont les
modalités ne sont pas précisées.
Frontières imposées vs
aspirations des peuples
Après la guerre, il ne s’agit plus seulement
de discuter d’une carte répartissant les
influences au Moyen-Orient, mais bien de
traduire en actes les accords Sykes-Picot.
Compte tenu de l’importance des enjeux
et de la rivalité traditionnelle entre les
deux Empires coloniaux, l’affrontement
diplomatique était inévitable. Il est assumé
par deux grands hommes d’État : Lloyd
George, Premier ministre britannique de
décembre 1916 à octobre 1922 et Georges
Clemenceau, président du Conseil français
de novembre 1917 à janvier 1920.
Llyod George ne se sent guère lié par
ces accords d’autant qu’il se trouve en
position de force, puisque c’est l’armée
britannique avec des centaines de milliers
d’hommes qui a conquis l’ensemble de
ces territoires à l’issue de campagnes
militaires très éprouvantes aussi bien en
Palestine et en Syrie à partir de l’Égypte
(le général Edmund Allenby entre en
vainqueur à Jérusalem en décembre
1917) qu’en Mésopotamie à partir de
Bassorah (le général Frederick Maude est
à Bagdad le 11 mars 1917). Clemenceau,
outre qu’il n’a aucun penchant pour les
conquêtes coloniales, n’a toujours qu’une
seule priorité : l’Allemagne. Il veut obtenir
la restitution de l’Alsace-Lorraine, le
désarmement de son armée, l’obtention
de réparations pour les dommages subis,
la démilitarisation de la rive gauche du
Rhin...
Dans ce contexte, la confrontation entre
les deux hommes sur le Moyen-Orient a
connu de multiples épisodes mais, pour
l’essentiel, il y a eu deux séquences.
Le sort de la Palestine et du vilayet de
Mossoul est réglé au
cours d’un bref tête-à-
tête à l’ambassade de
France à Londres début
décembre 1918. En voici
les minutes rapportées
par les historiens :
Clemenceau : « De quoi
devons-nous discuter ?»
Lloyd George : « De la
Mésopotamie et de la
Palestine ». « Dites-moi
ce que vous voulez ?» dit Clemenceau. « Je
veux Mossoul » rétorque le Premier ministre.
« Vous l’aurez », répond le président du
Conseil. « Quoi d’autre ? », ajoute-t-il :
« Je veux aussi Jérusalem », répond Llyold
George. « Vous l’aurez », dit Clemenceau,
tout en précisant que pour Mossoul, son
ministre des Affaires étrangères, Stephen
Pichon, fera « quelques difficultés »...
La Palestine passe ainsi sous domination
britannique et Mossoul est rattaché à la
Mésopotamie. Ces deux décisions auront
une importance capitale pour le destin des
peuples de ces territoires. En Palestine,
Londres va pouvoir mettre en œuvre la
promesse faite au mouvement sioniste
par Lord Balfour, en novembre 1917, d’y
construire un « Foyer national juif ». À
Mossoul, riche en pétrole, les Kurdes vont
se retrouver, quelques années plus tard,
après un arbitrage de la SDN en 1925,
dans le nouvel État irakien... Mais ce n’est
pas suffisant pour Lloyd George. Il voudrait
que la France n’ait pas le contrôle de la
Syrie, à la fois pour réduire le potentiel
de puissance de ce rival dans la région
et pour tenter d’honorer la promesse d’un
État arabe souverain faite au chérif Hussein
en soutenant son fils, Fayçal, qui veut
l’établir avec Damas pour capitale. Mais
Clemenceau ne lâche rien. Il s’en tient aux
termes des accords Sykes-Picot et finit par
obtenir le retrait des troupes britanniques
de cette zone. Elles seront remplacées,
en novembre 1919, par l’armée française
dirigée par celui qui devient le haut-
commissaire de la France au Levant, le
général Henri Gouraud, fervent partisan de
l’Empire. En avril 1920, la conférence de
San Remo viendra entériner ces décisions
en confiant aux deux puissances coloniales
des mandats sur ces pays. Dès lors,
chacune des deux assume entièrement les
décisions concernant l’avenir des territoires
dont elle a la charge.
En 1920, après avoir
chassé Fayçal de Damas
par les armes, la France
va créer plusieurs États
en instrumentalisant
les différences
communautaires et
ethniques. Ainsi, à côté
du grand Liban, sont
créés l’État d’Alep, l’État
de Damas, le territoire des
Alaouites et le Djebel druze. Tandis que,
sous la pression des armées de Mustafa
Kemal, elle renonce à toute ambition en
Cilicie (accord d’Angora en octobre 1921) ;
cet abandon entraîne des conséquences
terribles pour les dizaines de milliers
d’Arméniens rescapés du génocide qui vont
subir à nouveau les agressions de l’armée
turque. Le sort du sandjak d’Alexandrette,
reste en suspens jusqu’en 1939, date à
laquelle il est donné à la Turquie. De son
côté, la Grande-Bretagne crée l’Irak sur le
trône duquel elle installe Fayçal, tandis que
la Transjordanie est confiée à Abdallah,
un autre fils du chérif Hussein ; quant à
sa politique en Palestine, elle tourne vite
au désastre entre les aspirations sionistes
renforcées par une immigration juive de
plus en plus importante et le nationalisme
palestinien qui aspire à un État.
Les frontières ainsi imposées par les
puissances coloniales ne tiennent aucun
compte des aspirations des peuples.
Chacune trace des lignes dans le sable en
fonction de ses propres intérêts stratégiques
et des compromis territoriaux passés avec
l’autre puissance. En d’autres termes, on
1 - Dernier ouvrage paru en collaboration avec Pierre Blanc : Violence et politique
au Moyen-Orient, Presses de Sciences Po, 2014.
La France est loin
d’avoir une vision
globale comparable.
Les intérêts de
l’Empire sont en
Afrique et au Maghreb
pas au Moyen-Orient

Nationalismes, autoritarismes, crises
et conflits : retour de la géopolitique ?
dossier
26 / avril 2015 / n°450
crée ainsi des territoires avec des frontières
sans jamais poser la question centrale
de l’adéquation entre l’État et sa société.
Cette question est évacuée parce que les
responsables politiques britanniques et
français savent parfaitement que cette
prise en compte risquerait de ruiner
leurs constructions. Très
révélateur à cet égard est
le sort réservé par Paris et
Londres à la commission
que le président Wilson
voulait envoyer au
Moyen-Orient pour
connaître les souhaits
des populations. Lloyd
George et Clemenceau
feront tout pour empêcher
qu’elle voie le jour. Elle fut
quand même créée, mais seulement avec
des participants américains, Henry King et
Charles Crane et partit faire son enquête au
cours de l’été 1919. Son rapport pourtant
fort instructif ne fut jamais utilisé...
Pour une refondation du
Moyen-Orient
Un siècle plus tard, que reste-t-il des
accords Sykes-Picot ou plutôt des logiques
politiques qu’ils ont enclenchées ?
Les Kurdes avaient, dès cette époque,
revendiqué un État. Une délégation
en avait défendu le principe devant la
Conférence de la paix en 1919. Ils furent
entendus puisque le traité de Sèvres
(article 64) en envisage la possibilité en
ces termes : « Si la population kurde ...
s’adresse au Conseil de la Société des
Nations en démontrant qu’une majorité
de la population de ces régions désire
être indépendante de la Turquie, [celle-
ci] s’engage... à se conformer à cette
recommandation... Aucune objection ne
serait soulevée par les Puissances alliées
à l’encontre de l’adhésion volontaire à
cet État kurde indépendant, des Kurdes
habitant la partie du Kurdistan comprise
dans le vilayet de Mossoul ». On connaît
la suite. Mustafa Kemal récuse ce traité et
impose, par les armes, un État turc qui ne
laisse aucun espace à une indépendance
kurde, tandis que la SDN décide finalement
de rattacher le vilayet de Mossoul au
nouvel État irakien. Un peu plus tard, en
Palestine, les Arabes revendiquent, eux
aussi, un État dans les limites territoriales
du mandat britannique. Les tentatives de
partage en un État juif et un État arabe,
en 1937 comme en 1947, ont avorté
dans des conditions dramatiques et les
Palestiniens sont toujours aujourd’hui en
quête d’un État.
Si les décisions prises dans cette période
cruciale des années
1920 ont donc laissé
des nations sans État,
elles ont aussi créé des
États dans lesquels,
au départ, il n’y avait
guère de sentiment
national. Par la suite, les
situations ont évolué de
manière singulière dans
chacun de ces nouveaux
espaces politiques avec
progressivement, ici et là, l’émergence
d’une identité nationale qui est demeurée
le plus souvent fragile notamment parce
que, nulle part, elle ne fut citoyenne.
Comment, en effet, construire durablement
des nations sans permettre que chacun
puisse s’y retrouver pleinement en tant
que citoyen au-delà de ses sentiments
d’appartenance à une communauté, à une
confession ou à une ethnie ? La formule des
quotas instaurée au Liban pour tenter de
fonder un système démocratique n’a pas
réussi à produire ce ciment national, même
si, en même temps, un vrai sentiment
d’appartenance au Liban existe bien
chez tous les Libanais. Si la volonté de
vivre ensemble et d’être Libanais est très
prégnante, on en sent bien aussi la fragilité
surtout dans un environnement régional
toujours très conflictuel où, de surcroît,
l’État n’assume jamais le rôle qui devrait
être le sien. Au Liban, rien n’est donc
vraiment réglé dans la relation dialectique
complexe entre société, nation et État.
En Irak, les fractures entre Arabes et Kurdes
n’ont jamais été dépassées. Les premiers
ayant toujours dominé les seconds, du
moins jusqu’à ces dernières années, qui
ont permis aux Kurdes d’affirmer leur
autonomie au point qu’on ne voit pas
pourquoi aujourd’hui ils y renonceraient.
De facto, ils ont déjà leur État. Comme
si, désormais, l’esprit de l’article 64 du
traité de Sèvres devenait enfin une réalité.
Et, chez les Arabes irakiens, les sunnites
ont toujours dominé les chiites au point
que la situation actuelle semble être une
sorte de revanche de l’Histoire pour les
chiites. La Syrie, enfin, apparaît comme le
pays où le sentiment national a été le plus
abouti. Cela tient sans doute notamment
au rôle historique dominant que Damas a
longtemps exercé dans le « bilad al-sham »
où la référence à cet espace était très
forte. C’est d’ailleurs là que Fayçal avait
tenté d’établir les bases de «son» royaume
arabe écrasé par les troupes françaises à
la bataille de Maysalloun en août 1920.
Et pourtant, face à la tragédie absolue
qu’elle traverse aujourd’hui, il semble bien
que la Syrie soit aussi rattrapée par un
confessionalisme que beaucoup cherchent
à instrumentaliser.
Les ruptures dramatiques auxquelles on
assiste aujourd’hui ne pourront donc être
durablement résorbées qu’au prix d’une
véritable refondation de la géopolitique
de la région avec une restructuration de
certains États et l’émergence de nouveaux.
Autant dire que cette séquence historique
risque de durer encore très longtemps. ■
En 1920, après
avoir chassé Fayçal
de Damas par les
armes, la France va
créer plusieurs Etats
en instrumentalisant
les différences
communautaires et
ethniques
1
/
3
100%