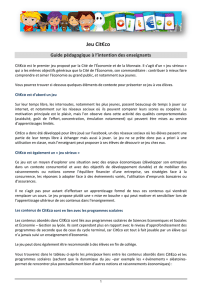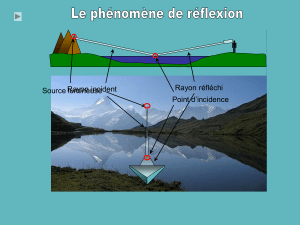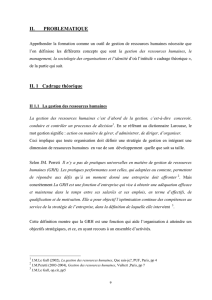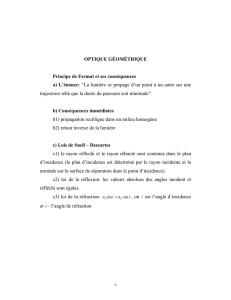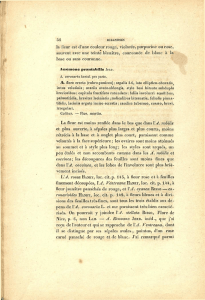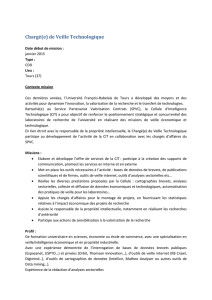Histoire des idées sur la lumière, de l`Antiquité au - Hal SFO

Histoire des id´ees sur la lumi`ere, de l’Antiquit´e au d´ebut
du XX si`ecle
Christian Bracco
To cite this version:
Christian Bracco. Histoire des id´ees sur la lumi`ere, de l’Antiquit´e au d´ebut du XX si`ecle.
Licence / L2. 2004. <sfo-00321414>
HAL Id: sfo-00321414
https://hal-sfo.ccsd.cnrs.fr/sfo-00321414
Submitted on 15 Sep 2008
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

HISTOIRE DES IDÉES SUR LA LUMIÈRE
DE L’ANTIQUITÉ AU DÉBUT DU XX° SIÈCLE
Le texte qui suit retrace l’évolution des idées sur la lumière de l’Antiquité au début du
XX° siècle. Il a été rédigé à partir de documents originaux et s’appuie sur de nombreuses
citations. C’est à partir de ce texte de 160 pages qu’a été extraite la partie « Histoire » du
cédérom Histoire des idées sur la lumière, de l’Antiquité au début du XX° siècle. Ce texte a
bénéficié des remarques de Gisèle Krebs et de Bernard Maitte.
Le cédérom « Histoire des idées sur la lumière » (C. Bracco, G. Krebs, R. Charrier, F.
Albrecht) qui a été réalisé à partir de ce texte, a obtenu la prix Arnulf-Françon de la SFO (co-
lauréat 2005). J’en remercie une nouvelle fois vivement la SFO. Il a également obtenu le label
RIP (Reconnu d’Intérêt Pédagogique) et a fait partie de la sélection 2004 du prix Roberval. Il
figure aujourd’hui parmi les ressources de la clé USB « Une clé pour démarrer » distribuée
annuellement par le ministère aux nouveaux enseignants de physique-chimie. Dans le
cédérom, figurent une trentaine d’expériences d’optique filmées et scénarisées, qui sont des
transpositions modernes d’expériences historiques reprises dans l’enseignement. Des
compléments philosophiques permettent de situer les connaissances scientifiques dans un
cadre plus vaste. Le cédérom a été édité par le CRDP de Nice en 2004 et est diffusé dans le
réseau Scérén du CNDP.
Depuis 2004, je travaille avec Jean-Pierre Provost, professeur à l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, sur les quanta et la relativité. Nos travaux ont donné lieu à toute une série
d’articles, à destination des enseignants du second degré et du supérieur, des physiciens
théoriciens et des historiens de la physique. Vous en trouverez la liste ci-dessous. Ils viennent
compléter, et réactualiser, la dernière partie du présent texte (p. 128-154).
Je me tiens à votre disposition pour toute remarque éventuelle.
Nice, septembre 2008.
Christian Bracco
Maître de Conférences à l’IUFM de Nice
UMR Fizeau, Université de Nice-Sophia Antipolis
Chercheur Associé à l’équipe Histoire de l’Astronomie, Syrte, Observatoire de Paris.

Quanta
J.-P. Provost et C. Bracco, Einstein’s quanta and the « true » volume dependence of the black
body entropy, European Journal of Physics, 29 5 (2008), 1085-1091
C. Bracco, J.-P. Provost, The quanta in Einstein’s 1905 relativity theory, in Albert Einstein
Century Anniversary, Paris (France), juillet 2005, AIP Conference Proceedings, Alimi-Füfza
éditeurs, (Melville : New York, 2006) vol. 861, 1076-1080.
C. Bracco, J.-P. Provost, Quanta de Planck, d’Einstein et d’ « aujourd’hui », Bulletin de
l’Union des Professeurs de Spéciales, n° 210, avril 2005, p.21-38 et Bulletin de l’Union des
Physiciens, n° 877-878, octobre/novembre 2005, p. 909-928.
B. Raffaelli, J.-P. Provost, C. Bracco, Un problème d’oscillateurs : la formule de Planck,
Bulletin de l’Union des Physiciens, n° 885, p. 735-739.
Relativité
J.-P. Provost, C. Bracco, La théorie de la relativité de Poincaré de 1905 et les Transformations
Actives, Archive for History of Exact Sciences, 60 (2006), 337-351
C. Bracco, J.-P. Provost, La relativité de Poincaré de 1905, Théorie quantique des champs :
Méthodes et applications, Actes de l’école de physique théorique de Jijel, 2006, Boudjedaa-
Makhlouf éditeurs, Collection Travaux en cours (Paris : Hermann, 2007), vol. 68, 323-354.
J.-P. Provost, C. Bracco, G. Sanguinetti, Poincaré et l’éther relativiste, Bulletin de l’Union des
Professeurs de Spéciales, 211, juillet 2005, p.11-3

2
I. LA VISION DANS L’ANTIQUITE. ........................................................................... 5
I.1 Lucrèce et le point de vue des atomistes. ....................................................................................................... 5
I.2 Platon et la rencontre de deux « feux ».......................................................................................................... 7
I.3. Aristote et la théorie de la propagation. ....................................................................................................... 8
I.4. Euclide : le rayon lumineux. Théon d’Alexandrie..................................................................................... 10
I.5. Héron d’Alexandrie : le plus court chemin. ............................................................................................... 13
I.6. Galien et le rôle de l’œil................................................................................................................................ 14
I.7. Ptolémée et la mesure physique................................................................................................................... 14
II. LA LUMIERE DANS LA SCIENCE ARABE. ....................................................... 15
II.1. Al-Kindi ....................................................................................................................................................... 15
II.2. Ibn Sahl et la réfraction.............................................................................................................................. 15
II. 3 Ibn Al-Haitham : la formation des images................................................................................................ 16
III. L’EPOQUE MEDIEVALE. ................................................................................... 20
III.1. Robert Grosseteste..................................................................................................................................... 21
III.2. Roger Bacon............................................................................................................................................... 21
IV. L’EXPLOSION DES CONNAISSANCES. .......................................................... 24
IV.1. Della Porta.................................................................................................................................................. 24
IV.2. Galilée : la lunette astronomique.............................................................................................................. 24
IV.3. Kepler et l’optique..................................................................................................................................... 26
V. UNE OPTIQUE MECANISTE ET FORMALISEE. ............................................... 28
V.1. Descartes et le modèle mécanique de la lumière....................................................................................... 28
V.2. Fermat et la théorie du temps le plus bref. ............................................................................................... 33
V.3. Leibniz et la voie la plus aisée..................................................................................................................... 36
VI. DECOUVERTE DE LA DIFFRACTION. ............................................................. 37
VII. UN MODELE ONDULATOIRE DE LA LUMIERE.............................................. 42
VII.1. Hooke : l’impulsion lumineuse................................................................................................................ 42
VII.2. Huygens : surfaces d’ondes. .................................................................................................................... 47

3
VIII. UNE PREMIERE MESURE INDIRECTE DE LA VITESSE DE LA LUMIERE.. 53
IX. L’OPTIQUE DE NEWTON. ................................................................................. 55
IX.1. L’attraction universelle.......................................................................................................................... 55
IX.2. Les couleurs................................................................................................................................................ 57
IX.3. Les « lames minces ».................................................................................................................................. 60
IX.4 . L’ « inflexion de la lumière ». ................................................................................................................. 62
X. LA LUMIERE AU SIECLE DES LUMIERES. ...................................................... 63
X.1. Bradley et la vitesse de la lumière.............................................................................................................. 63
X.2. Maupertuis : genèse du principe de moindre action. ............................................................................... 65
X.3 Euler. ............................................................................................................................................................. 70
X.3.1. Euler et le principe de moindre action. .................................................................................................. 70
X.3.2. Euler et la lumière.................................................................................................................................... 71
X.4. Nicolas de Malebranche.............................................................................................................................. 71
X.5. Modèles corpusculaires et ondulatoires..................................................................................................... 72
XI. UN NOUVEAU PHENOMENE? LA POLARISATION DE LA LUMIERE. .......... 73
XII. LES INTERFERENCES DE LA LUMIERE. ....................................................... 77
XIII. FRESNEL ET LE TRIOMPHE DE LA THEORIE ONDULATOIRE................... 79
XIII.1. Fresnel : une nouvelle théorie ondulatoire. .......................................................................................... 79
XIII.2. Diffraction et Interférences.................................................................................................................... 80
XIII.3. Lumière polarisée. .................................................................................................................................. 90
XIII.4. Une nouvelle théorie ondulatoire. ......................................................................................................... 92
XIII.5. L’entraînement de l’éther par les corps en mouvements. ................................................................... 94
XIII.6. Conclusion sur les travaux de Fresnel. ................................................................................................. 98
XIV. LES VERIFICATIONS EXPERIMENTALES. ................................................... 98
XIV.1. L’ « expérience cruciale » de Léon Foucault. ....................................................................................... 98
XIV.2. Les travaux d’Hippolyte Fizeau. ......................................................................................................... 101
XIV.2.1 La mesure directe de la vitesse de la lumière. .................................................................................. 101
XIV.2.2 Fizeau et l’entraînement de l’éther.................................................................................................... 103
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
1
/
168
100%