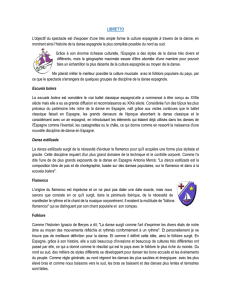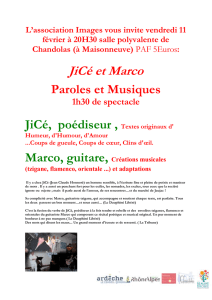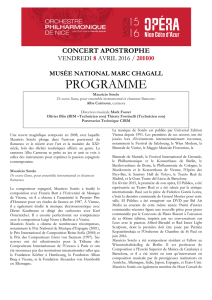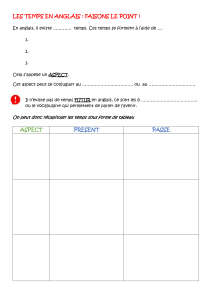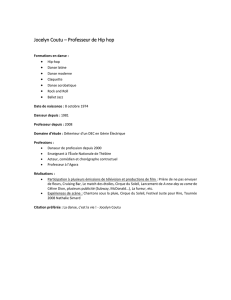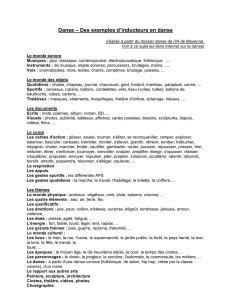la danse flamenca et ses enjeux identitaires

Article pour l’obtention du Master 2 d’Anthropologie sociale et historique
Recherche effectuée avec le soutien du ministère de la culture et de la communication
Taconeos et bata de cola à Toulouse
La danse flamenca et ses enjeux identitaires
Sarah De Oliveira
Sous la direction de Claudine Vassas
EHESS
Année 2006-2007
1

Les cigales nettes
Comme des Carmen
Jouent des castagnettes
Sur leur abdomen
Et le vent se pâme
En longs soubresauts
Comme une Gitane
Dans un flamenco
Et le vent se pâme
(Claude Nougaro)
2

La danse flamenca à Toulouse : comment aborder ce phénomène ? A travers la
question de la mémoire de l’immigration espagnole ? Celle d’un « patrimoine immatériel
culturel » propre à un groupe ? Celle des relations interculturelles ? Celle de l’acte de danser ?
Ou bien encore celle des représentations attachées à cette forme chorégraphique ? Cet article a
pour objet la compréhension des enjeux de cette danse dans la construction identitaire des
immigrés espagnols et plus particulièrement de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Une
construction identitaire qui n’est jamais finie, qui va et vient entre crise et épanouissement
car, en ce qui concerne l’identité, l’unité et la continuité ne sont jamais acquises. Dès lors,
l’identité se doit d’être étudiée en tant que « foyer virtuel » (Lévi-Strauss, 1977, p.228) qui
n’existe pas mais auquel on croit et qu’on a besoin d’utiliser pour vivre et agir avec les autres.
Ce rapport entre celui qui est identifié et celui qui identifie, où l’identifiant peut aussi
être soi-même, donne lieu à des identités multiples. C’est de la configuration dynamique de
toutes ces différentes identifications que naît l’identité personnelle. Or, en tant qu’art, et
d’autant plus en tant qu’art de spectacle, la danse flamenca à Toulouse montre sans cesse son
caractère d’objet « destiné à » et ce dans un cadre interculturel entre Espagnols issus de
l’immigration et Français. J’essaierai alors de montrer en quoi, danser le flamenco à Toulouse
est une occasion pour ces Espagnols de s’identifier à leur culture d’ « origine » et d’être
identifiés comme détenteurs de cette culture. Les guillemets qui encadrent le mot « origine »
sont là pour rappeler la virtualité de ce terme car, comme l’a montré J. L. Amselle (2001b,
p.26), les cultures du monde sont depuis toujours l’objet d’un continuel brassage, de sorte que
celles d’aujourd’hui ne portent que sur des produits résultant des collages antérieurs et non sur
des segments originaires de cultures : « Un patchwork de patchwork en quelque sorte… ».
Je n’aborderai donc pas la danse flamenca en tant que pratique artistique corporelle,
mais comme fait social, comme siège et vecteur de représentations symboliques. Il ne s’agit
pas pour autant de nier le simple goût de la technique ou de la création ; il s’agit simplement
d’une approche parmi tant d’autres envisageables – et souhaitables – pour comprendre ce
phénomène. Qui plus est, d’autres chercheurs, tels que G. Didi-Huberman (2006) ou T.
Martinez de la Peña (1969), ont déjà abordé la danse flamenca dans cette perspective qu’on
pourrait qualifier d’esthétique. Mais ces travaux sont des exceptions dans la mesure où la
grande majorité des recherches sur le flamenco concerne la musique. C’est donc dans le
domaine musical que les enjeux identitaires ont été étudiés. Ils l’ont largement été en
Andalousie par des anthropologues comme Thède (1999) ou Fayssinet (1994, p.12) pour qui
« le flamenco fonctionnerait comme un signifiant à plusieurs signifiés, dont les deux
fondamentaux seraient l’un andalou, l’autre gitan ». Avec la constitution de gouvernements
3

autonomes en 1978, de nombreux anthropologues espagnols se sont également intéressés au
flamenco comme vecteur d’une identité andalouse régionale. Hors des frontières andalouses,
la problématique de l’identité a fait l’objet de travaux sur les relations entre Gitans et
flamenco dans le Midi français. En revanche, dans le sud-ouest, la participation de cette danse
aux stratégies identitaires des Espagnols n’a pas encore été étudiée. Or, dans un premier
temps, on verra qu’à Toulouse la danse flamenca actuelle, en tant que fruit de différentes
immigrations espagnoles, offre aux dernières générations une occasion de s’approprier un
fragment de leur « culture d’origine » - fragment particulièrement emblématique de
l’Espagne. Je montrerai ensuite en quoi la différenciation culturelle mise en place par cette
pratique participe à la construction identitaire des jeunes espagnols, et des moins jeunes ; mais
également quelles en sont ses limites.
C’est en prenant moi-même des cours de flamenco depuis deux ans, que j’ai pu
constater certaines spécificités justifiant l’étude de l’enjeu identitaire présent dans cette
pratique. J’ai alors approfondi mon travail de terrain, pendant sept mois, entre 2006 et 2007,
en assistant aux cours d’autres écoles et en m’entretenant avec un certain nombre de danseurs
et de musiciens.
La première particularité constatée réside dans l’organisation des cours au sein
d’ « académies » flamencas. Qu’entend-on par « académie » ? Il s’agit d’écoles de danse
flamenca avec un fonctionnement strictement structuré : deux à trois cours quotidiennement
assurés dans lesquels sont répartis selon le niveau (débutant, moyen, avancé) une centaine
d’élèves en moyenne. Or, si Toulouse n’est peut-être pas la ville française qui compte le plus
grand nombre de cours de danse flamenca, elle est celle qui compte le plus grand nombre
d’académies : sept d’après mon recensement. A Paris par exemple, les cours de flamenco sont
nombreux mais ils prennent place dans des centres de danse, à côté des cours de salsa, de hip-
hop, de modern’ jazz… A Nîmes, où les cours de flamenco sont également nombreux, ils se
font soit dans des centres comme à Paris, soit au sein d’associations. Mais, si à Toulouse, les
académies ont une résonance particulière, d’autres cours de flamenco ont également lieu au
sein de structures telles que l’université du Mirail, le centre de danse James Carlès ou encore
des associations espagnoles telles que Casa de España ou ¡Animo!, chacun ayant une
vingtaine d’élèves. Ces différentes formes donnent lieu à deux courants distincts : d’un côté
celui, dominant, des académies, et de l’autre celui, plus marginal, des « détracteurs » du
modèle académique. Comme le montre la carte de Toulouse ci-après, ces deux courants
conduisent à la multiplication des lieux de danse flamenca (indiqués par des points rouges sur
le plan) offrant à tous les quartiers de la ville sa « place flamenca ».
4

5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%