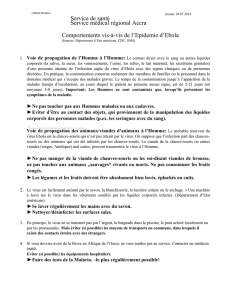La maladie d`Aujeszky : facteurs épidémiologiques importants

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1985, 4 (1), 21-32.
La maladie d'Aujeszky :
facteurs épidémiologiques importants
et points essentiels de la lutte contre la maladie*
G. WITTMANN**
Résumé : La maladie d'Aujeszky (MA) se rencontre partout dans le monde, là
où il existe une forte densité de porcs. En Europe, elle est largement répandue
et seuls quelques pays sont épargnés.
Le virus de la maladie d'Aujeszky (VMA) est moyennement résistant à la
chaleur et très résistant au froid et aux températures moyennes. Le pH entre 5
et 12 n'a pas d'action sur le virus.
Les désinfectants les plus efficaces sont les produits chimiques qui libèrent
du chlore et le formol. La soude caustique est moins efficace. Pour désinfecter
le lisier, il est recommandé d'utiliser la chaux.
Le VMA est très résistant dans les conditions naturelles d'environnement
grâce à sa stabilité vis-à-vis du pH et de la température.
Les porcs sont les principaux hôtes du virus, bien qu'un grand nombre
d'autres espèces puissent être infectées naturellement ou expérimentalement.
Les animaux s'infectent principalement par la voie respiratoire et/ou diges-
tive. Le virus peut également être transmis par la mère au fœtus. La contagion
peut également se faire par la saillie ou l'insémination artificielle. Le virus
n'est pas très contagieux.
La multiplication primaire du virus a lieu au niveau du rhinopharynx et du
tractus respiratoire. Le VMA envahit le système nerveux central par la voie
nerveuse. Le virus est disséminé dans l'organisme par les lymphocytes et les
macrophages.
Le virus est éliminé principalement par le jetage et la salive mais il est aussi
présent dans la semence, les écoulements vaginaux et le lait.
L'infection par le VMA provoque la formation d'anticorps et une immu-
nité à médiateur cellulaire.
Le génome du VMA persiste chez les porcs infectés, à l'état latent, toute
leur vie durant. Il peut être réactivé par un stress et il s'ensuit une excrétion du
virus.
La vaccination des porcs permet de contrôler avec succès les foyers de
maladie clinique. On utilise des vaccins inactivés ou des vaccins vivants, ces
derniers comportant plus de risques. Les porcs vaccinés ne sont protégés que
contre une atteinte virale modérée. Lors d'atteinte massive, le virus se multi-
plie dans l'organisme de l'animal infecté et provoque une infection latente per-
* Rapport de synthèse sur le thème I de la 11e Conférence de la Commission régionale de l'O.I.E.
pour l'Europe. Vienne, 25-28 septembre 1984. Traduction du rapport original intitulé : « Aujeszky's
disease : factors important for epizootiology and control ».
** Präsident und Professor, Bundesforchungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Paul-Ehrlich
Str. 28, P.O. Box 1149, 7400 Tübingen (Rép. Féd. d'Allemagne).

—
22 —
manente.
La
vaccination
des
autres espèces animales
a
donné
des
résultats
contradictoires.
La
MA est
enzootique dans
les
régions à forte densité de porcs,
où
la pro-
duction intensive
des
élevages industriels spécialisés
est
génératrice
de
nom-
breux déplacements d'animaux.
Par
conséquent,
la
répartition
de la
maladie
à
l'intérieur
d'un
même pays peut ne
pas
être uniforme.
Du point
de vue
épidémiologique, les porcs infectés
par le VMA
représen-
tent la principale source
de
contagion
sur de
grandes distances.
Les
stations
de
monte publique
de
verrats
et les
centres d'insémination artificielle porcine,
infectés
par le
VMA, sont aussi
des
sources
de
contamination. Divers vecteurs
peuvent intervenir dans
la
transmission
du
virus
sur de
courtes distances.
La
transmission aérienne
du
virus
est
encore controversée.
L'obligation
de
déclarer les foyers
de MA et la
réalisation d'enquêtes séro-
logiques sont
des
préalables nécessaires
à la
prophylaxie
de
cette maladie.
D'autres mesures réglementaires doivent être prises
à
cette
fin.
La
vaccination
ne permet
pas
d'aboutir
à
l'éradication
de
la
MA.
Elle empêche
les
pertes éco-
nomiques, mais ne fait
pas
obstacle
à la
circulation
du VMA
dans
les
trou-
peaux vaccinés.
La seule méthode efficace pour aboutir
à
l'éradication
de la MA est le
recours
à
l'abattage systématique
de
tous
les
troupeaux dans lesquels
se
trou-
vent
des
animaux
à
sérologie positive. Cependant, elle
est
très onéreuse dans
les pays très infectés. Menés
sur de
vastes zones, les programmes d'assainisse-
ment
des
élevages
de
porcs sont, aussi, très onéreux
et
demandent beaucoup
de temps, sans
que
leur succès soit assuré.
Pour empêcher l'introduction
du
VMA dans
les
régions
ou
les
pays indem-
nes
de MA, il
convient
de
contrôler soigneusement
le
commerce
des
porcs
et
de n'autoriser l'importation
que de
porcs
à
sérologie négative. Cette même
règle vaut pour l'importation
de la
semence.
Le
risque d'importer
du VMA
avec
de la
viande congelée
est
très faible.
MOTS-CLÉS : Porcins - Maladie d'Aujeszky - Europe - Epidémiologie -
Prophylaxie.
La maladie d'Aujeszky (MA) est une maladie contagieuse caractérisée par une
encéphalomyélite et une atteinte du tractus respiratoire (rhinopharynx, trachée,
poumon). La MA est provoquée par un virus ADN du groupe des Herpesvirus. Elle
peut atteindre un grand nombre de mammifères dans les conditions naturelles,
l'espèce porcine tenant une place particulièrement importante dans le cycle épidé-
miologique. Le présent rapport met l'accent sur quelques points présentant, directe-
ment ou indirectement, une importance pour l'épizootiologie et la prophylaxie de la
MA.
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
ET
INCIDENCE
DE LA MA
On rencontre la MA partout à travers le monde, dans les régions où existe une
forte densité d'animaux de l'espèce porcine. En Europe (8) aucun foyer de MA n'a
jamais été signalé en Norvège, en Finlande et dans
l'île
de Malte. L'incidence de la
MA dans les autres pays européens présente une intensité variable. La maladie est
enzootique en Belgique, en République Fédérale d'Allemagne, en France, en Répu-
blique d'Irlande, en Irlande du Nord et aux Pays-Bas. On observe des foyers spora-
diques en Tchécoslovaquie, au Danemark, en République Démocratique Alle-

— 23 —
mande, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, au Portugal,
en Suède et en URSS. La maladie est apparue exceptionnellement en Albanie, en
Autriche, en Bulgarie, en Espagne, en Grèce, en Pologne, en Roumanie et en
Suisse. Dans
l'île
de Chypre, aucun cas de MA n'a été signalé depuis 1967.
RÉSISTANCE DU VIRUS DE LA MALADIE D'AUJESZKY (VMA)
A LA TEMPÉRATURE ET AU pH
Le VMA est moyennement résistant à la chaleur. Il est inactivé à 60°C en 30 à
60 min, à 70°C en 10 à 15 min, à 80°C en 3 min et à 100°C en 1 min (42). Le virus
résiste au froid et aux températures moyennes. Il reste vivant pendant environ
6 semaines à 25°C, 9 semaines à 15°C, 20 semaines à 4°C et pendant des années à
-40°C.
Cependant, le virus est relativement sensible aux températures comprises
entre -18°C et -25°C qui l'inactivent en 12 semaines (24, 95).
Le pH entre 5 et 12 n'agit pas sur le virus. Même en présence d'un pH 2,0 ou
13,5,
il faut 2 à 4 heures pour que le virus soit complètement inactivé (13).
Si l'on associe à l'action d'une température élevée celle d'un pH très acide ou
très alcalin, on réduit considérablement le temps d'inactivation du virus (24).
DÉSINFECTANTS
L'effet des désinfectants dépend à la fois de la résistance du VMA aux facteurs
chimiques et des conditions ambiantes telles que la température, les éléments de
protection, etc., dans lesquelles se trouve placé le virus. Les données qui suivent
résultent d'expériences faites au laboratoire (21, 74). Il n'est pas conseillé d'utiliser
une solution de soude caustique, car le virus n'est pas suffisamment inactivé par
une solution de NaOH à 1% même après 6 heures (74). Une solution de formol à
3%
tue le virus en 3 heures environ. Les produits chimiques qui dégagent du chlore
sont les désinfectants les plus efficaces. Le virus est inactivé en 10 min par une solu-
tion de chloramine à 3%, en 30 min par une solution à 1%. Les composés d'ammo-
nium quaternaire sont aussi très efficaces. Pour une désinfection à grande échelle, il
convient d'adopter des désinfectants moins coûteux, tels que : lait de chlorure de
chaux, préparations de chlorure de chaux à dissoudre dans l'eau, chloramine à
l'état brut, produits contenant au moins 1% de formol
actif.
Pour la désinfection
du lisier, il est recommandé d'utiliser la chaux (20 kg Ca(OH)2 par m3) (37).
CONDITIONS AMBIANTES
Le VMA est très résistant dans le milieu naturel grâce à sa stabilité vis-à-vis du
pH et de la température. Cependant, les conditions ambiantes sont complexes et
impliquent l'intervention de facteurs favorables ou défavorables pour la survie des
virus.
Par conséquent, il faut considérer que les données figurant ci-après n'ont
qu'une valeur indicative.
Le virus n'est pas détruit au cours de la maturation de la viande de porc conser-
vée à 4°C (77); cependant, il est inactivé dans la viande à - 18°C en 35 à 40 jours
(25,
26). Dans l'urine, le virus se conserve pendant 3 semaines en été et 8 à

— 24 —
15 semaines en hiver (11). On pense que le virus persiste dans le lisier pendant envi-
ron 2 mois en hiver et 1 mois en été (39, 40), qu'il est inactivé par un traitement bio-
thermique du lisier en 5 jours en été et en 12 jours en hiver (56), qu'il est inactivé en
50 heures dans le lisier stocké à l'air (pH 9,6, température jusqu'à 44°C) (18). Dans
du fumier tassé, le virus est inactivé en 8 à 15 jours (40). On a trouvé du virus
encore vivant dans le sol au bout de 5 à 6 semaines (39). Dans le foin et la paille, le
virus peut résister 15 jours en été et 40 jours en hiver (67), alors que desséché sur
des sacs ou du bois, il ne résiste que 10 jours environ en été et 15 jours en hiver (40,
67).
On ne dispose d'aucune donnée pour les déchets de cuisine non traités. Dans
les produits soumis à une fermentation avec des Lactobacilles acidophiles, le VMA
est inactivé à 20°C et 30°C en 24 heures mais survit au moins pendant 48 heures à
10°C et 96 heures à 5°C (93).
ESPÈCES ANIMALES SENSIBLES
Les porcs sont les principaux hôtes du virus bien qu'un grand nombre d'autres
espèces puissent être infectées naturellement ou expérimentalement. Parmi les plus
importantes figurent : les bovins, les moutons, les chèvres, les chiens, les chats, les
renards d'élevage, les rats et les souris. Par contre, il est très difficile d'infecter le
cheval et les oiseaux; des doses importantes de virus sont nécessaires et elles doivent
être inoculées par voie intracérébrale, sous-cutanée ou intramusculaire. On consi-
dère que l'homme n'est pas sensible à la maladie.
Les taux de morbidité et de mortalité sont chez les porcs fonction de l'âge des
animaux. Ces taux décroissent avec l'âge; les jeunes porcs constituent donc la popu-
lation à risque le plus élevé. Dans les autres espèces, la maladie est généralement
fatale quel que soit l'âge des animaux, la guérison étant une exception.
MODALITÉS D'INFECTION
Les porcs s'infectent principalement par la voie respiratoire en inhalant les par-
ticules virales en suspension dans l'air ou en reniflant leurs congénères malades. La
contamination orale peut se produire avec les aliments ou avec le lait maternel con-
tenant du virus. La transmission du virus peut être transplacentaire. Elle peut aussi
intervenir au moment de la saillie ou de l'insémination. Le chien, le chat et les
autres carnivores ainsi que les souris et les rats s'infectent par voie orale en man-
geant de la viande, des déchets d'abattoirs ou des carcasses contaminés.
La sensibilité des animaux à l'infection est sous la dépendance de plusieurs fac-
teurs (12, 15, 25, 34, 43, 59, 60, 84, 86) : le degré de virulence de la souche virale, la
quantité de virus, la porte d'entrée, l'espèce animale, l'âge des porcs, l'effet de
stress et l'état physiologique de l'animal. Par exemple : il faut, par voie orale, une
plus grande quantité de virus pour infecter un animal que par la voie respiratoire;
de fortes doses de virus sont nécessaires pour infecter le rat par voie digestive alors
que de faibles doses suffisent par voie intramusculaire; le porcelet s'infecte avec des
quantités de virus moindres que le porc adulte; il faut plus de virus pour infecter un
bovin qu'il n'en faut pour un porc. Il faut, pour obtenir l'infection expérimentale
par voie respiratoire : avec un porcelet entre 101 et 103 DCT50*, avec un jeune porc
* DCT50 : dose cytopathogène 50%.

— 25 —
environ 104 DCT50, et avec un porc adulte 105 DCT50 (3, 12, 34). Pour les bovins, il
faut au moins 105 DCT50 (15 , 84).
On peut déduire de ce qui précède que le VMA n'est pas très contagieux. La
preuve en est qu'habituellement tous les porcs ou tous les bovins d'un élevage ne
s'infectent pas. Le pourcentage d'animaux infectés, dans un élevage, se situe entre
50%
et 90% chez les porcs et entre 3% et 60% chez les bovins. La contagion à
l'intérieur d'un troupeau dépend par conséquent surtout des possibilités de contact
direct entre animaux. Elle est maximale à l'intérieur d'une loge ou d'un parc, elle
est bien moindre de loge à loge ou de parc à parc.
MULTIPLICATION DU VIRUS
(17,
45, 59, 60, 83, 86)
Chez le porc, la multiplication primaire du virus a lieu dans la région rhino-
pharyngienne et dans l'appareil respiratoire. A partir de là, le virus envahit le
système nerveux central par la voie nerveuse. Le virus semble aussi gagner certains
organes et tissus grâce aux macrophages et aux lymphocytes (83). On peut aussi
admettre que le virus diffuse de façon centrifuge à partir du système nerveux central
vers toutes les autres parties du corps par la voie nerveuse.
L'intensité de la multiplication du virus varie selon les différentes parties du
corps.
Les plus grandes quantités de virus se trouvent toujours dans les sites de mul-
tiplication primaire du virus, spécialement les amygdales et les ganglions lymphati-
ques rétropharyngiens. Il est en quantités moindres dans les poumons, et on en
trouve peu dans le système nerveux central et les autres organes. Plus le virus se
multiplie dans un organe, plus longtemps il peut y être isolé. En conséquence, le
délai maximum pendant lequel on peut isoler du virus à partir d'un organe est de :
35 jours pour les ganglions lymphatiques de l'auge (ganglions sous-maxillaires et
rétropharyngiens) et pour les amygdales, 14 jours pour les poumons, 10 jours pour
le système nerveux central et 7 jours pour tous les autres organes.
Chez les bovins, la multiplication primaire du virus se fait également au niveau
du rhinopharynx et du thymus. Cependant, par la suite, on ne retrouve le virus que
dans le système nerveux central (47, 84).
EXCRÉTION DU VIRUS
Sur le porc infecté, le virus peut être isolé à partir de prélèvements faits par
écouvillonnage nasal, pendant 8 à 17 jours avec des titres maximum de virus com-
pris entre 105,8 et 108,3 DCT50 par écouvillon (30, 44, 45, 87) et à partir de prélève-
ments par écouvillonnage bucco-pharyngien pendant 18 à 25 jours avec des titres
allant jusqu'à 106 DCT50 (20). Le porc peut éliminer 105,3 DCT50 dans l'air en
24 heures au moment où l'excrétion atteint son pic (25). On peut trouver le virus
dans les sécrétions vaginales et préputiales (éjaculats) pendant 12 jours au plus (3,
48,
50) et dans le lait pendant 2 à 3 jours (39). Le virus peut être présent occasion-
nellement dans l'urine, mais il n'a jamais été isolé dans les fèces (3, 39) bien qu'on
ait pu l'isoler sur écouvillonnage rectal pendant 10 jours au plus (25). Il est impor-
tant de noter que l'excrétion virale commence avant l'apparition des symptômes cli-
niques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%