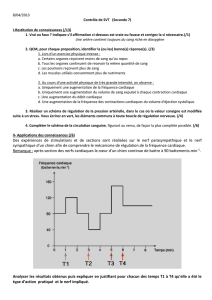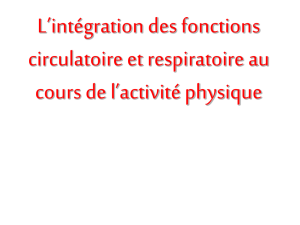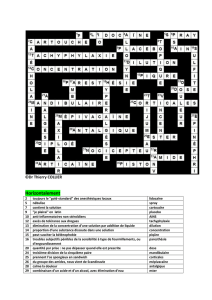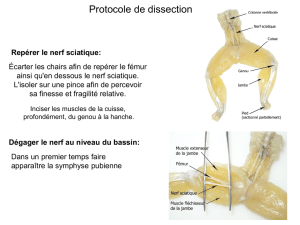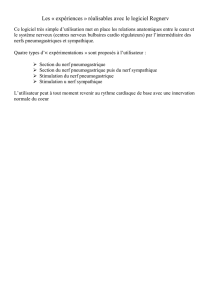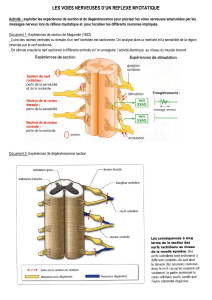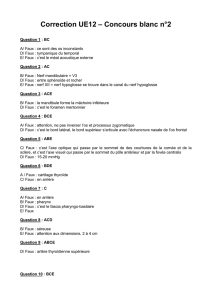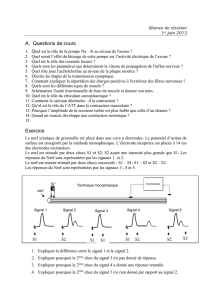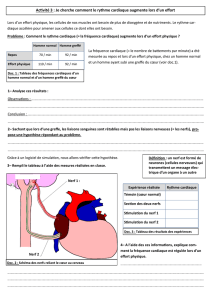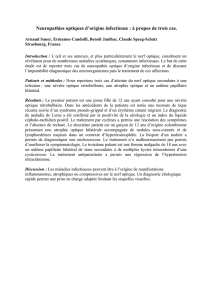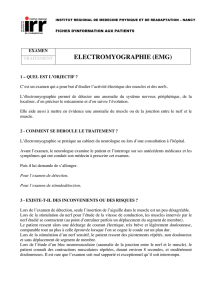Atteinte du nerf sup..

L’ÉPAULE est un complexe arti-
culaire composé de trois
articulations et de deux
espaces de glissement qui
permettent des mouvements amples
et rapides. Des sollicitations spor-
tives intenses, rapides, répétées et
effectuées suivant une amplitude
importante peuvent créer des
lésions microtraumatiques. Aucune
structure anatomique n’est épar-
gnée, qu’elle soit osseuse, capsu-
laire, tendineuse, musculaire ou
nerveuse.
L’atteinte microtraumatique du
nerf sus-scapulaire affecte surtout
de jeunes sportifs (moins de 25 à
30 ans), essentiellement masculins
et de bon niveau, pratiquant des
sports de lancer ou de service. Elle
concerne le bras dominant et peut
s’associer à d’autres lésions neuro-
logiques. Elle survient volontiers à
la suite d’une intensification bru-
tale de l’entraînement ou de la
compétition, ou à la suite d’un
geste violent. C’est la répétition de
gestes sportifs effectués dans des
amplitudes extrêmes (adduction
horizontale associée à une anté-
pulsion) qui semble être en cause.
Il s’agit en particulier de la fin du
mouvement de service (ou de
smash), du coup droit ou du
revers à une main.
Douleur nocturne et baisse
de l’efficience sportive
L’anamnèse retrouve la pré-
sence de douleurs de type neuro-
logique, c’est-à-dire sourdes, per-
manentes, préférentiellement
nocturnes, localisées à la face pos-
térieure de l’épaule ou à l’omo-
plate. Ces douleurs cèdent pro-
gressivement à l’arrêt de l’effort,
mais, du moins dans la descrip-
tion classique des symptômes, de
moins en moins facilement, en
même temps que l’efficience spor-
tive diminue (imprécision ges-
tuelle, fatigabilité). Ce qui amène
souvent le patient à consulter.
Parfois pauvre en symptômes
A l’examen clinique, la mobi-
lité de l’épaule, active et passive,
est généralement normale. Cepen-
dant, certains signes cliniques
évoquent fortement le diagnostic:
— la pression directe en regard
de l’échancrure coracoïdienne (à
DOSSIER FMC
N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002
!L’épaule neurologique
microtraumatique
correspond à la lésion
des nerfs circonflexe,
grand dentelé et sus-
scapulaire. Mais les
sports de lancer
(javelot, disque) ou de
service (tennis, volley-
ball ou handball)
favorisent plutôt
l’atteinte
microtraumatique du
nerf
sus-scapulaire. Si donc
votre patient discobole
— ou tennisman —
souffre de l’épaule,
pensez-y
systématiquement !
PAR LE
DRGILLES MONDOLONI*
SPORTS DE LANCER OU DE SERVICE
Sus-scapulaire
malmené
D.R.
L’ATTEINTE MICROTRAUMATIQUE
SURVIENT VOLONTIERS À LA SUITE D’UNE INTENSIFICATION
BRUTALE DE L’ENTRAÎNEMENT
1

mi-distance entre l’angle supéro-
interne de l’omoplate et de l’acro-
mion) est très douloureuse [voir
schéma];
— les tests isométriques contre
résistance mettent en évidence un
déficit souvent important de la
force de la rotation externe et plus
modéré de la force de l’abduction;
— la mise en adduction hori-
zontale et antépulsion passive
réveille des douleurs (mais il faut
avoir éliminé une pathologie
acromio-claviculaire);
—l’amyotrophie de la fosse
sous-épineuse (surtout) et de la
fosse sus-épineuse (parfois), bien
que souvent tardive, a une valeur
diagnostique primordiale.
Il est important de noter que le
tableau est parfois paucisympto-
matique, notamment au début de
l’évolution clinique (douleur noc-
turne minime, déficit très discret
de la force de la rotation externe),
ce pourquoi la recherche de cette
atteinte microtraumatique doit
être systématique.
Confirmation
par électromyogramme
Les examens complémentaires
sont dominés par l’électromyo-
gramme qui permet très souvent:
— de confirmer le diagnostic
(atteinte tronculaire);
— de localiser l’atteinte avec
précision (échancrure coracoï-
dienne ou défilé spino-glénoï-
dien);
— d’évaluer la gravité de l’at-
teinte (réinnervation);
— d’écarter enfin une associa-
tion lésionnelle possible avec le
nerf grand dentelé ou le nerf cir-
conflexe.
Les radiographies standard
d’épaule de face (trois rotations) et
de coiffe (de profil) permettent
d’éliminer une tendinopathie cal-
cifiante et une rupture de coiffe.
La RMN ou l’arthroscanner
complètent idéalement ce bilan et
recherchent en particulier un
kyste paraglénoïdien susceptible
de comprimer le nerf dans le défilé
spino-glénoïdien.
La prise en charge thérapeu-
tique, essentiellement médicale,
est surtout rééducationnelle. Elle
débute par une éviction sportive
obligatoire de durée variable (en
fonction des données cliniques et
paracliniques), mais bien souvent
supérieure à trois mois. Elle com-
porte surtout des infiltrations de
corticoïdes dans l’échancrure
coracoïdienne ou dans le défilé
spino-
glénoïdien. Elle peut associer des
anti-inflammatoires non stéroï-
diens, voire l’apport de vita-
mine B.
Priorité à la rééducation
La rééducation tient une place
privilégiée. Elle comporte la phy-
siothérapie, le renforcement mus-
culaire analytique des muscles de
la coiffe, différentes techniques de
massage, et vise surtout à corriger
le geste sportif en cause.
• La physiothérapie consiste
préférentiellement en une stimula-
tion électrique transcutanée
(TENS) à l’aide d’électrodes cuta-
nées produisant des courants de
basse fréquence. Elle agit sur le
circuit de la douleur (gate control
system) et permet d’obtenir une
réinnervation musculaire (recrute-
ment spatio-temporel d’unités
motrices).
• La rééducation à proprement
parler comporte des massages, des
DOSSIER FMC
N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002
UN AUTHENTIQUE SYNDROME
CANALAIRE
Le nerf sus-scapulaire est un nerf mixte sensitivo-moteur, qui innerve les
muscles sus-épineux et sous-épineux et qui a pour origine le plexus
brachial (C5-C6). Il gagne ensuite le creux sus-claviculaire, puis fran-
chit deux défilés (zone anatomique d’espace restreint) responsables de
sa pathologie:
— l’échancrure coracoïdienne, fermée par le ligament coracoïdien;
— le défilé spino-glénoïdien, sur le bord externe de l’épine de
l’omoplate, qui est limité par le ligament du même nom.
L’atteinte du nerf sus-scapulaire dans l’échancrure coracoïdienne
est la plus fréquente (75 % des cas) et retentit alors volontiers sur les
muscles sous-épineux et sus-épineux, alors qu’une atteinte du nerf
dans le défilé spino-glénoïdien ne touche habituellement que le muscle
sous-épineux.
Les trois ancrages fixes du nerf sus-scapulaire (plexus brachial,
échancrure coracoïdienne, défilé spino-glénoïdien) permettent d’expli-
quer la physiopathologie. En effet, dans les mécanismes d’adduction
horizontale et antépulsion extrême, le nerf se trouve étiré, voire com-
primé contre des reliefs osseux parfois « agressifs », ce qui crée un
authentique syndrome canalaire.
J.C. RIPA
J.C. RIPA
L’atteinte du nerf sus-scapulaire est fréquente, notamment dans
les sports de lancer ou de service. Elle touche préférentiellement de
jeunes sportifs de bon niveau et doit donc faire l’objet d’une recherche
systématique.
Le diagnostic, essentiellement clinique, complété éventuellement
par des examens complémentaires (électromyogramme), doit être le plus
précoce possible.
Le traitement est global et apporte environ 60 % de bons résul-
tats. Il comporte avant tout une éviction sportive d’au moins trois mois,
le recours à des thérapeutiques anti-inflammatoires et une longue réédu-
cation de l’épaule. On ne recourt à la chirurgie qu’après l’échec de ce
protocole
thérapeutique.
La compréhension et la correction du geste sportif en cause sont
les conditions indispensables à la guérison de cette pathologie et à la
prévention de la récidive. La correction de la « technopathie gestuelle »
est primordiale et permet d’éviter la récidive dans un souci d’épanouis-
sement de nos sportifs.
"
MESSAGES CLÉS
2

mobilisations passives de l’épaule
afin d’éviter l’apparition de rétrac-
tions musculaires ou d’une capsu-
lite.
• Le renforcement musculaire
analytique, essentiellement des
rotateurs externes, se fait de
manière isométrique, puis dyna-
mique, dans différents plans de
l’espace et optimise les sup-
pléances apportées par d’autres
muscles de l’épaule (petit rond,
notamment).
• La correction de la « techno-
pathie gestuelle » est comme tou-
jours essentielle. Elle repose sur la
limitation de l’adduction horizon-
tale extrême en fin de service au
tennis ou au volley-ball et en la
pratique du revers à deux mains.
Elle nécessite une participation
active du sportif, une collabora-
tion étroite avec l’entraîneur, voire
le changement de matériel. Elle
vise à optimiser l’action d’autres
groupes articulaires (jambes,
rachis), afin de permettre une
moindre sollicitation du complexe
articulaire de l’épaule dans les
mouvements de grande amplitude
(antéflexion, rotation du rachis,
meilleur déplacement des
membres inférieurs…). La reprise
du sport se fait très progressive-
ment et inclut une phase longue
de réadaptation à l’effort.
Libération chirurgicale
parfois nécessaire
Le traitement médical et réédu-
catif est efficace dans environ
60 % des cas, tous stades confon-
dus, mais les résultats sont
meilleurs quand le diagnostic est
précoce et quand le déficit moteur
est peu important. Dans le cas
contraire, et après une prise en
charge médicale et rééducative
inefficace menée pendant au
moins trois mois, une cure chirur-
gicale peut être envisagée. Elle
consiste à libérer le nerf sus-sca-
pulaire en conflit dans l’échan-
crure coracoïdienne ou le défilé
spino-glénoïdien par section du
ligament correspondant. ■
* Médecine et traumatologie du sport,
ostéopathie, Sartrouville [78] ; service de
médecine physique, Hôtel-Dieu, Paris.
DOSSIER FMC
N° 2169 - MARDI 22 JANVIER 2002
3
J.-M. Coudreuse, J.-N. Argenson, A. Delarque, C. Brunet, « Lésions du nerf
suprascapularis : traitement médical (pathologie traumatique du membre supé-
rieur chez le sportif) », Quinzième Journée de traumatologie du sport (J. Rodineau,
G. Saillant), Masson, 1997.
T.-H. Bouchet, G. Daubinet, « Lésions du nerf suprascapularis :
traitement chirurgical (pathologie traumatique du membre supérieur chez le
sportif) », Quinzième journée de traumatologie du sport (J. Rodineau, G. Saillant),
Masson, 1997.
J.-C. Chanussot, R.G. Danowski, Rééducation en traumatologie du sport (membre
supérieur); pp. 132-41, Masson, 1997.
J.-C. Chanussot, R.-G. Danowski, Traumatologie du sport, p. 459,
cinquième édition, Masson.
J. Rodineau, « Cinquante sites douloureux en traumatologie du sport: leur signi-
fication pathologique », Journal de traumatologie du sport, 1999, Masson.
"
BIBLIOGRAPHIE
1
/
3
100%