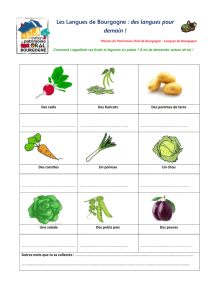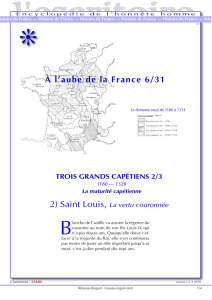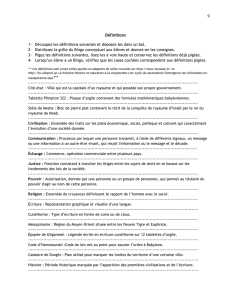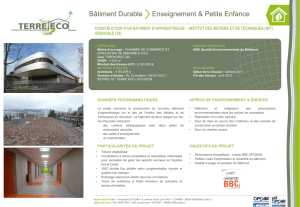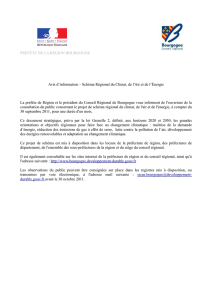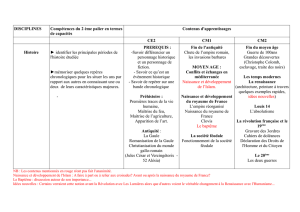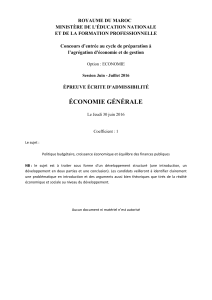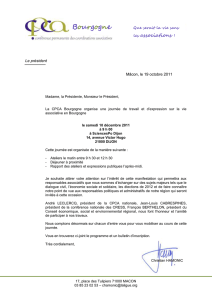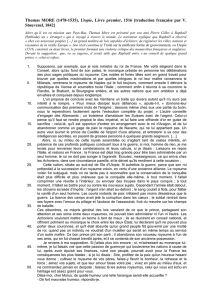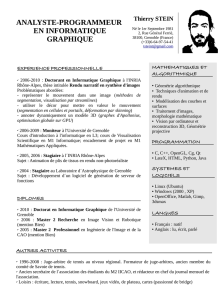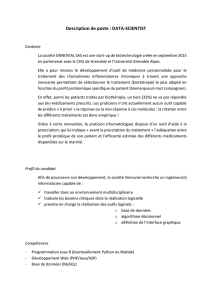le royaume de bourgogne autour de l`anmil

LE ROYAUME DE BOURGOGNE
AUTOUR DE L'AN
MIL
TEXTES RÉUNIS PAR
CHRISTIAN GUILLERÉ,]EAN-MICHEL POISSON,
LAURENT RIPART ET CYRILLE DUCOURTHIAL

Du
ROYAUME AUX PRINCIPAUTÉS
(SAVOIE-DAUPHINÉ,
Xe_XIe
SIÈCLES)
LAURENT R!PART
UNIVERSITÉ DE SAVOIE
Après la mort des rois Boson et Rodolphe, le
royaume d'Arles et de Vienne prit fin et alors
surgirent les deux comtés de Maurienne et
d'Albon: en Maurienne, le premier comte fut
Humbert Blanches-Mains.
Ginialogie d'Hautecombe (ca. 1342)
Au milieu du XIV· siècle, les moines cisterciens de l'abbaye
d'Hautecombe, où les comtes de Savoie avaient établi leur nécropole,
s'attachèrent
à
mettre par écrit la généalogie de la dynastie princière', Ils
commencèrent par évoquer les temps anciens, lorsque avaient régné les
rois Boson
(t
887) et Rodolphe [III]
(t
1032), avant d'expliquer qu'après
que le royaume de ces souverains eut disparu, avaient surgi
isurrexeruns)
les principautés de Savoie et du Dauphiné, autrement dit les comtés
de «Maurienne» et d'sAlbon
»,
pour reprendre les anciens titres que
les ancêtres de ces maisons princières avaient portés au XII" siècle.
Après ce prologue historique, les moines d'Hautecombe donnèrent la
généalogie des princes savoyards, en commençant par le comte Humbert
«Blanches-Mains »,le plus ancien des comtes de Savoie-Maurienne dont
ils conservaient la mémoire.
1
«Cbronica latina alsecomb« ..,
dans Monumente
Historie Patrie,
III
(Scriptom, 1),
D.
Promis
éd.,
Turin, 1840, col. 671-678, col. 678. Sur ce texte,
cf
A. PERRET,«L'abbaye
d'Hautecombe et les chroniques de Savoie .., dans
Actes du 90' congrèsnational des socittts
savantes (Nice.
1965),
Paris, 1968, p.669-684.
247

LE ROYAUME DE BOURGOGNE AUTOUR DE LÀN
MIL
Depuis la seconde moitié du XVIe siècle, les historiens de la mai-
son de Savoie ont recouru aux sources écrites dans l'espoir d'améliorer et
de corriger la tradition orale qui avait permis aux moines d'Hautecombe
d' établir leur généalogie des comtes de Savoie. Ils parvinrent aisément
à retrouver le premier comte Humbert, qui apparaissait, sans porter le
cognomen
de «Blanches-Mains», dans une vingtaine d'actes de la prati-
que donnés entre 1000 et 1042, entre le Rhône et la chaîne alpineê, Mal-
gré de multiples tentatives, ils ne parvinrent toutefois pas à identifier les
parents de ce comte Humbert et illeur fallut renoncer, comme l'avaient
déjà fait les moines d'Hautecombe, à remonter la généalogie princière
au-delà de la barrière de l'an Mil.
Sans doute purent-ils trouver une consolation en constatant que
dans le Dauphiné rival, les érudits ne parvenaient pas non plus à remon-
ter leur généalogie au-delà d'un certain Guigues, qui était cité pour la
première fois dans un acte de 996'. Il en allait de même en Genevois,
puisque les comtes de Genève n'apparaissaient guère qu'en 1001-10024,
mais aussi en Diois et en Valentinois, dont la dynastie comtale n'est attes-
tée qu'à partir de 985
5•
Quant aux comtes lyonnais du Forez, leur généa-
logie ne pouvait pas non plus remonter au delà d'une charte donnée aux
environs de 9906•Comme l'avaient écrit les moines d'Hautecombe, les
2 Liste et édition de ces actes dans L. RIPART,
us fondements idtologiques du pouvoir
des comtes de
Ja
maison de Savoie (de
Ja
fin du ~ au dtbut du XIII siècle),
thèse d'histoire
dactyl., Université de Nice-Sophia-Antipolis, 1999, r, II, p.496-695.
3 Camdair« de l'abbaye de
Saint-André-le-Bas
de Vienne {ordre de saint Benoit} suivi
d'un appendice de chartes intdites sur le diocès« de Vienne (I~-XII sitcks),
U. Chevalier
éd.,
Vienne-Lyon, 1869
(Co/kction des careulaire: dauphinois,
I), n° 37*, p.248-249. Sur
les origines des Dauphins du Viennois,
cf
G. de MANTEYER,«Les origines du Dauphiné
de Viennois. La première race des comtes d'Albon (843-1228)
»,
Bulletin de
la
Sodtt/
d'ttudes des Haum-A/pes,
44
[=
5' série, 4], 1925, p.50-140 et C. MAURD,
«À
l'origine
d'une principauté médiévale: le Dauphiné,
Xc-XII'
siècle. Le temps des châteaux et des
selgneurs», dans
Dauphint, France. De
la
prindpautl indlptndanu ~
Ja
province (XI1-
XVIII sitcles),
V.
Chomel dir., Grenoble, 1999, p.7-33. .
4 Die Urkunden der Burgundischen Rudolfinger,
T.
Schieffer éd. (MGH,
Regum
BurgundÏl~ e stirpe rudolfina diplomata
et
acta),
1977, n091, p.242-244. Sur les origines
des comtes de Genève,
cf
P. DUPARC,
Le
comt/ de Gentve (I~-XY siècle),
Genève, 1978
2
(Mtmoim et documents publi/s par
la
Socittt d'histoire et d'arch/ologie de Gentve,
39),
p.51-87.
5 Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny,
A
Bernard et A. Bruel éd., Paris, 6 vol., 1876-
1903
(Documents in/dits sur l'histoire de France),
II, n° 1715, p.735-738.
6 Cartulaire de l'abbaye de Savigny suivi du petit cartulaire de
I
'abbayed'Ainay,
A. Bernard
éd., Paris, 2 vol., 1853, I, nO437, p. 237-238. Datée du règne de Conrad
(t
993), la charre
est adressée à l'abbé Hugues (984-1007), ce qui permet de la situer entre 984 et 993.
Sur les origines des comtes du Lyonnais,
cf
E.
FOURNIAL.«Recherches sur les comtes
de Lyon aux IX"et
X"
siècles",
Le
MoyenAge,
58, 1952, p.221-252; H. GERNER,
Lyon im
248

Du
ROYAUME AUX PRINŒPAUTES
dynasties princières de l'espace rhône-alpin semblaient bien, d'un même
mouvement, avoir surgi du néant.
Il serait évidemment vain de chercher une explication commode
dans une quelconque carence documentaire. De part et d'autre de l'an
Mil, le volume et la nature des sources rhône-alpines restèrent en effet
globalement stables: les chartriers et cartulaires de Cluny, de Savigny
et de Saint-André-le-Bas, qui constituent l'essentiel de notre documen-
tatien, nous permettent ainsi de disposer, pour les quatre diocèses de
Vienne, Lyon, Grenoble et Genève, d'une moyenne de 9,79 actes par
an pour la période 929-993, pour 8,31 actes par an pour les années
994-1038. Loin de constituer un
dark age,
la deuxième moitié du X·
siècle est donc légèrement mieux éclairée que la première moitié du XI·
siècle, ce qui implique que notre incapacité à remonter au-delà de l'an
Mil les généalogies des dynasties princières ne peut guère relever que
d'une césure structurelle',
C'est à l'interprétation de ce
«
surgissement des princes
»,
qui
constitue un bouleversement majeur des institutions d'encadrement
politique locales, que cette contribution sera consacrée. Sans prétendre
en élaborer une étude détaillée, elle s'attachera néanmoins
à
proposer
quelques éléments d'interprétation du processus de genèse des princi-
pautés, en prenant plus particulièrement les exemples de la Savoie et du
Dauphiné.
À
l'exemple des moines d'Hautecombe, nous partirons de la
monarchie bourguignonne ou plus exactement de son effondrement sous
le règne de Rodolphe III (993-1032). Dans un second temps, nous nous
attacherons à montrer que le relais du pouvoir monarchique fut pris par
les évêques, qui établirent de véritables dynasties épiscopales. Enfin,
dans une dernière partie, nous verrons que ces principautés épiscopales
donnèrent à leur tour naissance à de nouvelles dynasties comtales, au
terrne d'un processus de séparation de type grégorien.
Frûbmittelalter. Studien zur Geschichte der Stadt, des Erzbistums und der Grasehaft im 9.
und IO.Jahrhundtrt,
Cologne, 1968, p.lOt et 105-105 et P.
GANIVET,
Pouvoirs tt sociùl
dans lespays lyonnais dt l'ëpoqta carolingienne aux lendemains dt l'an mil,
thèse dactyl,
Université Clermont-Ferrand I, 2000.
7 Cf.
G.
TABACCO,«
Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentall»,
Bollettino
storico-bibliografico subalpino,
60, 1962, p.327-354.
249

LE ROYAUME DE BOURGOGNE AUTOUR DE LAN
MIL
L'ESPACE RHÔNE-ALPIN AUTOUR DE L'AN MIL: UN CENTRE MONARCHIQUE
DOMANIAL ÀL'HEURE DE
«
LA MORT DU FISCs»
La
centralité de la monarchie bourguignonne
dans
l'
espace rhône-alpin
Une première constatation s'impose: durant le haut Moyen Âge,
l'espace rhône-alpin - pour désigner par un terme commode les terres
d'entre Rhône et Alpes dans lesquelles allaient s'organiser les principautés
savoyardes et dauphinoises - constituait un centre domanial dominé par
la monarchie bourguignonne', Occupant déjà une position centrale dans
le royaume burgonde, puis dans le
regnum Burgunditf
qui lui avait suc-
cédé, ces terres avaient pour l'essentiel relevé du
ducatus Viennensis,
qui
avait constitué le cœur du royaume des souverains bosonides. Lorsque le
roi Conrad (937-993) était entré en possession de l'héritage des Bosonldes,
sans doute vers 94210,ces vieilles terres de tradition régalienne s'étaient
trouvées intégrées dans le royaume rodolphien. Au côté de l'ancien
duca-
8
cf
c. LAURANSON-RoSAZ.
I:Auv~rgn~ et ses marg~s (Vtlay,
Gévaudan)
du
VIII'
au
XI' siècle,
La fin du
mande
antique?
Cahiers
de
la
Haute-Laire,
Le Puy-en-Velay, 1987,
p.312-328
9 Sur le royaume de Bourgogne.
if.
G. SERGI,«Istituzioni politiche e società nel regno
di Borgogna», dans
Il
secolo
difo"o: mito ~t
realta
deI
secolo
X.
Spolète. 1991
tSentmane
di
studio del centra italiano
di studi su/l'alto
medioeuo,
38 [1990]). p. 205-240;
ID.•
I
confini
dtl
potere,
marche e
signorie
fra due regni
medieuali,
Turin. 1995; G. CASTELNUOVO,
«Les élites des royaumes de Bourgogne (milieu IX'-milieu X' siècle) ». dans
La royautt
et les
tlites
dans
l'Europe carolingienne
(du début du IX' aux environs de 920). R. Le Jan
dir.• Lille. 1998
(Centre d'Histoire de J'Europe du Nord-Oum,
17), p. 383-408 et
ID.,
«La
Burgondie carolingienne et rodolphienne. Prémices et développement d'un royaume».
dans Du
Burgondes
au
royaum~
de
Bourgogn~
(Y-Xl' siècle).
Espace
politiqu« et
civilisation,
P. Paravy dir., Grenoble, 2002. p. 183-210.
10 Alors qu'en fonction d'un passage obscur de Liutprand de Crémone, l'historiographie
avait considéré que l'ancien royaume bosonide avait été cédé par Hugues d'Arles à
Rodolphe II vers 933
(cf
par exemple R. POUPARDIN,
Le
Royaume de
Provenu
tous
les
Carolingiens
(855-933
t), Paris, 1901 [reprint: Genève-Marseille, 1974]. p. 229-233). cette
datation a été remise en cause par
E.
FOURNIAL,«La souveraineté du Lyonnais au X'
siècle",
Le
Moyen
Age.
62, 1956, p. 413-452. qui a démontré que les formules de datation
du cartulaire de Savigny indiquaient que l'autorité rodolphienne n'avait pas été reconnue
en Lyonnais avant 942, puis par C. BRÜHL,
Naissance d~deux peuples. Français et
Allemands
(IX!-XI' siècle),
Paris, 1994 [trad. abrégée de l'éd. allemande, Köln, 1990], p.206-207,
qui a proposé une nouvelle interprétation du passage de Liutprand de Crémone. Plus
récemment. François DEMOTZ.
La Bourgogne transjurane
(855-1056).
L'tvolution des
rapports de pouvoirs dans k mande post-carolingien.
thèse dactyl, Université Lyon III,
2002. p. 220-224. a adopté une position de conciliation. en proposant l'hypothèse d'une
«acquisition par étapes», selon laquelle les Rodolphiens se seraient une première fois
emparés du royaume bosonide en 933, avant d'en être chassés et d'y revenir en 942.
250
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%