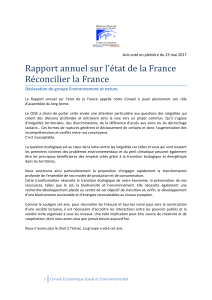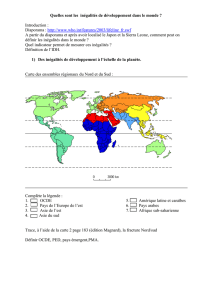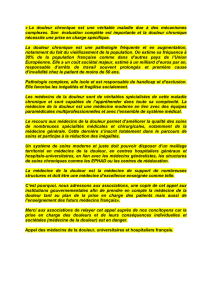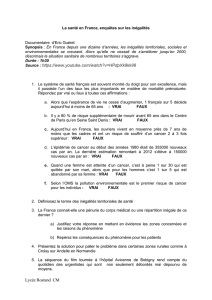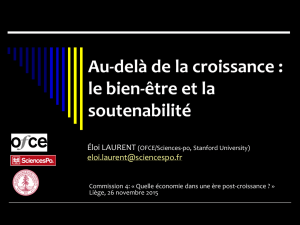Bac blanc n° 1 – ÉLÉMENTS DE CORRECTION – ÉPREUVE

Bac blanc n° 1 – ÉLÉMENTS DE CORRECTION – ÉPREUVE COMPOSÉE
Partie 1 : Mobilisation de connaissances
1) Quelles sont les conséquences de l'instauration d'une taxation écologique ?
Déf° : taxe visant à limiter la pollution ou les atteintes à l'environnement d'une activité économique particulière. Par
exemple, sur les émissions de CO2 (taxe carbone) , sur les déchets polluants (écoparticipation en France)…
Csq ces
: taxe → renchérissement des coûts de P° (pour les Prs) ou du prix (pour les Crs) → Prs et Crs doivent donc intégrer
dans leur calcul le coût environnemental de la P° [NB : Comme les Prs répercutent la hausse des coûts sur le prix de vente, c'est tjs
en dernière analyse le Cr qui est amené à payer le coût de l'atteinte à l'environnement] ↔ internalisation du coûts des externalités
négatives par les Crs et/ou les Prs → modification des comportements vers des produits moins polluants, moins
consommateurs d'énergie, fabriqués avec des matériaux plus écologiques → Baisse des atteintes à l'environnement.
Exple : écoparticipation (qui vient augmenter le prix de l'électroménager, des appareils informatiques et électroniques →
hausse du prix des appareils → renouvellement moins rapide de ces appareils → moins de gaspillages, moins
d'utilisation de matières premières et d'énergie pour produire.
De plus, principe du double dividende : non seulement l'écotaxe permet de réduire les atteintes à l'environnement, mais
en plus elle permet de dégager de nouvelles recettes pour l’État qui pourra alors investir dans la R&D (recherche de
technologies propres), mener des politiques de mise en œuvre du développement durable (programme d'aide à l'isolation
des habitations par ex), ou redistribuer en faveur des ménages les plus modestes (solidarité nationale).
2) Qu'est-ce qu'un choc d'offre ?
Déf° : perturbation brutale des conditions de la production. Il peut être positif s'il y a augmentation de la production (ou
baisse des prix), et négatif s'il y a au contraire diminution de la production (ou hausse des prix). Souvent le résultat d'une
variation brutale de la productivité ou du prix des matières premières.
Exple : l'ouragan Katrina a constitué en 2005 un choc d'offre aux EU puisque les infrastructures pétrolières ont été mises
hors service par les intempéries, ce qui a entraîné une baisse brutale de la production de pétrole brut. De plus, de
nombreux sites de production ont été détruits → baisse de la P°, ralentissement de la croissance.
Exple : choc pétrolier de 1974 suite au conflit entre Israël et les pays voisins → hausse brutale du prix du baril de brent,
qui a renchéri tous les coûts de production, et donc les prix et accéléré le ralentissement économique dans les pays
développés, mettant ainsi fin à la période des Trente Glorieuses.
Exple : fordisme après la Seconde Guerre mondiale (nouvelle méthode d'organisation du travail basée sur le convoyage
et la standardisation des pièces) → hausse très rapide des gains de productivité → augmentation des volumes produits
(choc positif)
Partie 2 : Étude d'un document
Présentation : le document à étudier est un graphique (courbe + diagramme en bâtons), publié par l'INSEE, qui présente
l'évolution du PIB français en % et les contributions à cette variation, en points de pourcentage, de la C°, l'I, le solde du
commerce extérieur et la variation de stock, sur la période 2006-2010.
Lecture : ainsi, nous pouvoir voir qu'en 2010, le PIB a augmenté de 1,5 %. Cette croissance s'explique principalement
par la consommation (qui contribue à hauteur de 1,1 points à la croissance) et par les variations de stock (qui expliquent
0,5 points de croissance). Le solde du commerce extérieur n'a quasiment pas joué (à l'origine de seulement 0,1 point de
croissance). L'investissement quant à lui à eu un impact légèrement négatif (à hauteur de -0,2 points de croissance).
Analyse : Le graphique présenté permet de comprendre l'évolution du PIB grâce à l'impact des différents emplois (C, I,
X-M et VS).
En 2006 et 2007, la croissance assez forte (2,5 % et 2,3 % d'augmentation du PIB) est tirée par la consommation (qui
explique 1,6 points de croissance en 2006 et 1,7 points en 2007) et par l'investissement (qui contribue à la croissance à
hauteur de 0,7 points en 2006 et de 1,2 points en 2007).
La récession de 2008-2009 s'explique par le fait que consommation et investissement jouent beaucoup moins leur rôle
moteur. Ainsi, en 2009, le PIB a diminué de 2,7 % sur l'année. Cette baisse s'explique par une diminution de
l'investissement très marquée (-1,9 points), la variation des stocks négative (-1,3 points) et l'impact du solde commercial
(-0,15 points). La consommation a seule eu un impact positif et a tiré la croissance à hauteur de 0,7 points, ce qui est
beaucoup plus faible que les années précédentes.
En 2010, on observe une reprise de l'activité : le PIB a augmenté de 1,5 %. C'est encore la consommation qui tire la

croissance (+1,1 points). L'impact de l'investissement est beaucoup moins négatif que l'année précédente (-0,1 points).
En fin de compte, grâce à ce graphique, on comprend que l'investissement et la consommation sont les moteurs de la
croissance économique en France.
Partie 3 : Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire
Analyse du sujet :
Pas de difficulté sur les termes de la question, attention toutefois à bien définir la notion d'inégalité. Le sujet
demande de décrire des mécanismes qui conduisent au renforcement des inégalités les unes les autres. Le piège à
éviter est celui de la liste la plus exhaustive possible des inégalités connues : il s'agit donc de sélectionner les plus
pertinentes, les plus utiles pour la démonstration, ou les mieux maîtrisées.
Le plan le plus simple consistait à reprendre la structuration suggérée par le sujet : I- des inégalités multiformes / II-
des inégalités cumulatives.
Analyse des doc :
Doc 1 Corrélation entre taille du logement (surpeuplement) et réussite
scolaire (augmentation de 9 % du risque de redoublement quand on
partage sa chambre d'après l'étude de Goux et Maurin)
ms le lien est complexe et n'explique pas l'essentiel des inégalités
constatées. → rôle de l'investissement des parents dans la réussite
scolaire (effort de consacrer une pièce au travail de leur enfant)
dont le fait de disposer d'une chambre est un indicateur (parmi
d'autres).
Niveau socio-culturel des parents est aussi un
facteur explicatif évoqué dans le doc : faire le
lien avec la notion de capital culturel de
Bourdieu.
Doc 2 « plafond de verre » pour les femmes qui les empêche d'accéder à
des postes à responsabilité de la même manière que les hommes :
17 % des entreprises seulement sont dirigées par les femmes.
Effet de la taille de l'entreprise : plus l'entreprise est grande, moins
il y de femmes. 18,9 % de femmes dirigeantes dans les entreprises
de moins de 10 salariés, contre 8,6 % parmi les cadres dirigeants
des entreprises de + de 250 salariés.
Effet du secteur : plus de femmes dans les services, le commerce,
ou les cosmétiques (l'Oréal – 19 % de femmes parmi les cadres
dirigeants) que dans l'industrie (EADS, Vallourec – aucune femme)
À diplôme égal, les femmes sont plus souvent
PI (et non cadres) que les hommes
→ double ségrégation horizontale et verticale
des femmes au travail.
Doc 3 Difficulté des conditions de vie = mesure le pauvreté et des
inégalités économiques ou résultant directement des inégalités
économiques
17 % des ménages n'épargnent pas en France en 2006 → inégalités
de patrimoine
Pauvreté → restrictions de consommation = inégalités d'accès aux
biens (manger de la viande, vêtements neufs), inégalités de
logement (chauffage, bruit, humidité), inégalités face aux loisirs
(départs en vacances) ou face à la sociabilité (recevoir des amis).
10 % de la population possède près de 60 %
du patrimoine total
Impact sur la santé (alimentation, logement),
impact sur la réussite scolaire des enfants →
Cf doc 1 : reproduction des inégalités
Plan détaillé
I – Les inégalités sociales sont multiformes
A. Des inégalités économiques : revenu, patrimoine (document 3 + connaissances)
B. Des inégalités socioculturelles : logement, genre, culture, … (document 2 + connaissances)
II – Les inégalités sont cumulatives et conduisent à une certaine polarisation
A. Les inégalités se renforcent mutuellement : exemple de la santé (facteurs économiques et culturels) →
opposition entre milieux favorisés économiquement et culturellement, et milieux défavorisés
(connaissances personnelles)
B. Les inégalités se reproduisent dans le temps : exemple de l'école (facteurs économiques et culturels qui
participent à la reproduction de la position sociale des parents et donc au maintien des inégalités)
(documents 1 et 3 + connaissances personnelles, notamment Bourdieu)

Bac blanc n° 1 – ÉLÉMENTS DE CORRECTION – DISSERTATION
La recherche d'un développement durable implique-t-elle l'arrêt de la croissance ?
Analyse du sujet
Le terme « recherche d'un développement durable » renvoie à la modification des modes de consommation et de
production pour mieux respecter l'équilibre entre riches et pauvres et surtout entre activités économiques et préservation
de l'environnement.
La croissance économique est source d'atteintes multiples à l'environnement et au capital naturel : épuisement des
ressources, pollution, réchauffement climatique pour ne citer que les plus médiatisées. Ces méfaits de la croissance sont
connus depuis longtemps, et dès 1972, le rapport Meadows titrait Halte à la croissance ! pour souligner combien notre
mode de développement basé sur la consommation et la production de masse n'était pas soutenable à long terme.
Si l'on cherche à promouvoir un développement durable, il apparaît donc nécessaire de modifier le fonctionnement de
notre système économique. La question est de savoir jusqu'à quel point doit aller cette modification : faut-il renoncer à la
croissance (en tout cas à la croissance généralisée et non réfléchie) pour préserver le capital naturel et la capacité des
générations futures à satisfaire leurs besoins, comme le postulent les tenants de la soutenabilité forte ? Peut-on au
contraire espérer concilier croissance et développement durable, grâce au progrès technique et à l'accumulation de capital
physique et technologique, comme le pensent les partisans de la soutenabilité faible ?
Analyse des documents
Document 1 : document très riche, qui gagnait à être exploité en détail.
•Constat 1 : plus un pays est riche, plus il émet de CO2 et plus il participe au réchauffement climatique.
Comparaison niveau d'émission EU / moyenne mondiale (ou EU / Inde) : 19,5 t/hab aux EU en 2007 (avant la
crise), contre moins de 5 t/hab en moyenne dans le monde (1,5 t/hab en Inde) : les EU émettent donc 4 fois plus
de CO2 par habitant que la moyenne (13 fois plus que l'Inde).
•Constat 2 : lorsqu'un pays s'enrichit, il augmente ses émissions de CO2 → Cas chinois : boom économique des
années 2000 s'est accompagné d'une très forte augmentation des émissions de CO2 : de 2 t/ hab en 2000 à près de
6 t/hab en 2008 : × 3 en seulement 8 ans ! Même tendance constatée en Inde et dans le monde (processus de
développement en cours) → on comprend le risque pour la planète du développement économique des pays
pauvres et de la généralisation du mode de vie occidental (réchauffement climatique fortement accéléré)
•Constat 3 : les pays les plus pollueurs polluent de moins en moins avec le temps → Courbe de Kuznets
environnementale : à mesure qu'un pays s'enrichit, ses atteintes à l'environnement diminuent < développement
de technologies de plus en plus propres, plus grande sensibilité de la population à la question de la pollution et
de la dégradation de l'environnement, volonté politique plus forte, et délocalisation des activités industrielles très
polluantes vers les pays en développement (cimenterie par exemple). EU : passage de 21 t/hab en 1971 à 17
t/hab en 2008 (-19 % d'émissions), All : de 14 t/hab à 10/hab, soit -28 %. → Donc il est possible de concilier
croissance et développement durable.
Document 2 : les innovations vont sauver la planète, ou du moins permettre de dépasser les limites écologiques
actuelles de la croissance → c'est la croissance verte.
•Dans les transports : innovations permettent de réduire les impacts environnementaux des déplacements
voitures hybrides et électriques → moins de consommation de carburants, donc épuisement plus lent des
ressources en hydrocarbures et pollution plus faible
pots catalytiques → diminution des particules dans l'air
•Habitat : maisons mieux conçues (apports solaires pour le chauffage, ventilation naturelle pour limiter le recours
aux climatiseurs), mieux isolées (pour moins chauffer), nouvelles sources d'énergie : eau chaude solaire,
géothermie, pompe à chaleur, etc. → réduire les besoins en énergie et améliorer le confort, donc moins
consommer mais vivre mieux.
•Éco-conception : limiter la quantité de déchets (recyclage prévu dès la fabrication, donc rentable, nouveaux
matériaux biodégradables)
•Nouvelles énergies pour remplacer les dérivés du pétrole et du gaz, ainsi que de l'uranium, dont les stocks
s'épuisent. Innovations rendent ces énergies de plus en plus performantes et accessibles en termes de coût au
grand public.
Document 3 : croissance ne rime pas forcément avec dégradation de l'environnement
•Entre 1960 et1980 en France, l'empreinte écologique (càd la surface qu'il est nécessaire pour produire et
absorber les déchets d'une population) augmente parallèlement au PIB/hab : la France s'enrichit et la pression
que les Français exercent sur leur environnement augmente aussi. Le PIB/hab passe de 7 500 $ à 15 000 $ (× 2)

et l'empreinte écologique passe de 3,5 ha/hab à 5,5 ha/hab.
•À partir des années 1980, le PIB/hab continue de croître (22 000 $ en 2005, × 1,5 par rapport à 1980) , mais
l'empreinte écologique se stabilise autour de 5 ha/personne.
•Il semble donc possible de concilier croissance et préservation de l'environnement, grâce à des modes de
production plus respectueux de l'environnement, des biens moins gourmands en énergie et en matières
premières, une plus grande sensibilité de la population et des politiques publiques volontaristes. [NB : rien
n'assure cependant que la croissance française soit durable : pour le savoir, il faudrait connaître la biocapacité du
territoire → en l'occurrence, elle est de 3ha/personne, la France est en dépassement écologique, sa croissance n'est
pas durable...]
Plan détaillé
I – Les atteintes de la croissance économique à l'environnement ne permettent pas d'atteindre un
développement durable selon les tenants de la soutenabilité forte → il est nécessaire de s'orienter
vers une décroissance pour préserver les capacités des générations futures à satisfaire leurs besoins
A. La croissance porte gravement atteinte au stock de capital naturel et menace le développement
futur car elle épuise les ressources naturelles
•croissance = plus de P° = plus de matières premières et d'énergie consommée → épuisement des
ressources non-renouvelables, telles que les énergies fossiles (pétrole, gaz), les minerai (or, argent,
uranium...)
•croissance → épuisement des ressources renouvelables, du fait de leur sur-exploitation (tragédie des
biens communs : exemple des réserves halieutiques)
B. La croissance menace le développement futur car la pollution et les émissions de gaz à effet de
serre qu'elle engendre provoque un réchauffement climatique
•croissance → pollution du fait de la production de déchets et du fait de rejet de particules et de gaz dans
l'atmosphère.
•Document 1 : EU, Chine : plus un pays est riche et/ou connaît une forte croissance, plus il émet de CO2.
•Réchauffement avéré qui va avoir des conséquences importantes dans les années à venir : modification
du climat, accentuation de la désertification, montée des eaux du fait de la fonte des glaciers de
l’Antarctique.
C. Il peut donc sembler nécessaire de réorienter nos modes de production et de consommation pour
limiter notre impact environnemental.
•Consommer moins pour limiter l'utilisation de ressources naturelles, sans forcément vivre moins bien
(concept de la « sobriété heureuse » des partisans de la décroissance)
•Relocaliser les productions pour limiter les transports, gros émetteurs de CO2.
II – Cependant, pour les partisans de la soutenabilité faible, le progrès technique et les innovations
permettent de concilier croissance et développement durable, à condition que les pouvoirs publics
mettent en place des politiques volontaristes en la matière.
A. Les innovations permettent de développer de nouvelles technologies plus propres et plus
économies en énergie, donc plus durables
•Les atteintes au capital naturel peuvent être compensées par du capital physique et du capital
technologique. Ex de la voiture électrique qui permet de dépasser le problème de l'épuisement du
pétrole (document 2).
•Les innovations permettent de produire plus proprement et de limiter l'impact environnemental des
activités économiques : plus un pays est riche, plus ses atteintes à l'environnement sont faibles (courbe
de Kuznets environnementale constatée dans le document 1 et dans le document 3) : la croissance
permet de financer la R&D et le processus d'innovation, qui génère des procédés ou des biens plus
écologiques et plus durable. Document 2 : habitat, éco-conception, ...
B. Les pouvoirs publics peuvent accélérer la « transition écologique » et l'émergence d'une
« croissance verte » par la mise en place de politiques climatiques
•La transition écologique peut être accélérée par des politiques adaptées : taxations environnementales
(bonus malus écologique pour les voitures, éco-participation,...), campagnes de sensibilisation au niveau
national et mondial, marché des quotas pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc.
•Ce passage à une économie verte est source de créations d'emplois et de croissance, tout en respectant
les objectifs du développement durable (notamment satisfaction des besoins du présent, càd
amélioration du sort des plus pauvres, et préservation de l'environnement).
1
/
4
100%