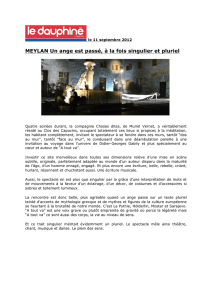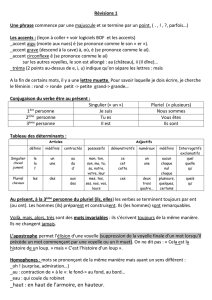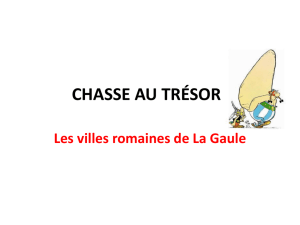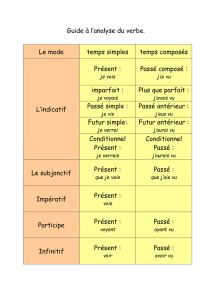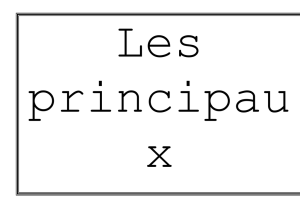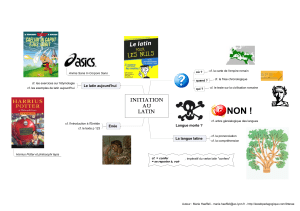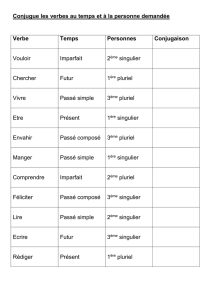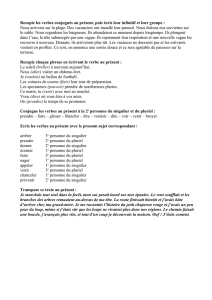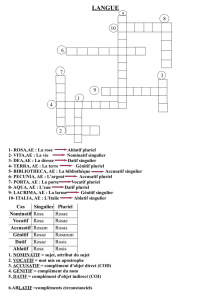1 RUOZZI PAOLA Sujet n°3 : “L`ANALOGIE”

1
RUOZZI PAOLA
Sujet n°3 : “L’ANALOGIE”
L-11 LLS (Ling) = Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere, curriculum Linguistico-didattico
3 LT- Corso: “Introduzione al cambiamento linguistico” (Linguistica d’area) – 36h – 6 CFU
LE ROLE COMPENSATOIRE DE L’ANALOGIE DANS L’HISTOIRE DU FRANÇAIS: INFLUENCE SUR LA
DÉCLINAISON ET SUR LA CONJUGAISON.
Les réfections analogiques ont concerné aussi bien la déclinaison que la conjugaison. Dans le domaine de la
déclinaison du nom, l’analogie n’a touché sporadiquement qu’au cas sujet, de sorte que, avec la disparition
de ce dernier, ses conséquences n’ont pas passé au français moderne ; un peu différent est le cas de la
déclinaison de l’adjectif, et en particulier de celle des adjectifs latins épicènes
1
(du tipe grandis, -e, ainsi
que les participes présents), refaits sur le modèle des adjectifs latins en –us, -a, (-um), et donc finalement
différenciés en genre (grantz, au début masc. et fém. passe à grantz vs. grande, c'est-à-dire masculin vs.
féminin, le neutre s’étant perdu en chemin). Mais c’est dans le domaine de la conjugaison verbale que
l’analogie a produit ses effets les plus remarquables ; son action, en particulier, a servi à uniformiser les
paradigmes des verbes latins qui, une fois passés au français sous l’effet des lois phonétiques, avaient
donné des conjugaisons rhizotoniques, c'est-à-dire des conjugaisons où l’on observait une alternance
radicale entre les personnes dont la voyelle radicale latine était accentuée (ex. ámo > j’aime) et celles dont
la voyelle radicale, grâce à un déplacement à droite de l’accent, dû à l’allongement du mot, était atone (ex.
amámus > nous amons > nous aimons) ; un développement phonétique différent ayant marqué les voyelles
latines atones et les voyelles toniques, les paradigmes romans qui en étaient issus avaient fini par afficher
une conjugaison « sur deux bases ». Les modifications analogiques, visant à rétablir le même radical tout au
long de la conjugaison (par extension du radical le plus fréquent aux six personnes), se sont donc
conservées, non sans quelques incohérences (ex. je meus vs. je veux), jusqu’en français moderne.
(1) L’ANALOGIE DANS LA DÉCLINAISON DES NOMS ET DES ADJECTIFS.
Pour comprendre les résultats que la flexion latine du nom a donné en AF il faut tenir compte et des
terminaisons latines originaires (présence ou non d’un –s de flexion), et des remaniements que ces
terminaisons ont connus en bas latin et en latin médiéval (par ex., le nominatif pluriel des masculins de la
3e décl. est refait de –es en –i, ex. canes > cani, ce qui explique l’absence de –s au CSP pour ce type de
noms, mais le maintien du –s au CRP :
cas sujet (nominatif) pluriel : canes > cani > li chien
cas régime (accusatif) pluriel : canes > les chiens ;
le CSP des féminins en –a de la 1re déclinaison, par contre, a connu le processus inverse : puisque le
nominatif pluriel latin a été refait de –ae en –as, cela explique qu’en AF ces noms aient un CSP avec –s de
flexion qui le rend de fait identique au CRP :
cas sujet (nominatif) pluriel : rosae > rosas > les roses
cas régime (accusatif) pluriel : rosas > les roses.
1
Il s’agit d’adjectifs qui présentent une seule forme pour le masculin et le féminin (ex. grandis, fortis, viridis) et une
forme distincte pour le neutre (ex. grande, forte, viride). Ils appartiennent à la 3e déclinaison latine. Les participes
présents latins, en –ans/–ens (ex. amans, videns, dormiens, réduits à une forme unique –ans > -antis aux Ve-VIe ss.),
qui présentent, au nominatif singulier au moins, une forme unique pour les trois genres, se rattachent également au
adjectifs épicènes. En effet, ils ne différencient le masc./fém. du neutre qu’au pluriel (ex. amantes vs. amantia).

2
Voici de suite une exemplification des aboutissements en AF des noms appartenant aux trois déclinaisons
latines survécues à la ruine casuelle : d’abord le masculin, et ensuite le féminin. Les articles définis qui
apparaissent dans les tableaux sont issus, par aphérèse, des formes latines suivantes :
ille > *illi > li (CSS)
illu(m) > illo(m) > le (CRS)
illi > li (CSP)
illos > les (CRP)
illa > la (CSS)
illa(m) > la (CRS)
illae > illas > les (CSP)
illas > les (CRP)
(1A) L’ANALOGIE DANS LA DÉCLINAISON DU NOM.
LA DÉCLINAISON DU NOM MASCULIN.
Il existe en AF trois types principaux de déclinaison du masculin.
LE PREMIER TYPE (flexion sur une seule base) contient les mots de la 2e déclinaison latine, y compris les
noms de la 4e refaits sur le modèle de la 2e, certains substantifs, tel castellum, passés du neutre au masculin
> castellus ; d’autres, comme caput > *capus, ont en même temps connu un changement de déclinaison et
perdu leur nature imparisyllabique (caput, -itis).
TYPE LATIN2 : murus, muru(m) (« mur »)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li murs (< murus)
li mur (< muri)
CAS REGIME
le mur (< muru(m))
les murs (<muros)
TYPE LATIN : caballus, caballu(m)(« cheval »)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li chevals > chevaus >
chevax3
li cheval
CAS REGIME
le cheval
les chevals > chevaus > chevax
Notes de phonétique et de graphie : les noms dont le thème se termine par voyelle (ex. rois, roi) ou par [n] non
mouillé ni appuyé (ex. chemins, chemin ; chiens, chien) ne se modifient pas au contact de l’-s de flexion ; par contre, si
le thème se termine par certaines consonnes, ces dernières peuvent subir des changements au contact de l’ –s de
flexion ; en particulier :
[p], [b], [m], [k], [g] et [f]
4
chutent devant –s :
drap + s = dras (“drap”); champ + s = chans (“champ”); cop + s = cos (“coup”)
gab + s = gas (“plaisanterie”)
verm + s = vers (“ver”)
duc + s = dus ; clerc + s = clers
2
Les formes indiquées comme « type latin » sont réduites aux cas nominatif et accusatif, c'est-à-dire les seuls cas qui
aient survécu en AF.
3
Le “x” devient bientôt une notation graphique commune pour le groupe “us ». Même sort, par exemple, pour
l’adjectif salvus, -a, -um qui, au CSS et au CRP du masculin donne soit sals, soit saus, soit sax, ou bien pour l’adjectif
bellus, -a, -um qui donne, aux mêmes cas, biaus, biax. Le CSS et le CRP sont en effet les seuls où il y ait un –s de
flexion.
4
Y compris le cas du son [v] assourdi en [f] en coda, ou devant l’-s de flexion. Le [f] ne chute quand même pas
toujours : voir, plus loin, clefs, de claves.

3
sang + s = sans
cerf + s = cers ; chief + s = chiés (“chef”); ser(v) + s = sers (“serviteur”)
dans la suite [ul], le [l] disparaît : nul + s = nus (« aucun, personne »), mais il se maintient dans [il] fil + s = fils
au contact de l’-s de flexion, le [l] se vélarise en [u], comme le montre la déclinaison de cheval
les dentales [t] et [d], ainsi que [n] appuyé ou mouillé, suivis de –s, fusionnent avec celui-ci en produisant la
mi-occlusive [ts], graphiée [z] ; d’ailleurs, à partir de 1200, le groupe [ts], dont la dentale originaire sera de
moins en moins sensible, sera simplifié en [s], avec tendance à remplacer donc [z] par [s] (on trouvera alors
pechiés pour pechiez, jors pour jorz, escus pour escuz, pons pour ponz) :
pied + s = piez ; congie(d) + s = congiez (“permission”); cri(d) + s = criz (“cri »)
lit + s = liz ; serjant +s = serjanz; pont +s = ponz (“pont”); vent + s = venz (“vent”)
poing + s = poinz (“poignée”); jorn + s = jorz (“jour”)
LE DEUXIÈME TYPE (flexion sur une seule base) regroupe un petit nombre de substantifs latins de la 3e
déclinaison se terminant au nominatif singulier par –er (ex. pater, mater, liber) ou –or (ex. arbor, marmor),
donc sans –s de flexion au CSS. La liste complète est la suivante : père, frere, arbre, chandelabre, gendre,
livre, maistre, ventre, marbre.
TYPE LATIN : pater, patre(m) (« père »)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li pere (s) (< pater)
li pere (< patri < patres)
CAS REGIME
le pere (< patre(m))
les peres (< patres)
Toutefois, par analogie des substantifs du 1er type, largement majoritaires, un –s a pu être ajouté au CSS,
comme dans le vers suivant, tiré de la Queste del Saint Graal, roman du XIIIe siècle :
Or vos dirai donc, fet li freres, que vos feroiz (Queste, 36, 13, cit. Joly G. (2004) : 10) (« Maintenant je vous
dirai, fit le frère, ce que je vous ferais », PR)
LE TROISIÈME TYPE (flexion sur deux bases), finalement, regroupe tous les noms de la 3e déclinaison latine
qui affichent un thème différent au CSS par rapport aux autres cas. Cette différence relève à la fois d’une
différence d’accentuation et d’une disparité du nombre des syllabes entre le nominatif et les autres cas. Il
s’agit donc de substantifs imparisyllabiques, pour la plupart à accent mobile (ex. báro, barónis) mais aussi à
accent fixe (ex. hómo, hóminis ; cómes, cómitis) dont le référent humain avait empêché la réfection du
nominatif (le modèle selon lequel le latin classique civitas, civitatis est refait en civitatis, civitatis n’est pas
suivi à cause de la fréquence des noms de personne dans les apostrophes).
TYPE LATIN : báro, barónem (d’abord
« simple, naïf » en latin, ensuite « baron »)
(imparisyllabique à accent mobile, 3e décl. lat)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li ber
li baron
CAS REGIME
le baron
les barons

4
TYPE LATIN : cómes, cómitis (d’abord
« copain, compagnon » en latin, ensuite
« comte »)
(imparisyllabique à accent fixe, 3e décl. lat.)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li cuens
li comte
CAS REGIME
le comte
les comtes
TYPE LATIN : hómo, hóminis(« homme »)
(imparisyllabique à accent fixe, 3e décl. lat.)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
li uem (hom)
li ome
CAS REGIME
le ome
les omes
Appartiennent au 3e type les mots d’origine latine en –o, -onem comme
li garz, le garçon (garcio, -onem, “mercenaire, valet, écuyer » ; relatinisation du francique ?)
li fel, le felon (fello-, -onem, “félon, criminel, lâche, traître”)
li compain, le compagnon (lat. pop. companio, -onem, littér. “celui qui mange du pain avec »,
« copain »)
li lerre, le larron (latro, -onem, “voleur”)
ou bien en –or, -orem, comme
li pastre, le pastor (pastor, -orem, “pasteur”)
li sire, le seignor > seigneur (senior, -orem “plus vieux »)
li maire, le majeur (major,-orem, « plus grand »)
5
li emperere, l’empereor (imperator, -orem “celui qui donne les ordres »)
li chantre, le chantor (cantor, -orem “chanteur”)
li ancestre, l’ancessor (antecessor, -orem “celui qui précède”)
li traitre, le traitor (traditor, -orem, « traître »)
ou bien encore des mots d’origine diverse comme
li nies, le nevou > neveu (nepos, -otem, « neveu »)
l’enfes
6
, l’enfant (infans, infantem « bébé, enfant »)
TYPE LATIN : imperátor, -óris
(« commandant », « celui qui donne les
ordres »
(imparisyllabique à accent mobile de la 3e
décl. lat.)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
l’emperere(s)
li empereor
CAS REGIME
l’empereor/l’empereur
les empereors/ les empereurs
Dans ce type aussi, le CSS peut recevoir un –s analogique de flexion, par souci de conformité avec la 1re
déclinaison (majoritaire).
5
Dans le cas de sire/seigneur, maire/majeur, on constate une spécialisation sémantique du CS et du CR en français
moderne, qui a ainsi conservé les deux cas.
6
Il s’agit d’un de très rares substantifs qui, en AF, ne sont pas oxytons.

5
Il existe finalement un QUATRIÈME TYPE de déclinaison, réservée aux mots latins qui, présentant un thème
consonantique en –s, demeurent invariables, tel mois, provenant de mensis, mensem). Le problème des
adaptations analogiques par l’ajout d’un –s de flexion ne se pose donc pas ici.
LA DÉCLINAISON DU NOM FÉMININ.
La déclinaison du nom féminin présente aussi trois types, dont le premier représente, comme dans le cas
du masculin, le modèle de déclinaison majoritaire.
LE PREMIER TYPE (flexion sur une seule base) inclut les mots (pour la plupart féminins) de la 1re déclinaison
latine (ex. rosa, rosa(m)), mais comprend aussi les noms de la 5e refaits sur la 1re, comme facies > facia,
glacies > glacia, rabies > rabia, ainsi que les neutres pluriels de la 2e, du type folia, poma, prata, pris pour
des féminins.
TYPE LATIN : rosa, rosa(m) (“rose”)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
la rose (< rosa)
les roses (<rosas)
CAS REGIME
la rose (< rosa(m))
les roses (<rosas)
TYPE LATIN : foemina, foemina(m) (“femme”)
SINGULIER
PLURIEL
CAS SUJET
la feme
les femes
CAS REGIME
la feme
les femes
Comme on peut le voir, ces substantifs n’affichent plus une déclinaison à proprement parler : une seule
forme caractérise le singulier, une seule forme le pluriel, comme en français moderne ; la seule
différenciation consiste dans l’ –s du pluriel, qui marque le nombre. L’article défini n’aide pas non plus à la
différenciation des cas à l’intérieur du singulier et du pluriel, s’agissant, ici comme là, d’une même et seule
forme.
LE DEUXIÉME TYPE (flexion sur une seule base) regroupe la plupart des mots issus de la 3e déclinaison
latine ; il s’agit et des mots parisyllabiques à accent fixe du type finis, -em (« fin ») ou potionis, -em
(« boisson, breuvage »)et des mots originairement imparisyllabiques à accent mobile (ex. virtus, virtutem ;
civitas, civitatem) dont le nominatif avait été refait sur la base des cas obliques
7
(donc : virtutis, virtutem ;
civitatis, civitatem). Font donc partie de ce groupe les féminins dont le thème se termine par une consonne,
comme fain (« faim »), fin, main, maison, poison, raison, rien (« chose »), amor, flor (« fleur »), paor
(« peur », de pavor, -orem refait en pavoris, pavorem), honor, dolor, char (« chair » de caro, carnem, refait
en carnis, -em), cort, gent, jument, nuit, clef, nef, noif (« neige »), soif, ainsi que les féminins qui, ayant
perdu leur dentale finale post-tonique, se terminent par voyelle accentuée : cité, biauté (« beauté »), leauté
(« loyauté »), santé, verté (« vérité »), volenté (« volonté ») – et tous les noms abstraits de ce type – merci,
vertu, foi…etc.
7
Du coup, on avait donc neutralisé à la fois leur nature imparisyllabique et leur accent mobile.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%