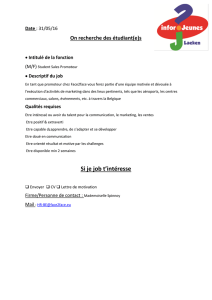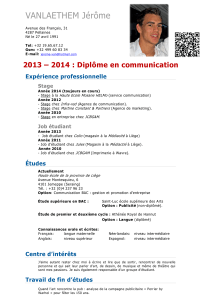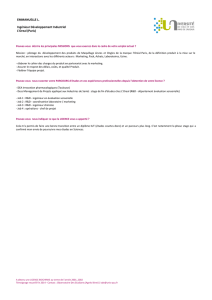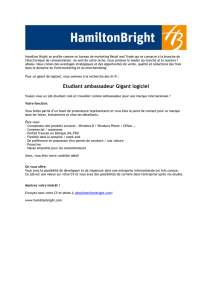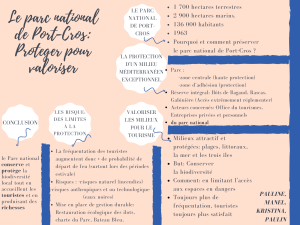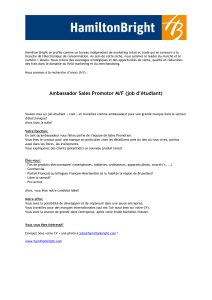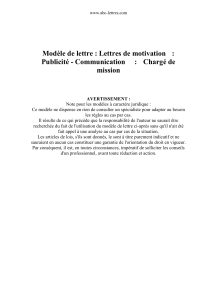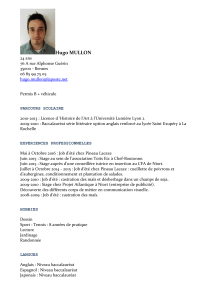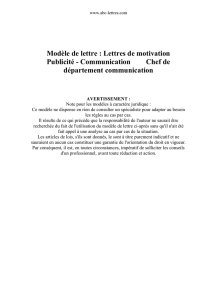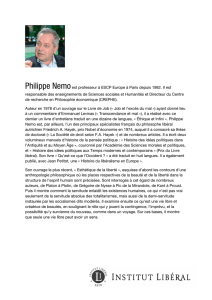Job, modèle de sagesse - Brève contribution à la catéchèse

1
JOB, MODÈLE DE SAGESSE
BRÈVE CONTRIBUTION À LA CATÉCHÈSE (013)
EXTRAIT DU COURS SILOÉ LAUSANNE 2009 – 2012
(13.0) : SÉANCE DU 23 MARS 2010
J.M. Brandt, Dr en théologie

2
SILOÉ LAUSANNE 2009 – 2012
(13.0) : SÉANCE DU 23 MARS 2010
(13.1) JOB, MODÈLE DE SAGESSE
13.1.1 INTRODUCTION, BUT ET ENJEU
- Méthodologie
Le livre de Job est une œuvre en soi, quant au fond, quant à la forme, quant aux personnages : il est,
nous dirons «atypique», dans le corps de l'Ancien Testament. Pour nous «mettre en ambiance», nous
allons l'ouvrir sur les versets ci-après, choisis pour nous introduire dans l'intimité du propos.
Nous commencerons par lire ces versets, avec des commentaires oraux. Puis nous entamerons
l'étude systématique du Livre, par la mise en perspective de cette troisième, dernière et tardive
partie de l'Ancien Testament, que sont les Ecrits auxquels appartient Job. Nous placerons ensuite ces
récits et Job dans une perspective théologique. Nous conclurons sur la «vraie sagesse», qui est la
"crainte de Dieu".
N.B. Les commentaires oraux des versets ci-après seront repris dans notre contribution 14.1
- Versets introductifs
1- Prologue : "Yahvé avait donné, Yahvé a repris : que le nom de Yahvé soit béni !"1
2- Job à ses amis : "Instruisez-moi, alors je me tairai;
montrez-moi en quoi j'ai pu errer."2
3- Job à ses amis : "Même si je suis dans mon droit, je reste sans réponse…"3
4- Job à ses amis : "Au jour du désastre, le méchant est épargné,
au jour de la fureur il est mis à l'abri."4
5- Job à Yahvé : "Je crie vers Toi et tu ne réponds pas ;
Je me présente sans que tu me remarques. "5
6- Job à Yahvé : "Oui je sais que Tu me fais retourner vers la mort,
vers le rendez-vous de tout vivant."6
7- Job à ses amis : "Où donc est-elle mon espérance ?"7
1 Jb 1, 21
2 Jb 6,24
3 Jb 9, 15
4 Jb 21, 30
5 Jb 30, 20
6 Jb 30, 23

3
8- Job à ses amis : "Qu'il me pèse sur une balance exacte :
lui, Dieu, reconnaîtra mon intégrité."8
9- Elihu : "A la vérité, c'est un esprit dans l'homme,
c'est le souffle de Shaddaï qui rend intelligent."9
10- Source inconnue : "Mais la sagesse, d'où provient-elle ?
Où se trouve-t-elle, l'intelligence ?"10
11- Source inconnue, Dieu à l'homme : "La crainte du Seigneur, voilà la sagesse ;
fuir le mal, voilà l'intelligence."11
"Fais silence et je t'enseignerai la sagesse."12
12- Elihu : "Aussi, écoutez-moi en hommes de sens :
Qu'on écarte de Dieu le mal,
De Shaddaï l'injustice !
13-Car il rend à l'homme selon ses œuvres,
traite chacun selon sa conduite,
en vérité Dieu n'agit jamais mal,
Shaddaï ne pervertit pas le droit."13
12- "Mais il sauve le pauvre par sa pauvreté,
il l'avertit dans sa misère."14
13- Yahvé à Job : "…je vais t'interroger et tu m'instruiras.
Où étais-tu quand je fondai la terre ?" 15
14- Genèse : "Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon."16
"Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre
moi excepté, il n'y a pas de Dieu.
7 Jb 17, 15
8 Jb 31, 6
9 Jb 32, 8
10 Jb 28, 12
11 Jb 28, 28
12 Jb 33,33
13 Jb 34, 10-12
14 Jb 36, 15
15 Jb 38, 3-4
16 Gn 1, 31

4
17- Yahvé par Isaïe : "Je façonne la lumière et je crée les ténèbres,
je fais le bonheur et je crée le mal
c'est moi, Yahvé, qui fais tout cela."17
18- Saint Paul : "Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail
d'enfantement."18
19- Job à Yahvé : "[…] Oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas,
[…]
je ne te connaissais que par ouï-dire,
mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Aussi je me rétracte
et m'afflige sur la poussière et sur la cendre."19
20- Yahvé aux trois sages (épilogue) :
"Ma colère s'est enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec
droiture comme l'a fait mon serviteur Job […] mon serviteur Job priera pour vous. Ce n'est que par
égard pour lui que je ne vous infligerai pas ma disgrâce."20
- Introduction
Notre contribution se référera principalement à la TOB21, dont l'introduction au Livre de Job est plus
complète que celle de la Bible de Jérusalem, et à deux ouvrages du Professeur Thomas Römer22.
La question qui se pose, après la mise en place de l'Alliance, est celle du non respect de l'Alliance par
Dieu en personne. L'élan de Foi révolutionnaire des impulsions théologique et nationaliste de Juda
déporté à Babylone, a reporté sur Israël (le royaume du Nord) la culpabilité du non respect de
l'Alliance, et, par contraste ou "distinction", a adossé à l'Egypte idolâtre la naissance, en cours
d'Exode, du Dieu unique et du peuple et de la nation juive. Le peuple et la jeune nation ont rempli
leur contrat. Dès lors comment se fait-il que l'injustice demeure, au niveau du peuple, et au niveau
de l'individu ? Comment un homme juste, ou sage, peut-il être puni ? Que fait Dieu, tout puissant et
unique ?
En termes théologiques, le récit de Job pose le problème du Mal et de la révolte de l'homme face à
l'arbitraire divin. Comme nous l'avons relevé dans nos contributions, la Bible s'adresse à chacun de
nous, pris individuellement et collectivement, avec notre volonté, notre libre arbitre et notre
responsabilité. Cette Parole, ou Révélation, participe de l'Acte de Création encore et toujours en
cours. La condition humaine est en effet finitude, et, nous l'avons observé, les modèles de la Bible
17 Is 45, 5-7
18 Rm 18, 22
19 Jb 42, 3-6
20 Jb 42, 7
21 TOB, Paris, Les Editions du Cerf, 2004
22 RÖMER Thomas & alii, Introduction à l'ancien Testament, Genève, Editions Labor % Fides, 2004 et RÖMER
Thomas, Les Chemins de la sagesse, Proverbes, Job, Qohéleth, Nyon, Editions du Moulin, 2009. Thomas Römer
est professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne et au Collège de
France

5
sont profondément humains. Job n'échappe pas à ce principe, moins encore que les personnages que
nous avons abordés jusqu'à ce jour23. En termes pragmatiques, le récit de Job,"c'est plutôt une
tentative de l'homme en désarroi pour se situer par rapport au Dieu saint et tout puissant."24 Cette
tentative, avec Job, fait recours aux armes de la sagesse que l'Antiquité, en Egypte et au Moyen-
Orient, avait déployées sur une large échelle populaire et depuis un lointain passé, tout en la
transformant en une vertu particulière : la crainte de Dieu.
- But et enjeu
Le but n'est pas de résoudre le problème du Mal, au sens de la souffrance injuste, ou de l'expliquer,
mais de recadrer les termes du rapport de l'homme à Dieu, dans la limite de la condition de finitude.
Il est aussi d'intégrer, dans les conditions de l'Alliance, l'expérience profane acquise par l'homme de
tous les jours dans son rapport à l'univers et à sa destinée. Il est enfin de nous positionner par
rapport aux notions de sagesse et de justice, et de définir celle de la crainte de Dieu.
L'enjeu est de nous ouvrir ici et maintenant, et en ce qui nous concerne, à un modèle de sagesse qui
nous permette d'admettre le Mal et l'injustice dans les conditions de l'Alliance testamentaire, en
nous remettant sans cesse en question, au-delà du confort des habitudes, des règles, des dogmes,
des absolus, dans notre rapport à autrui, à la société, à notre finitude, à Dieu.
13.1.2 MISE EN PERSPECTIVE GÉNÉRALE
- Introduction
Le récit de Job est l'un des cinq "Livres de sagesse" (Livres sapientiaux), qui regroupent par aileurs
Proverbes, Ecclésiaste (Qohélet), Ecclésiastique, Sagesse (Sagesse de Salomon). On inclut dans ce
groupe, sans qu'ils soient à proprement parler sapientiaux, les Psaumes et Cantique des Cantiques.
Après la Loi (Torah ou Pentateuque), et les Prophètes (Nebiim), les "Livres de sagesse" forment, avec
Ruth, Lamentations, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et 1,2 Chroniques, la troisième et dernière
partie de la Bible hébraïque, sous l'appellation hébraïque Ketouvim (les "Ecrits")25, ou chrétienne
Hagiographes.
Les Ecrits présentent une structure peu stricte et des genres littéraires hétéroclites26, au contraire
des deux premiers Livres de l'Ancien Testament. Ils apportent par contre une ouverture sur la culture
de l'époque, en particulier la culture juive, car " ils forment un véritable condensé de la littérature
juive de l'époque hellénistique."27 Achevés au IVème siècle Av. J.-Chr, ils entrent dans le canon
hébraïque tardivement (IIème siècle Apr. J.-Chr), avec le double objectif d'aider à "redéfinir l'identité
du judaïsme après la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 70, mais aussi face au
christianisme qui se revendiquait comme le «vrai Israël»"28.
23 Voir nos contributions précédentes sur Ève, Caïn, Abraham, Jacob, Moïse, d'après Gn et Ex..
24 TOB, op. cit. p. 1483
25 Cf. notre contribution 001, annexe 001
26 Pour une structure détaillée, voir notre contribution 001 "Référencement biblique", et plus particulièrement
l'annexe 01
27 Römer, op. cit. 2004, p. 479
28 Idem
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%