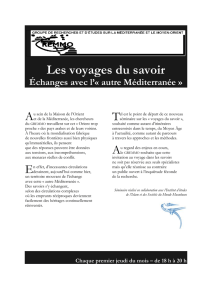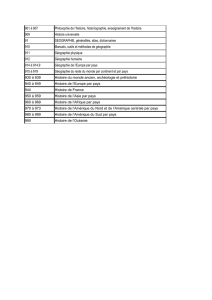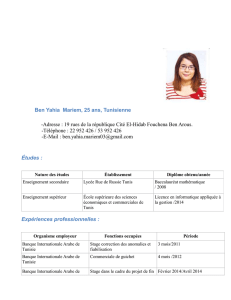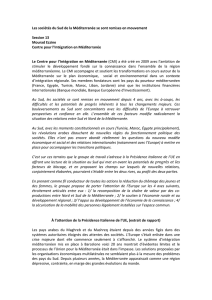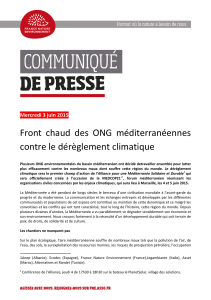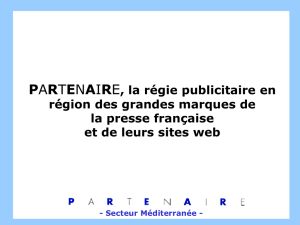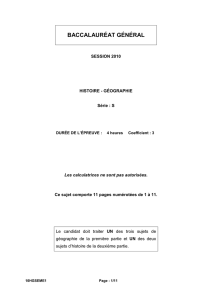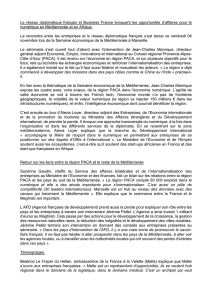Annales de géographie Quand le printemps arabe

Annales de géographie
http://www.necplus.eu/AGO
Additional services for Annales de géographie:
Email alerts: Click here
Subscriptions: Click here
Commercial reprints: Click here
Terms of use : Click here
Quand le printemps arabe redessine la Méditerranée
Pierre Beckouche
Annales de géographie / Volume 2011 / Issue 681 / September 2011, pp 554 - 571
DOI: 10.3917/ag.681.0554, Published online: 12 December 2012
Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0003401011681051
How to cite this article:
Pierre Beckouche (2011). Quand le printemps arabe redessine la Méditerranée. Annales de géographie, 2011, pp 554-571
doi:10.3917/ag.681.0554
Request Permissions : Click here
Downloaded from http://www.necplus.eu/AGO, IP address: 88.99.165.207 on 25 May 2017

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
Quand le printemps arabe redessine
la Méditerranée
Pierre Beckouche
Professeur à Paris 1, directeur du GIS « CIST », conseiller scientifique d’IPEMED
Le Printemps arabe plonge la Méditerranée dans l’inconnu mais apporte au
moins une certitude : Samuel Huntington se sera révélé un piètre cartographe.
Sa frontière irrémédiable entre ce qui serait deux « civilisations » vouées à se
combattre de part et d’autre de la Méditerranée, est désormais un stéréotype
du passé (section 1). Pour autant, rien ne dit que le processus de Barcelone
réussira à faire de la Méditerranée un espace de paix et de prospérité, car depuis la
décolonisation et jusqu’au Printemps arabe, il n’y aura jamais eu de stratégie active
de l’Europe en Méditerranée (section 2). L’objet de l’article est de montrer que
la discipline géographique a sa part de responsabilité dans la rémanence tenace de
cette simplification huntingtonienne distinguant entre un continent chrétien et un
continent islamique. Peut-être les géographes ne se sont-ils pas suffisamment saisis
des apports des autres disciplines sur les changements à bas bruit des sociétés de la
rive sud (montée de l’individuation), sur l’adaptation de lois de type européen (sur
les partenariats public-privé, sur l’ouverture des marchés même si c’était souvent
insuffisant ou formel), sur le maintien des mobilités transméditerranéennes de
toutes sortes en dépit du durcissement du régime des visas et de l’ambiance
sécuritaire qui a prévalu après le 11 septembre 2001. Peut-être n’avons-nous
pas repéré à sa juste mesure l’apparition des régions Nord-Sud comme nouveau
type de territoire, en en restant à une approche monographique de la notion de
région, saisissant mal qu’elle devenait un échelon essentiel de l’organisation de
l’espace contemporain et des nouvelles relations Nord-Sud (section 3). Dans le
cas méditerranéen, les jeunes démocraties arabes pourront en tirer l’idée qu’il vaut
mieux se tourner vers les grands émergents ou vers le Golfe que vers une Europe
distante. À cet égard, les relations qui se tisseront entre l’Union européenne et
la Tunisie de 2011 donneront un avant-goût de la future carte méditerranéenne
(section 4).
1 Le « choc des civilisations » n’aura pas lieu
Dans une récente recherche sur l’« Europe dans le monde » pour le compte du
programme Espon
1
de l’Union européenne, un consortium scientifique animé
par l’UMS Riate (Grasland, 2007) a proposé une synthèse des découpages
géographiques régionaux adoptés par les acteurs de dimension internationale :
entreprises multinationales, institutions multilatérales ou grandes ONG. Entre
1
Financé par l’Union européenne et par les États membres, l’European Spatial Planning Observation
Network a pour objectif d’éclairer par des recherches les enjeux de la cohésion territoriale en Europe.
Ann. Géo., n°681, 2011, pages 554-571, Armand Colin
“Annales_681” (Col. : Revue de géographie) — 2011/9/28 — 20:19 — page 554 — #92
i
i
i
i
i
i
i
i

Au fil de l’actualité Quand le printemps arabe redessine la Méditerranée •555
le vaste monde et les nations désormais dépassées par l’internationalisation
des échanges, il nous faut bien nous habituer à découper le monde à une
échelle intermédiaire, celle des grandes régions, dont l’Europe constitue une
des occurrences. Mais voilà : les entreprises ne découpent pas l’Europe de la
même manière, pour ne rien dire de l’Asie ; les ONG non plus, les institutions
internationales encore moins alors qu’on aurait pu attendre d’elles une géographie
un peu consensuelle. Au sein d’un même rapport de l’OMC ou de la Banque
mondiale la définition régionale varie souvent : le Mexique fait tantôt partie de
l’Amérique du Nord, tantôt de l’Amérique centrale, tantôt de l’Amérique latine ;
l’« Europe orientale » comprend la Russie ou l’exclut, les statistiques agglomèrent
Europe centrale et Europe orientale ou les distinguent, etc. Quant à la Turquie,
la variété de son classement en « Europe » ou en « Asie » laisse penser que la
question de son adhésion à l’Union européenne sera encore longtemps l’occasion,
pour les hommes politiques, de solliciter les géographes pour qu’ils les aident à
trancher...
Désarroi de ceux qui croient à la pertinence de l’échelon des grandes régions
dans l’organisation de l’espace contemporain... Sur quelles certitudes compter
pour les dessiner ? Heureusement, car il y a tout de même de bonnes nouvelles,
dans ce tour d’horizon des découpages régionaux fluctuants, certains se sont
révélés suffisamment récurrents pour tenir lieu de repères. Le plus récurrent de
tous était le découpage qui sépare l’Europe du Sud de l’Afrique du Nord et du
Proche-Orient. De toutes les démarcations permettant d’esquisser les régions
du monde d’aujourd’hui, la plus partagée semble être celle qui passe par la
Méditerranée : d’un côté l’Europe, de l’autre le monde arabe. Cette conclusion
s’est trouvée renforcée par l’exercice de cartes mentales auquel le consortium
s’est livré, en demandant à chacun des membres du comité Espon de dessiner
son découpage régional : là encore le résultat fut composite mais la coupure
méditerranéenne fit consensus. Enfin un découpage consistant !
Or le Printemps arabe est en train de faire voler cette démarcation en
éclats. Un stéréotype tombe, celui qui voyait dans le « monde arabe » une
catégorie radicalement distincte de l’Europe, à la fois historiquement (les siècles
de conflits avec l’empire ottoman), culturellement (Islam d’un côté et Chrétienté
de l’autre), sociologiquement (des sociétés fondées sur la loyauté et les relations
interpersonnelles et non pas sur la légalité et la notion de fonctions
2
), et
politiquement (régimes autoritaires et non pas démocratiques). Le suivi en
temps réel des révolutions au Sud fait prendre conscience que les sociétés, même
au Sud, se définissent au moins autant par leur projet que par leur histoire ; que la
menace islamiste n’est pas le fond de l’affaire et que de toute façon les pratiques
2
Sur cette distinction entre « loyauté » et « légalité », et sur la dimension sociologique et institutionnelle
du développement, voir les travaux lumineux de Jacques Ould Aoudia (notamment Meisel et Ould
Aoudia, 2008).
“Annales_681” (Col. : Revue de géographie) — 2011/9/28 — 20:19 — page 555 — #93
i
i
i
i
i
i
i
i

556 •Pierre Beckouche ANNALES DE GÉOGRAPHIE,N°681 •2011
religieuses au Sud se sont, comme en Europe, fortement individualisées
3
; qu’une
majorité en Tunisie et sans doute dans bien d’autres pays arabes se prononce en
faveur de l’État de droit, et que la démocratie devient un vœu commun.
Les transformations lentes qui, à bas bruit, infléchissaient les représentations
que les Européens se faisaient des « Arabes », avaient, depuis une vingtaine
d’années, préparé le terrain. Cette percolation avait emprunté plusieurs canaux :
la fréquentation touristique croissante des pays musulmans par les Européens,
les courants d’affaires transméditerranéens qui accompagnaient le processus de
Barcelone lancé en 1995, le métissage socioculturel né de l’immigration des Turcs
ou des Maghrébins en Europe, la progression sociale des Européens issus de
cette immigration, les modes de vie à cheval sur les deux rives (retraites partielles
ou totales d’Européens au Maroc...). Le retentissement du discours du président
Obama au Caire en juin 2009 fut une étape importante de cet ébranlement des
stéréotypes
4
. Et lorsqu’en décembre 2010 elle a explosé en direct à la télévision
et sur Internet, la révolution arabe a terminé le travail. Nous ne savons pas encore
quelle sera la nouvelle représentation du monde arabe qui s’imposera (en espérant
qu’il n’y en aura pas qu’une seule), mais on peut être sûr que la précédente, celle
d’une étrangeté radicale par rapport aux Occidentaux, à vécu.
Si l’on quitte le registre des représentations pour s’intéresser aux aspects plus
structurels des transformations en cours sur la rive sud de la Méditerranée, c’est
en terme de « transition » qu’il faut analyser les choses, comme ce qui s’était
passé dans l’Europe des colonels (Portugal, Espagne et Grèce) des années 1970
puis dans l’Europe centrale des années 1990
5
. Transition politique : pluralisme
partisan, élections libres et sincères, État de droit, respect des droits de l’homme.
Transition économique : fin de la corruption généralisée, remise en cause du
rôle central des secteurs de rente, transparence des marchés, obtention de prêts
bancaires sur la base de la qualité économique du projet et non plus sur la
base des garanties financières personnelles jusqu’à présent indispensables à tout
emprunteur. Transition sociale : chances nouvelles d’une redistribution plus juste
de la richesse créée par une gouvernance améliorée.
Évidemment cette transition au Sud n’en est qu’à ses débuts. Ce n’est pas
un hasard si elle a commencé en Tunisie, qui, si on met à part Qatar et les
Émirats arabes pour quelques aspects très particuliers, était de loin le pays arabe le
plus moderne économiquement (qualification de la main-d’œuvre, vrais services
publics en dépit du dévoiement du sommet de l’État), et culturellement (classe
3
Sur la montée en puissance de l’individu dans le monde arabe, voir Stora et Plenel (2011). Sur
l’individuation rapide des pratiques religieuses, on pourra se reporter à la première enquête nationale
sur les valeurs menée par des chercheurs marocains (Rachik, 2005).
4
«Islam has always been a part of America’s story [...]. I consider it part of my responsibility as President
of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear », discours du
président Obama au Caire, 4 juin 2009.
5
Sur l’approche des révolutions en cours dans le monde arabe à travers la notion de « transition », voir la
récente livraison de la revue Maghreb Machrek « Le monde arabe dans la crise » (Moisseron et Haddar,
2011).
“Annales_681” (Col. : Revue de géographie) — 2011/9/28 — 20:19 — page 556 — #94
i
i
i
i
i
i
i
i

Au fil de l’actualité Quand le printemps arabe redessine la Méditerranée •557
moyenne, statut des femmes, cohésion nationale) – mais pas politiquement, d’où
la révolution.
Pour le reste, la convergence entre les deux rives de la Méditerranée demeure
un objectif de longue haleine. La révolution arabe met les projecteurs sur les
enjeux politiques, ce qui est normal, et d’ailleurs les quelque cent (!) partis
politiques qui se sont créés en 2011 en Tunisie parlent quasi exclusivement
de politique et guère d’économie. Pourtant il faudra bien mettre sur pied un
programme de modernisation économique. Jusqu’à présent, les pays du Sud et
de l’Est de la Méditerranée (Psem) ont réussi leur stabilisation macroéconomique,
notamment sous l’impulsion des « accords d’association » signés avec l’Union
européenne dans le cadre de Barcelone ; mais ils n’ont pas trouvé la réponse
au triple défi ouvert dans les années 1990 : la chute du monde de Berlin et
la focalisation des intérêts européens sur l’Est ; le démantèlement des accords
multifibres (qui leur étaient très favorables) ; l’entrée de la Chine dans l’OMC.
Même si c’est de manière variable d’un pays à l’autre, les Psem ne seront ni
parvenus à moderniser leur système productif en profondeur ; ni parvenus à
substituer des activités à haute valeur ajoutée au textile ou aux produits primaires
dans leurs exportations ; ni parvenus à un accord stratégique entre eux ou à
l’échelle régionale euroméditerranéenne pour faire face à la montée en puissance
des très grandes séries à bas coût venues de Chine et des autres grands émergents.
Tous les Psem n’ont pas adhéré à l’OMC (Syrie, Liban, Algérie, Libye), tous ne
sont pas également impliqués dans les accords de Barcelone ni dans l’Union pour
la Méditerranée ; l’Union du Maghreb Arabe reste largement virtuelle (rappelons
que la frontière algéro-marocaine est fermée depuis 1994), le Greater Arab
Free Trade Area
6
commence tout juste à donner quelques résultats prometteurs
(Beckouche, 2011a).
Le conflit israélo-palestinien aura à la fois été une épine dans le pied du
développement du Proche-Orient, et une excuse offerte aux gouvernements
arabes pour tenir à distance la coopération avec l’Europe et donc la modernisation
politique de leur pays. Enfin comme la sécurité a occupé le sommet de l’agenda
politique occidental depuis le 11 septembre 2001, ces gouvernements arabes
autoritaires ont facilement trouvé le moyen de répondre à l’obsession européenne
de sécurité.
2 Les limites de l’action méditerranéenne de l’Europe
Côté Nord, et jusqu’à la révolution arabe, l’Europe n’avait pas pris la mesure
de l’enjeu sud méditerranéen. C’est paradoxal car le Cercle des économistes
(Chevalier, 2003 ; Védrine, 2007) comme les travaux de l’Ifri (Colombani, 2002)
avaient estimé que la réussite d’un partenariat fort avec les Psem était le seul
6 ou Gafta, aire de libre-échange entre les pays arabes.
“Annales_681” (Col. : Revue de géographie) — 2011/9/28 — 20:19 — page 557 — #95
i
i
i
i
i
i
i
i
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%