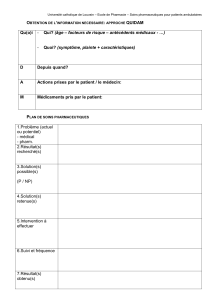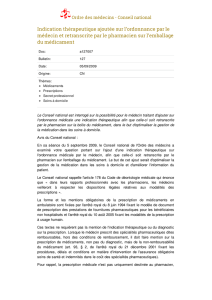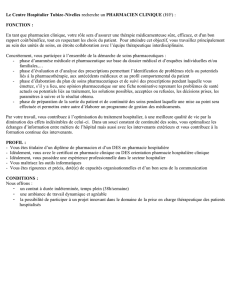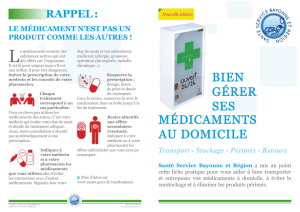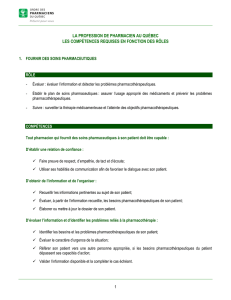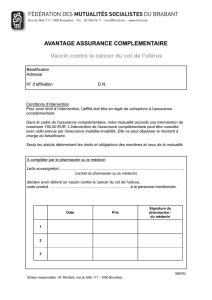Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm
Pour citer cet article : Ziane A, Ngami C, Youb R, Atri MH, Aikpa R, Kabirian F, Fauvelle F. Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques
chez le sujet âgé de plus de 75 ans. J Pharm Clin 2013 ; 32(4) : 243-9 doi:10.1684/jpc.2013.0261 243
Article original
J Pharm Clin 2013 ; 32 (4) : 243-9
Évaluation de la qualité des interventions
pharmaceutiques chez le sujet âgé
de plus de 75 ans
Evaluating the quality of pharmacists’ interventions in older
patient than 75 years
Abderrezzaq Ziane 1, Corinne Ngami 2, Rafik Youb 1, Mohamed Hazem Atri 1, Raoul Aikpa 1,
Fariba Kabirian 1, Francis Fauvelle 2
1Service de gériatrie, Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil, France
2Service de pharmacie, Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil, Montfermeil, France
Résumé. Le but de cette étude est d’analyser la pertinence et l’impact clinique des interventions pharmaceutiques
chez le sujet âgé de plus de 75 ans. L’enquête a été menée du 01/11/2011 au 31/01/2012, période durant laquelle
552 patients ont été hospitalisés dans les 21 lits du service de court séjour gériatrique et les 112 lits de soins de suite
et réadaptation. La pertinence et l’impact clinique ont été jugés par un groupe expert composé de 2 pharmaciens
et 2 gériatres. Trois cent deux opinions pharmaceutiques ont été analysées chez 199 patients. Soixante-quinze
pour cent des opinions ont été considérées pertinentes. L’impact clinique a été jugé nul pour 44 % des opinions,
significatif pour 49,3 %, très significatif pour 5,9 %. Une opinion sur 302 est considérée comme ayant un impact vital.
Parmi les opinions d’impact significatif, 65,8 % concernent l’insuffisance rénale. Le binôme médecin-pharmacien
permet d’améliorer la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé et de lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse,
surtout quand le pharmacien est intégré à l’unité de soins.
Mots clés : opinion pharmaceutique, impact clinique, pertinence
Abstract. The aim of study was to evaluate the relevance and the clinical impact of pharmacists’ interventions
in elderly patient. A clinical practice audit was performed between 01/11/2011 and 31/01/2012, period during
which 522 patients were hospitalized in 133 beds of geriatric. Clinical impact of pharmacists’ interventions were
assessed by two physicians and two pharmacists. Three hundred two interventions on 199 patients were analyzed.
Seventy five per cent interventions were considered relevant. Forty four per cent of them were considered to
have no clinical impact, 49.3% were significant, and 5.9% very significant. One intervention on 302 have vital
impact. Concerning significant interventions 65.8% concerned renal insufficiency. Team physician-pharmacist could
improve prescription optimisation and reduce iatrogenic diseases, when pharmacist become integrated in medical
team.
Key words: pharmacist intervention, clinical impact, relevance
Les patients âgés hospitalisés dans les services de
gériatrie sont le plus souvent atteints de polypatho-
logies chroniques. Cette population polymédiquée
la rend plus sensible aux effets indésirables potentiels
des médicaments [1-3]. Les accidents iatrogènes sont plus
Tirés à part : A. Ziane
graves dans cette population car ils s’accompagnent de
décompensation en cascade des pathologies, avec une
prise en charge souvent retardée du fait d’un diagnostic
difficile. Ces difficultés diagnostiques s’expliquent par
des manifestations le plus souvent aspécifiques (troubles
digestifs, confusion, chute). Ils mettent en cause des
médicaments essentiels, tels que les anti-thrombotiques,
les antihypertenseurs et les hypoglycémiants oraux [1-6].
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm
244 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013
A. Ziane, et al.
L’analyse des évènements, la plupart évitables, montre
que les erreurs surviennent surtout au stade de la
prescription et de la surveillance [7]. Environ 10 % des hos-
pitalisations en gériatrie aiguë sont directement liées à des
problèmes d’iatrogénie médicamenteuse [8]. Les classes
médicamenteuses principalement impliquées sont les
anticoagulants, les antihypertenseurs et les médicaments
du système nerveux central [9]. Plusieurs publications
mentionnent également que les erreurs sont observées
lors de l’admission et lors de la sortie des patients
de l’hôpital [10, 11], et les retombées positives d’une
démarche de bilan comparatif des médicaments sur la
réduction des divergences médicamenteuses sont recon-
nues par plusieurs auteurs [12].
Les prescriptions médicamenteuses des unités de
gériatrie aiguë (UGA) et de soins de suite réadaptation
(SSR), ont été informatisées, dans notre établissement,
respectivement en septembre 2009 et juillet 2011.
L’informatisation des prescriptions a permis aux pharma-
ciens d’analyser toutes les ordonnances et de renforcer
la collaboration avec les gériatres et les infirmières afin
de lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse. Dans le
cadre de cette analyse d’ordonnance, le pharmacien ayant
acquis une expérience en pharmacie clinique était amené
à rédiger une opinion pharmaceutique (OP) à destina-
tion des prescripteurs. Le contenu des interventions était
issu du groupe de travail «Standardisation et valorisa-
tion des activités de pharmacie clinique »de la Société
franc¸aise de pharmacie clinique de 2003 ; elles étaient
codifiées en problèmes liés à la thérapeutique et résolu-
tion de problèmes qu’ils avaient générés. Les interventions
du pharmacien pouvaient être acceptées ou rejetées par
les gériatres. Par ailleurs, le pharmacien participait régu-
lièrement aux transmissions matinales quotidiennes de
l’UGA où étaient prises les décisions thérapeutiques en
concertation avec l’équipe médicale et le personnel infir-
mier. L’objectif n’était pas de produire des OP mais de
valoriser les échanges entre professionnels relatifs à la
prise en charge médicamenteuse du sujet âgé de plus de
75 ans. Afin d’évaluer la pertinence et l’impact clinique
des interventions pharmaceutiques, et de déterminer les
classes les plus à risque, nous avons mené une étude sur
une période de trois mois chez les patients hospitalisés à
l’UGA et dans les 4 unités de SSR.
Méthodes
Cette étude prospective a été menée dans les 5 uni-
tés (1 UGA, 4 SSR) de 133 lits, dotées du logiciel de
prescription informatisée USV2/Crossway®(Mac Kesson,
Cestas, France), entre le 1er novembre 2011 et le 31 jan-
vier 2012. Le pharmacien référent de la gériatrie analysait
quotidiennement toutes les prescriptions tout au long
du séjour du patient sur le logiciel Pharma®(Computer
Engineering, Paris, France) transférées depuis le logiciel
USV2/Crossway®. Il était présent dans l’unité de soins une
heure par jour au moment des transmissions. Il validait les
nouvelles prescriptions correspondant soit à une prescrip-
tion d’entrée soit à une modification de l’ordonnance pour
un même patient. Au cours de l’analyse d’ordonnance de
niveau 2 [13], il était amené à rédiger des OP transmises
aux prescripteurs par voie informatique. Le pharmacien
avait accès au bilan biologique du patient. Chaque OP
portait sur la ligne du médicament concerné qui avait
occasionné l’intervention du pharmacien. Cette OP conte-
nait la nature du problème identifié et la proposition
du pharmacien pour y remédier. L’intervention du phar-
macien pouvait aboutir à la délivrance du médicament
d’emblée, ou à la délivrance après modification de la pres-
cription, ou à un refus de délivrance. Les interventions
relevant des substitutions des médicaments hors livret ont
été prises en compte dans l’étude. Les OP étaient enre-
gistrées et archivées dans les deux logiciels ; elles ont
été recueillies de fac¸on prospective sur une période de
3 mois, et ont été regroupées en 5 catégories selon une
classification issue de celle de Comer [14] (tableau 1).
L’impact clinique potentiel ou avéré de chaque OP a été
évalué rétrospectivement au moyen d’une échelle prove-
nant de la cotation de Hatoum [15] (tableau 2), par un
groupe expert, composé de deux gériatres et de deux
pharmaciens avec une expertise gériatrique, n’exerc¸ant
pas dans les services concernés. Ce groupe expert n’était
pas informé de la conduite du prescripteur en regard de
l’intervention, mais il avait connaissance de la survenue
d’un accident thérapeutique médicamenteux, suite à la
non-prise en compte de l’OP (impact clinique avéré).
Les variables quantitatives ont été décrites par leur
effectif et le pourcentage, et les variables quantitatives par
leur moyenne et écart type.
Le pharmacien référent a recueilli de fac¸on prospec-
tive les OP des patients sur une fiche, y compris les
week-ends et jours fériés. Les OP proposées aux méde-
cins ont été analysées par le groupe expert lors d’une
réunion présentielle ; les experts avaient accès au dossier
médical et à l’ensemble des prescriptions du séjour du
patient, ainsi qu’aux bilans biologiques correspondants.
Le groupe a ainsi déterminé après consensus, le carac-
tère pertinent ou non de l’OP et la cotation de l’impact
clinique. L’objectif était d’analyser au moins 300 OP.
Résultats
L’étude a permis, sur un trimestre, d’analyser 302 OP
auprès de 199 patients (76,9 % de femmes) dont l’âge et
le poids moyen étaient respectivement de 86,2 ±5,5 [75-
102] ans et 59,8 ±9,2 [33-98] kg. Les patients présentaient
un taux moyen de créatinine de 106,1 ±72,7 [25-666]
moles/L et une clairance de créatinine (Clcr) moyenne
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm
J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 245
Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le sujet âgé
Tableau 1. Classification des interventions de pharmacie clinique issue de celle
de Comer [14].
Choix thérapeutique
Ajout d’un médicament
Arrêt d’un médicament du
traitement sans substitution
Pour contre-indication
Pour redondance thérapeutique
Pour durée de traitement
Pour un médicament potentiellement
inapproprié chez le sujet âgé
Substitution/Échange Médicament référencé au livret thérapeutique
Alternative mieux adaptée au patient
Modalités d’administration
Choix de la voie
d’administration
Relais voie IV/voie orale
Forme à libération immédiate ou à libération
prolongée
Optimisation des modalités
d’administration
Optimisation du plan de prise
Répartition des prises par rapport aux repas
ou aux interactions médicamenteuses
Administration à jeun, à distance des repas,
en position debout
Modalités de reconstitution, de dilution, durée
de perfusion
Posologie
Adaptation posologique En fonction de la clairance de créatinine, du
poids, de l’âge
Modification de la posologie en fonction de
l’AMM, ou de l’état clinique du patient
Allongement d’une durée de traitement jugée
trop courte
Suivi du patient
Suivi thérapeutique Monitorage des concentrations sanguines des
médicaments à marge thérapeutique étroite
Surveillance biologique
Surveillance clinique
Réévaluation
Réévaluation du traitement Durée des traitements anti-infectieux
Association de plusieurs médicaments d’une
même classe thérapeutique (exemple :
antihypertenseurs)
de 44,4 ±25,9 [7-141] mL/min estimée selon la formule de
Cockroft et Gault. Trente pour cent des patients avaient
une Clcr inférieure à 50 mL/min, 28,4 % une Clcr inférieure
à 30 mL/min et 2,5 % une Clcr inférieure à 10 mL/min. Au
moment de l’analyse, 15 patients n’avaient pas de poids
et 2 patients n’avaient pas de créatininémie au cours du
séjour. Les durées moyennes de séjour sont respective-
ment à l’UGA et aux SSR, de 7,3 et 33,7 jours. Le nombre
moyen de lignes par ordonnance était de 11,4 ±4,2 ; 116
Tableau 2. Échelle de cotation de l’impact clinique des opinions pharmaceu-
tiques provenant de la cotation de Hatoum [15].
Echelle de cotation
Score Signification
0Impact clinique nul pour le patient : l’intervention
présente soit un objectif uniquement financier ou informatif,
soit a été proposée après l’évènement ; elle est sans
conséquence pour le patient
Exemple : Substitution d’une présentation d’érythropoïétine
hors livret par une érythropoïétine référencée au livret
1Impact significatif : l’intervention augmente l’efficacité du
traitement et/ou la sécurité du patient et/ou la qualité de vie
du patient
Exemple : Arrêt hydroxyzine à propriétés anticholinergiques,
prescrit le soir au coucher, avec proposition de substitution
par une benzodiazépine à demi-vie courte
2Impact très significatif : l’intervention empêche un
dysfonctionnement organique, elle évite une surveillance
médicale intensive ou une séquelle irréversible
Exemple : Arrêt prescription colchicine chez un patient
insuffisant rénal sévère
3Impact vital : l’intervention évite un accident
potentiellement fatal
Exemple : Surdosage furosémide et irbésartan chez patient
insuffisant rénal avec kaliémie à 6,3 mmol/L
patients avaient au plus 10 lignes de prescription par
ordonnance et 42 patients avaient entre 15 et 23 lignes de
prescription par ordonnance. Le nombre moyen de pres-
cripteurs (10 au total) par ordonnance était de 2,6 ±0,9
[1-5], et le nombre moyen d’interventions pharmaceu-
tiques était de 1,8 [1-4].
Parmi les 302 OP, 75 % (n = 228) ont été jugés perti-
nentes par le groupe expert. Sur le plan clinique, 133 OP
(44,0 %) avaient un impact nul, 149 (49,3 %) un impact
significatif et 18 (5,9 %) un impact très significatif. Une
OP (0,3 %) a été considérée comme ayant un impact vital
par le groupe expert.
Les problèmes identifiés et la nature des avis propo-
sés pour les OP classés comme ayant un impact significatif
sont présentés dans le tableau 3. La nature des problèmes
était en grande partie liée à la fonction rénale : les 98
cas de surdosages, contre-indications et sous-dosages ont
fait l’objet de propositions d’adaptation de posologies et
d’arrêts de traitement. Vingt situations de monitorage à
suivre ont été relevées, pour lesquelles le pharmacien a
proposé un suivi de la kaliémie, de l’International nor-
malized ratio (INR) et du temps de céphaline activé.
Les 8 situations de médicaments non indiqués correspon-
daient à des médicaments potentiellement inappropriés
chez le sujet âgé (hydroxyzine, trimétazidine) ; les rééva-
luations de traitements concernaient les antibiotiques.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm
246 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013
A. Ziane, et al.
Tableau 3. Problèmes identifiés et nature des avis proposés pour les opinions avec impact significatif.
Problèmes identifiés (n = 149) Nature des avis proposés (n = 149)
Liste des problèmes n % Opinions formulées n %
Surdosage 58 38,9 Adaptation posologique 74 49,7
Contre-indication 23 15,4 Arrêt 31 20,8
Monitorage à suivre 20 13,4 Suivi thérapeutique 20 13,4
Sous-dosage 17 11,4 Optimisation modalités d’administration 19 12,8
Médicament non indiqué 8 5,4 Ajout 3 2,0
Réévaluation 8 5,4 Changement voie d’administration 2 1,3
Voie administration inappropriée 7 4,7
Interaction 4 2,7
Mauvaise utilisation logiciel 4 2,7
Sept cas de voies administrations inappropriées ont fait
l’objet d’interventions de fac¸on à optimiser les moda-
lités de prise orale (relais IV/per os, prise à jeun,
rythme d’administration) et de perfusion. Les 4 interac-
tions concernaient une association contre-indiquée ayant
abouti à un arrêt de traitement et à 3 cas d’administrations
différées.
Les OP d’impact très significatif, toutes acceptées par
les gériatres, correspondant à 4 situations cliniques diffé-
rentes sont présentées dans le tableau 4. Douze opinions
concernaient des cas de surdosage dont 8 en paracétamol
chez des patients insuffisants rénaux et normaux-rénaux,
1 surdosage en benzodiazépine, 2 surdosages en vita-
mine D, 1 cas de surdosage en sodium. Une OP portait
sur un cas de sous-dosage en sels de potassium chez un
patient avec hypokaliémie sévère à 2,5 mmol/L, ayant
rec¸u des lavements évacuateurs suite à un fécalome
avec syndrome occlusif. Trois situations cliniques concer-
naient deux contre-indications avec le dabigatran et 1
contre-indication avec la colchicine chez un insuffisant
rénal. Une antibiothérapie inefficace avec un germe résis-
tant a fait l’objet d’une OP, et une complexation du
fer avec la lévothyroxine à l’origine d’une hypothyroï-
die sévère a été relevée pour laquelle le pharmacien
est intervenu auprès du prescripteur. L’OP classée par
le groupe expert comme ayant un impact vital concer-
nait un patient insuffisant rénal hémodialysé avec une
kaliémie à 6,3 mmol/L, chez lequel avait été prescrit une
dose d’irbésartan de 150 mg/j et une dose de furosé-
mide retard 60 mg de 240 mg/j. Les classes thérapeutiques
impliquées dans les OP avec impacts cliniques significa-
tifs et très significatifs sont représentées sur la figure 1.
La classe B (sang et organes hématopoïétiques) a généré
le plus d’interventions suivie des classes N (système ner-
veux) et J (anti-infectieux). Le taux d’acceptation des
OP par les médecins atteint 62 % au court séjour et
31,9 % aux SSR. Les OP étaient rédigées le même jour
que les prescriptions sauf si la prescription était rédigée
après 18h00 ; les correctifs étaient généralement appor-
tés dans la journée ou le lendemain lors de la visite du
gériatre.
Discussion
Les résultats de cette étude relèvent de la pratique en
gériatrie et ne peuvent pas être extrapolés à d’autres spé-
cialités. Cette étude présente certaines limites. On peut
citer un biais sur le nombre de patients inclus compte
tenu que nous n’avons pas effectué de tirage au sort
des patients ; en effet 302 OP ont été analysées, corres-
pondant à 199 patients sur un total de 552 hospitalisés
dans les 5 unités durant la période de l’étude. L’objectif
était d’analyser au moins 300 OP et le pharmacien n’a
pas sélectionné les patients ou ciblé des interventions ;
le recueil des fiches a été effectué selon sa disponibi-
lité. L’autre biais concerne la formation du pharmacien
puisque celui-ci n’était pas qualifié en gériatrie mais uni-
quement en pharmacie clinique.
La classification issue de celle de Comer [14] et
l’échelle provenant de Hatoum [15] reprises dans cette
étude ont permis au pharmacien de classer ses interven-
tions et au groupe expert de déterminer la nature des
impacts. Même si l’échelle d’impact de Hatoum [15] est
utilisée dans d’autres études, la comparaison des résul-
tats déjà publiés dans la littérature est difficile, dans la
mesure où la méthodologie utilisée varie en fonction des
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0261 Date: November 30, 2013 Time: 3:18 pm
J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 247
Évaluation de la qualité des interventions pharmaceutiques chez le sujet âgé
Tableau 4. Les opinions avec impact clinique très significatif et vital.
NoCLcr (mL/min) Type d’erreur Effet
16 96 Inefficacité du traitement Infection pulmonaire à germe résistant à ciprofloxacine
22 33 Doublon Surdosage paracétamolà6g/j
48 65 Doublon Surdosage paracétamolà6g/j
62 22 Erreur posologie : 12 g de chlorure
de sodium par 24 heures
Surdosage sodium avec natrémie à 141 mmol/L
108 58 Doublon Surdosage paracétamolà8g/j
111 28 Contre-indication Arrêt dabigatran
130 47 Sous-dosage sels de potassium Hypokaliémie sévère = 2,5 mmol/L
150 46 Erreur prescription Surdosage paracétamolà6g/j
152 26 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal
154 61 Erreur d’unité Surdosage oxazépam à 5 cp/jau lieu de 5 mg/j
169 15 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal
184 36 Erreur prescription Surdosage vitamineD:1fois/sem
205 49 Doublon Surdosage paracétamol 6 g/j
215 36 Erreur prescription Surdosage vitamineD:1fois/sem
217 175 mol/L
Patient non pesé
Contre-indication Arrêt dabigatran
222 72 Erreur prescription Interaction fer-L thyroxine : espacer prise de 2 heures
244 23 Contre-indication Arrêt colchicine chez insuffisant rénal
269 9 Erreur prescription Surdosage paracétamol à 4 g/j chez insuffisant rénal
59 7 Erreur prescription Surdosage irbésartan 150 mg/j et furosémide 240 mg/j chez insuffisant
rénal avec kaliémie = 6,3 mmol/L
34
16 11 51
40
60
0
10
20
30
40
50
60
70
BN J CAMH
Classe ATC
Figure 1. Les classes thérapeutiques à risque qui ont généré une opinion avec impact clinique significatif et très significatif (N).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%