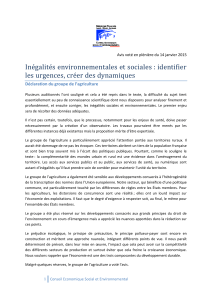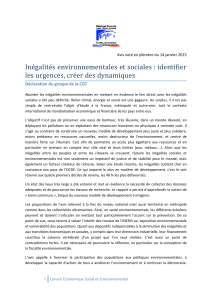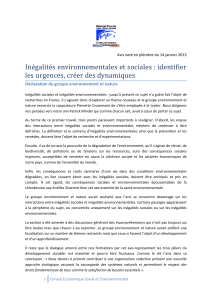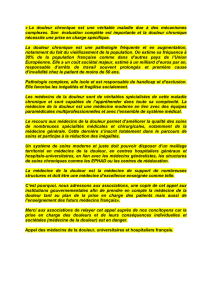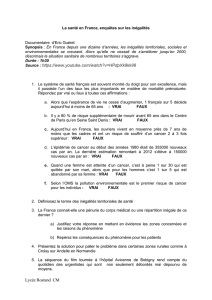Les inégalités environnementales comme inégalités de moyens des

Espace populations sociétés
Space populations societies
2008/1 | 2008
Populations, vulnérabilités et inégalités écologiques
Les inégalités environnementales comme
inégalités de moyens des habitants et des acteurs
territoriaux
Pour que l’environnement soit un facteur réel de cohésion urbaine
The Environmental Inequalities as Means Inequalities for Inhabitants and Local
Governments
Guillaume Faburel
Édition électronique
URL : http://eps.revues.org/2430
ISSN : 2104-3752
Éditeur
Université des Sciences et Technologies de
Lille
Édition imprimée
Date de publication : 1 juin 2008
Pagination : 111-126
ISSN : 0755-7809
Référence électronique
Guillaume Faburel, « Les inégalités environnementales comme inégalités de moyens des habitants et
des acteurs territoriaux », Espace populations sociétés [En ligne], 2008/1 | 2008, mis en ligne le 01 juin
2010, consulté le 29 novembre 2016. URL : http://eps.revues.org/2430 ; DOI : 10.4000/eps.2430
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Espace Populations Sociétés est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

111
ESPACE, POPULATIONS, SOCIETES, 2008-1 pp. 111-126
Guillaume FABUREL Centre de recherche Espace, Transport, Environnement
et Institutions Locales (CRETEIL)
Institut d’Urbanisme de Paris
Université Paris 12
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
faburel@univ-paris12.fr
Les inégalités environnemen-
tales comme inégalités de
moyens des habitants et des
acteurs territoriaux
Pour que l’environnement soit un facteur
réel de cohésion urbaine
Malgré quelques textes officiels, orienta-
tions locales, études diagnostiques, recher-
ches, ou encore séminaires et colloques, la
thématique des inégalités environnementales
n’a pas jusqu’à ce jour en France vraiment
fait l’objet de portage politique [Theys,
2005]. À l’inverse, dans le sillage du mou-
vement pour les droits civiques et de la lutte
contre les discriminations [Boulder, 1988 ;
Bullard, 1990 et 1994], les États-Unis ont
institutionnalisé la thématique de la Justice
environnementale au milieu des années 1990
[Fol et Pflieger, 2005], après quelques études
fondatrices produites depuis le fin des an-
nées 701. De même, la Grande-Bretagne se
démarque par plusieurs travaux empiriques
1. INTRODUCTION : LA NÉCESSITÉ DE COMPRENDRE LE RÔLE DES MÉCA-
NISMES SOCIO-ÉCONOMIQUES DANS LA CONSTRUCTION DES INÉGALITÉS
ENVIRONNEMENTALES EN VILLE
1 Premier cas porté en justice en 1979 au Texas, où une
communauté de l’est de Houston porte plainte contre
l’implantation d’une décharge dans leur commune,
estimant que celle-ci n’avait été placée là que pour des
motivations raciales ; Publication du General Accoun-
ting Office d’une étude intitulée Sitting Hazardous
waste landfills and their correlations with Racial and
Economic Status Surrounding Communities confirmant
l’existence d’injustices environnementales ; réalisation
en 1987 d’une étude par la United Church of Christ in-
titulée Toxic wastes and Races in the United state: A
national report on the racial and socioeconomic cha-
racteristics of communities with hazardous Waste Sites,
confirmant aussi que les caractéristiques ethniques et
financières des territoires jouaient un rôle déterminant
dans la prise de décision.

112
d’analyse sur l’équité et la justice face à cer-
tains objets d’environnement [McLaren et al.,
1999 ; Walker et al. 2003], telle la qualité de
l’air [McLeod, 2000 ; Brainard et al., 2002 ;
Mitchell et Dorling, 2003], ainsi que des rap-
ports officiels, dont celui de l’Agence Anglai-
se de l’Environnement en 2003 sur Pauvreté
et environnement.
Or, s’il subsiste un déficit de portage politique
en France, cette thématique n’est pourtant pas
sans adresser des questions saillantes tant à la
production de connaissances qu’à la construc-
tion de l’action, que ces connaissances et/ou
actions soient urbaines [Traisnel, 2005 ;
Emelianoff, 2005], socio-environnementales
[Faburel et Maleyre, 2007] ou plus largement
territoriales [Laigle, 2005a].
Ce décalage persistant entre portage et enjeux
a plusieurs causes que nous serions bien en
peine de recenser et d’articuler avec préci-
sion. Toutefois, il découle selon nous aussi en
partie de la définition même, la plus conven-
tionnelle, des inégalités environnementales
(i.e. expositions des populations modestes à
des charges environnementales proportion-
nellement plus importantes), voire de l’ac-
ception plus extensive et très générale çà et
là rencontrée en France [Laigle, 2005b]2. De
notre point de vue, appliquées sans discerne-
ment, ces définition et acception détournent
la connaissance de la compréhension fine des
dynamiques à l’œuvre derrière les faits inéga-
litaires dans le champ socio-environnemental.
Ceci nous semble particulièrement vrai lors-
qu’il s’agit d’aborder la ville, sa complexité,
donc la place qu'occupe l'urbain dans les mo-
des contemporains de l’habiter.
Par exemple, comment à partir de la seule
exposition des populations situer le rôle de
l’environnement dans les ségrégations socio-
spatiales et, notamment, les choix résidentiels
sous-jacents, donc éclairer la problématique
des inégalités environnementales en ville ?
Les inégalités environnementales n’y redou-
bleraient-elles dès lors les inégalités sociales ?
Ne seraient-elles pas simplement des inégali-
tés sociales qui, face à l’environnement urbain
et aux attributs du cadre de vie, donneraient à
voir d’autres visages du produit historique des
divisions sociales de et dans l’espace ?
À l’inverse, ne constituent-elles pas « l'un
des défis les plus difficiles à relever en rai-
son de leurs composantes économiques,
culturelles, sociales, psychologiques, éco-
logiques » [Emelianoff, 2005] ? Quels sont
alors leur contenu spécifique, la délimitation
de leur champ et leur portée axiologique ?
Quelles pourraient-elles être pour s'affirmer,
consubstantiellement, comme sujet scientifi-
que et enjeu politique, et ce, dans un contex-
te, celui de la France, marqué par un abord et
un traitement des faits socio-économiques et
environnementaux assez différents du pays
d'origine de ce thème (États-Unis) ? Faut-il
alors construire ces inégalités comme sujet
spécifique et penser des modalités d'actions
dédiées, ou simplement les considérer com-
me une variable nouvelle dans la problémati-
que "plus stabilisée" des inégalités sociales,
pour d'abord interpeller leurs effets plus ou
moins redistributifs des politiques existantes
(sociales, foncières, transport…) ?
Bref, n’y a-t-il pas lieu de d’abord définir de
telles inégalités environnementales de ma-
nière plus dynamique que la seule lecture
statique proposée habituellement ? N’en va-
t-il pas des enjeux que de tels phénomènes
recouvrent tant pour l’action publique mue
par la volonté d’un développement durable
territorialisé, que pour une production de
connaissances tendue, au moins dans les dis-
cours, vers l’interdisciplinarité ?
Partant de quelques exemples d’évolutions
tendancielles qui affectent les métropoles
urbaines (paragraphe 2), nous souhaitons ici,
pour cet effort de définition, montrer plus pré-
cisément la nécessité de comprendre le rôle
des logiques et priorités historiques d’action
des politiques publiques dans l’émergence de
situations socio-environnementales inégali-
taires en ville (paragraphe 3). Dès lors, nous
explorons la possibilité de faire de la capacité
d’action individuelle et des moyens des pou-
voirs publics locaux de lutter contre la vul-
nérabilité environnementale un sujet central
de la problématique des inégalités environne-
mentales, sur la base d’une conception plus
actante de l’environnement, puis en déclinons
quelques objets d’analyse (paragraphe 4). Le
propos s’achève sur les nouveaux horizons et
2 Pour une présentation rapide des courants et objets
d’analyse qui traversent le thème à l’étranger, cf. le
texte introductif du dossier 9 « Inégalités écologiques,
inégalités sociales » de la revue en ligne Développement
durable et territoires (Villalba et Zaccaï, in http://deve-
loppementdurable.revues.org/document3502.html).

113
chantiers que cette nouvelle problématique
d’analyse invite peut-être à ouvrir (paragra-
phe 5). L’ensemble de cette réflexion s’appuie
notamment sur plusieurs des interventions
faites au colloque Inégalités environnementa-
les et sociales. L’environnement, facteur de
cohésion urbaine, organisé par l’association
Urba + en mai 2005 à l’Institut d’Urbanisme
de Paris (Université Paris XII), et poursuit
une réflexion engagée notamment lors du sé-
minaire Inégalités écologiques ou environne-
mentales, organisé par le Laboratoire TVES à
l’Université des Sciences et Technologies de
Lille en mai 2007 [Faburel, 2007].
2. QUELQUES EXEMPLES TIRÉS DE L’URBAIN…
Plusieurs écrits ont d'ores et déjà tenté de
définir les contours des inégalités environ-
nementales, dans leurs liens aux sociétés
locales et aux territoires urbains, voire ont
souhaité livrer un premier cadre d’analyse
pour la France. Selon Laigle et Oehler
(2004), ces inégalités pourraient être carac-
térisées par :
• des inégalités liées à l'héritage et au mar-
quage des territoires urbains,
• des inégalités d’accès à l’urbanité et au
cadre de vie (habitat, équipements, servi-
ces, transports, espaces verts et qualité de
l’environnement urbain),
• des inégalités d’exposition aux nuisances
urbaines (bruits, pollutions, insécurités…)
et aux risques (naturels, technologiques,
industriels…),
• des inégalités dans la capacité d’agir sur
l’environnement et d’interpeller la puis-
sance publique pour la transformation du
cadre de vie.
Ce cadre envisage deux approches complé-
mentaires. La première est un cumul entre
des inégalités sociales et des inégalités en-
vironnementales. La seconde est celle "des
logiques territoriales de développement qui
conditionnent pour une part les modalités de
fragilisation des territoires et des populations
qui y résident". Or, comme l’auteur L. Laigle
le mentionne elle-même, ces deux approches
ne sont pas totalement stabilisées. Ce déficit
renvoie selon nous à la complexité des re-
lations multiples que cette série d'inégalités
entretiendrait avec les inégalités économi-
ques et sociales, particulièrement en ville :
Quels cumuls3 ? Quelles logiques ? Il dé-
coule de ce flou non seulement une orien-
tation diachronique mais surtout une lecture
segmentée des types d'inégalités recensées
comme environnementales, alternant qui
plus est états et processus : passé - héritages
territoriaux ; présent - expositions et accès
actuels ; avenir - capacité d'agir en vue d’une
amélioration.
Pour montrer la nécessité d'une définition
peut-être plus explicative, dynamique et
intégrée des inégalités environnementales,
nous prendrons quelques exemples d’évolu-
tions tendancielles attachés à l'urbain. Clas-
siques pour les grande agglomérations, ces
évolutions contredisent l’acception livrée,
et encore plus la définition conventionnelle,
que l’on retrouve dans le troisième type pro-
posé par Laigle et Oehler.
Par exemple, il est de plus en plus constaté,
en France comme à l'étranger, que les zones
urbaines de faible qualité environnementale
(pourtours d'équipements lourds, de friches
industrielles, espace de faible dotation physi-
que en nature…) accueillent des populations
modestes. En ce sens, selon les deuxième
et troisième types recensés de la définition
relayée ci-dessus, on parle conventionnelle-
ment de zones d'inégalités environnementa-
les : comparativement aux catégories les plus
aisées, les populations de faibles niveaux de
vie sont plus exposées à des pollutions, nui-
sances, risques… et moins pourvues d’une
nature de proximité de qualité. Ceci a notam-
ment été montré récemment à l’échelle de
l’Île-de-France [Faburel, Gueymard, 2007].
3 Voir par exemple le travail de Krieg et Faber (2004)
sur cette question des cumuls, et notamment les indices
proposés pour prendre en compte la diversité des vulné-
rabilités sociales qui se conjuguent avec une multiplicité
de dangers environnementaux (17). Ces vulnérabilités
sociales ne sont pas sans rappeler celles prises en
compte par Amartya Sen, dans son indice de capabili-
ties, pour contredire la vision utilitariste et tenir compte
des capacités réelles des choix de vies lors d’évaluation
des inégalités.

114
Toutefois, ces situations dépréciées permet-
tent aussi parfois de maintenir ces popula-
tions dans des espaces péri-centraux des
villes, i.e. banlieues proches, ou encore des
« dents creuses » des tissus urbains. Donc,
ces situations permettent dans le même
temps souvent un accès un peu plus égalitai-
re aux équipements et services urbains qu’il
ne l’aurait été si ces populations avaient pu
s’éloigner de tels lieux, à condition cepen-
dant que ces derniers ne soient pas le siège
de ségrégations multiples. Ainsi, le corol-
laire de telles inégalités environnementales
pourrait être de permettre une plus grande
facilité d’accès et une plus grande égalité de
traitement face à d'autres biens et services
urbains.
Par ailleurs, lorsque les catégories sociales
intermédiaires, mues notamment par une
volonté d’accession à la propriété, disposent
quant à elles de quelques moyens de réaction
face à l’augmentation des coûts du foncier
et de l'immobilier, elles exercent d'avantage
de pressions sur l'environnement du fait de
l’étalement urbain et des mitages des es-
paces naturels et agricoles auxquels elles
contribuent ; et de leur dépendance à l'auto-
mobile et des trafics alors induits. Elles bé-
néficient toutefois sur leur lieu d’habitation
d’un cadre de vie de meilleure qualité. Dans
le même temps, les plus riches, disposant
des moyens de rester dans les centres d’ag-
glomération, sont de moins en moins posses-
seurs de véhicules, car bénéficiant d'un accès
privilégié à l'offre de transports ferroviaires
de desserte de proximité et inter-urbaine (cas
des mégapoles et métropoles régionales), et
recourrant de plus en plus aux services de
location de véhicules. Les mo-mo (ou mo-
biles-moraux) y développent des valeurs
morales pour donner sens à des actes qu'ils
construisent de plus en plus comme pro-en-
vironnementaux.
Ainsi, cette fois-ci à l'échelle régionale et
non plus à l’échelle des espaces péri-cen-
traux des villes :
• les catégories sociales intermédiaires
pourraient plus polluer, tout en bénéfi-
ciant sur leur lieu de résidence d’un envi-
ronnement naturel de meilleure qualité,
• lorsque les plus hauts revenus résident
en nombre dans des environnements, na-
turels, en définitive de moins bonne qua-
lité (les centres-villes) mais disposent des
moyens de s’en soustraire régulièrement.
L'un et l'autre de ces exemples, inscrits à
des échelles différentes, fragilisent simulta-
nément tant la définition minimale que l’ac-
ception maximaliste des inégalités environ-
nementales. Pourquoi ?
3. … QUI INTERROGENT DÉFINITION RESTRICTIVE ET ACCEPTION
EXTENSIVE DES INÉGALITÉS ENVIRONNEMENTALES
3.1 L’interpellation des logiques et priori-
tés d’actions des politiques publiques : le
laisser-faire en question ?
Si les ménages aisés peuvent aussi être do-
miciliés dans des environnements naturels
de qualité médiocre, la définition minimale
des inégalités environnementales, c’est-à-
dire le seul croisement descriptif des dota-
tions et/ou pressions environnementales et
des caractéristiques sociales des espaces,
ne suffit pas à rendre compte non seulement
des processus à l’œuvre mais aussi de la
multiplicité des facteurs qui interviennent
dans leur construction. Sans compter que
des catégories intermédiaires, dont l’accès
à une conscience écologique est un fait re-
marqué par la sociologie, résident dans des
environnements d’une certaine qualité, tout
en pouvant polluer d’avantage en moyenne,
et être soumis à des risques sous-estimés par
volonté d’accès à des aménités résidentielles
(ex : inondations des berges).
Si ces exemples questionnent les écarts entre
les effets subis par les groupes sociaux et les
impacts qu’ils créent, donc entre empreintes
et devoirs écologiques des différents modes
de vie en présence dans l’urbain [Emelianoff,
2006], ils interrogent en amont de concert
les relations que les inégalités environne-
mentales entretiennent avec la fabrique et la
gestion de la ville. En fait, suivant en cela
nos exemples, parler d'inégalités environne-
mentales implique de se saisir de processus,
par nature dynamiques, entremêlés et donc
complexes. Dans cette remontée en dyna-
mique, se pose alors certes inévitablement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%