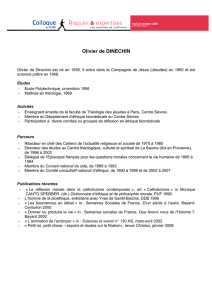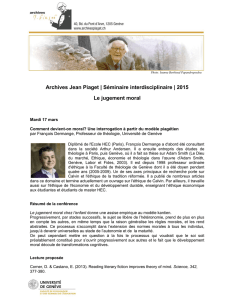rapport-moral-2010

1/2
Association « Foi et culture scientifique » 13 octobre 2010
91, Av. du Général Leclerc
Gif-sur-Yvette
Rapport moral pour l’année 2009-2010
Le président de FCS, Bernard Saugier, a présenté le rapport suivant.
Nous avons commencé à nous réunir plus souvent en bureau pour nous répartir les tâches. Dominique
Grésillon, notre vice-président, assure toujours la lourde tâche de rédacteur en chef de Connaître, il nous parlera
de la revue. Marcelle L’Huillier est secrétaire de notre association, tient à jour la liste des adhérents et surtout
assure la diffusion électronique de l’information sur notre association et sur Connaître, elle a reconstitué et mis
en ligne les pdf des numéros 1 à 32 ; elle souhaiterait que nous célébrions notre 20ème anniversaire par une
réunion ouverte à tout public sur un thème porteur. Jean Leroy s’occupe toujours avec soin des comptes rendus
de nos réunions sauf en cas d’absence. Christian Malet tient à jour le fichier des abonnés à Connaître en
enregistrant les chèques d’abonnement et en transmettant l’info à Marcelle. Marc Le Maire, notre trésorier,
encaisse ces chèques et tient à jour nos comptes. Marie-Odile Delcourt participe régulièrement au bureau avec
des conseils très pertinents sur les thèmes à traiter.
Notre activité a été comme par le passé centrée sur nos réunions mensuelles du mercredi. Nous avons eu
deux réunions dans le prolongement du thème de l’année précédente, la théologie naturelle, puis avons abordé
le thème du changement climatique.
Le 23/9/2009, Marie-Odile Delcourt nous a parlé d’un livre de Jacques Laguirand et Jean-René Proulx,
Le Dieu cosmique, à la recherche du Dieu d’Einstein. C’est un livre assez foisonnant qui présente les croyances
de divers scientifiques dont Einstein, en insistant sur une approche de Dieu par la nature (théologie naturelle).
Le cosmos est vu comme énergie créatrice, intelligence ordonnatrice, totalité organique avec une tendance à
refuser l’approche chrétienne par la révélation.
Le 14/10/2009, François Euvé nous présente le dernier chapitre de son livre Darwin et le christianisme,
intitulé D’un Dieu programmeur au Dieu de la promesse, ainsi qu’un article qu’il a écrit récemment : Le
quadruple défi darwinien (Etudes, 411/5, nov. 2009). La foi chrétienne peut être argumentée en raison, et les
sciences influencent notre lecture des Ecritures. Mais dans la vision scientifique et chez Darwin, on n’a pas
besoin de Dieu pour expliquer le monde, et on refuse l’idée de finalité. La théologie accepte ce point de vue,
mais refuse le scientisme et sa fermeture fataliste : l’avenir reste ouvert à la créativité de Dieu et des hommes.
Par ailleurs, il y a opposition entre l’évolution, historique et contingente, et la science qui se veut libérée de
l’histoire. On peut lire l’évolution comme une succession de catastrophes, mais aussi comme une suite
d’ouvertures vers ce qui fait communion entre les hommes. L’action divine serait ce qui nous pousse vers cette
unité.
Le 18/11/2009 a été consacré à l’AG de l’association, en 2008-2009 nous avions poursuivi sur la
théologie de la nature et la question de l’homme, avec notamment l’étude des trois premiers chapitres de la
Genèse. Nous avons ensuite introduit la réflexion sur le changement climatique, avec une présentation des bases
physiques de l’effet de serre. On insiste sur l’épuisement des combustibles fossiles et sur la diversité des
conséquences du réchauffement climatique selon les régions.
Le 9/12/2009, nous avons traité des controverses autour du changement climatique mais je n’ai pas
retrouvé de compte rendu.
Le 13/1/2010, Marie-Odile Delcourt a introduit un débat sur le développement durable : « Qu’est-ce
qu’un avenir durable ? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, s’adapter, comment ? ». Quelques
exemples de réalisation sont présentés dans l’agriculture, l’habitat, les transports. On cherche à définir des
indices prenant en compte les coûts environnementaux (PIB vert), la durabilité environnementale (empreinte
écologique), le développement humain (IDH, indice de progrès véritable). Le rapport Stern a cherché à estimer
le coût actuel de prévention du changement climatique (de l’ordre de 1% du PIB) comparé au coût de lutte
contre le réchauffement d’ici un siècle en cas de laisser-faire (10 à 20% du PIB). On aborde la question de la
décroissance, et celle de la gouvernance face aux défis environnementaux. Il faudrait rechercher des types
d’activité permettant de mettre davantage de gens au travail (les jeunes et les seniors), en essayant de diminuer
les ponctions sur les ressources naturelles. L’information sur le bilan carbone de nos activités peut aider à

2/2
changer notre comportement. Limiter la consommation n’est possible que pour ceux qui ne manquent de rien,
mais on peut être heureux avec une existence frugale.
Le 10 février, nous avons abordé un sujet différent de notre thème d’année : Une éthique universelle est-
elle possible ? Peut-on se référer à une loi naturelle ? Ce débat introduit par François Euvé fait suite à un
rapport de la Commission théologique internationale. L’idée est que « les personnes et les communautés
humaines sont capables, à la lumière de la raison, de discerner les orientations fondamentales d’un agir moral
conforme à la nature même du sujet humain et de les exprimer de façon normative sous forme de préceptes ou
commandements ». La nature est celle de la nature humaine, qui n’est plus en harmonie avec la nature tout court
mais cherche à la dominer par la science depuis Descartes et Bacon. Au départ, la loi suit la coutume, mais
comme les coutumes varient, on peut chercher des lois plus universelles, mais qui soient aussi acceptées par la
conscience personnelle (cf. droits de l’homme). Ainsi on peut dire que l’action bonne contribue à rapprocher les
personnes, à resserrer les liens de communion. C’est l’attitude évangélique du don, qui va bien au-delà de la loi
vers la démesure même de Dieu. La discussion fait apparaître l’idée que la nature humaine n’est pas fixée, mais
se construit en fonction d’une visée dont la figure n’est pas définie à l’avance. Mais comment utiliser cette idée
dans des problèmes concrets à résoudre, en bioéthique par exemple ? On rappelle la faiblesse de l’argumentation
d’un texte comme « Humanae vitae », et aussi le souci du pape d’éviter tout relativisme en matière d’éthique.
Le 10 mars, nous sommes revenus au changement climatique : controverses sur l’effet de serre,
importance de la déforestation, mesures à prendre pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, sur les
plans collectif et individuel. La discussion a souligné la difficulté de la tâche : réduire d’un facteur 4 les
émissions des pays développés, modérer la croissance de celles des pays en développement, avec le fait que la
croissance démographique et industrielle concerne surtout ces derniers pays. Comment faudra-t-il changer notre
mode de vie ?
Le 14 avril, nous avons abordé les aspects éthiques et religieux se posant à propos du changement
climatique, à partir des comptes rendus d’un colloque qui s’est tenu sur ce thème et particulièrement de la
position du philosophe Jean-Michel Besnier. Pour Besnier l’incertitude des modèles climatiques laisse le champ
libre à des décisions en matière d’éthique : Pour lui il n’y a plus de recours extérieur scientifique ou religieux
pour imposer des normes universelles, le seul recours possible est un travail de discussion collective pour
élaborer des normes. Mais un système démocratique fondé sur l’éthique de la discussion prend du temps, un
système autoritaire irait plus vite mais a beaucoup d’autres inconvénients. Il n’est pas sûr qu’on ait envie de
faire quelque chose, mais la meilleure manière de mobiliser les gens est de rejoindre leur quotidien. Dans la
discussion on rappelle que l’éthique est la recherche du bien vivre ensemble mais y a-t-il dans nos sociétés
culturellement diverses une définition consensuelle du bien vivre et de l’éthique ? A défaut de grand projet
mobilisateur qui ne peut plus fonctionner dans l’idéologie actuelle, il faut retrouver un autre genre de société
plus sobre et plus égalitaire à l’échelle mondiale.
Le 12 mai, nous avons abordé avec encore François Euvé le thème En quoi l'écologie questionne-t-elle la
théologie de la Création ? La crise écologique met en cause une certaine vision du monde et de l’humain, ce qui
débouche sur un questionnement de type théologique. Lynn White en 1967 a mis en cause le christianisme dans
un article de la revue Science à cause du texte de Genèse 1 : Croissez et multipliez, dominez la terre et
soumettez-la. Dès le Moyen-Âge, le christianisme aurait favorisé l’essor des techniques et l’exploitation sans
retenue de la nature. Les réactions des théologiens à ces critiques ont été modestes. On peut citer Joseph Siter,
Thomas Berry, Adolphe Gesché, Jürgen Moltmann et Douglas Hall. La discussion fait apparaître l’originalité du
christianisme dans lequel le Logos créateur est en même temps une personne historique concrète, Jésus de
Nazareth : l’humain est associé à l’origine du cosmos. On remarque que les associations chrétiennes s’occupent
peu d’environnement. L’héritage biblique fait de l’homme une entité à part, et cette séparation homme-nature a
été radicalisée par la tendance moderne. Pourtant dans la vision chrétienne l’humain est appelé à continuer la
création en collaboration avec Dieu et en harmonie avec la nature.
Le 9 juin, Marcelle L’Huillier nous a présenté « Les nanotechnologies. Quels enjeux pour la société et
pour l’homme ? ». J’ai le texte de Marcelle qu’elle nous a envoyé en juillet mais pas le CR de la discussion :
présentation des nanosciences et des nanotechnologies, enjeux économiques, enjeux et interrogations pour la
société, questions éthiques et philosophiques sur les relations homme-nature, pour une parole ecclésiale de
confiance et d’espérance. C’est un texte très intéressant et bien documenté qui complète très bien la présentation
qu’elle nous en a faite oralement. Il mérite d’être repris dans une discussion plus générale que celle de juin
2009.
1
/
2
100%