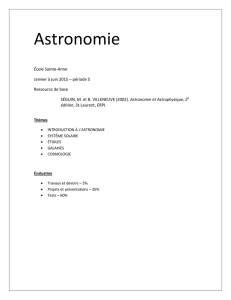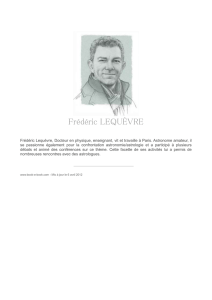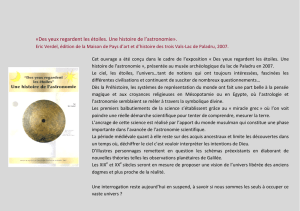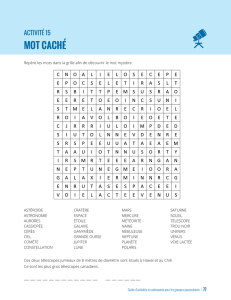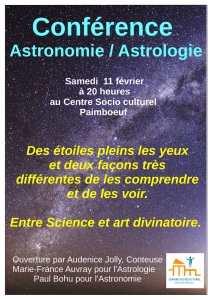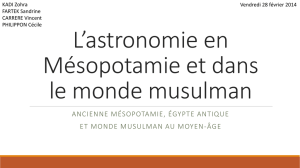Extrait de la publication

Extrait de la publication

Profession
astronome

Collection
dirigée
par
Benoît
Melançon
et
Florence
Noyer
Catalogage
avant
publication
de
Bibliothèque
et
Archives
Canada
Wesemael,
François
Profession,
astronome
Comprend
des
réf. bibliogr.
ISBN
2-7606-2005-0
1.
Astronomes.
2.
Astronomie
-
Aspect social.
I.
Titre.
QB51.5.W47
2006
520'.23
C2006-940033-4
Dépôt
légal
:
1er
trimestre 2006
Bibliothèque nationale
du
Québec
©
Les
Presses
de
l'Université
de
Montréal, 2006
Les
Presses
de
l'Université
de
Montréal remercient
de
leur soutien
finan-
cier
le
ministère
du
Patrimoine canadien,
le
Conseil
des
Arts
du
Canada
et
la
Société
de
développement
des
entreprises culturelles
du
Québec
(SODEC).
IMPRIMÉ
AU
CANADA
EN
FÉVRIER
20O6

FRANÇOIS
WESEMAEL
Profession
astronome
Les
Presses
de
l'Université
de
Montréal

Page laissée blanche
Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%