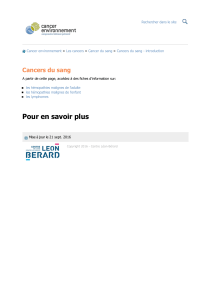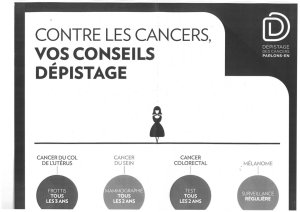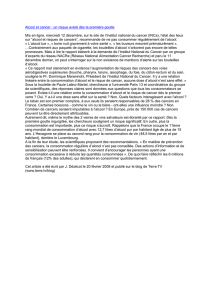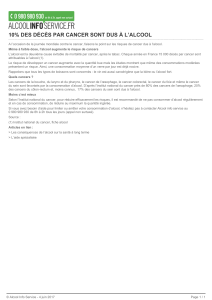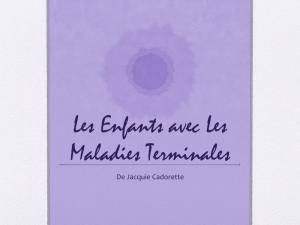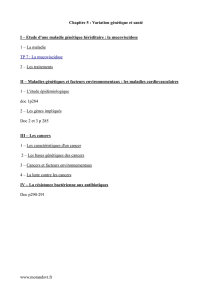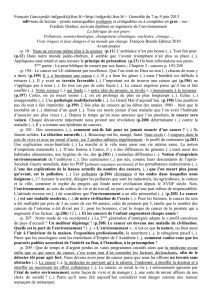Cancer de la jonction œsogastrique–cancer de l`estomac : la même

Mini-revue
Cancer de la jonction
œsogastrique–cancer
de l’estomac :
la même pathologie ?
Emmanuel Buc
1
, Nicolas Carrere
2
, Denis Pezet
1
1
Service de chirurgie générale et digestive, CHU, 63058 Clermont-Ferrand
2
CHU Rangueil, 31059 Toulouse Cedex
Les adénocarcinomes gastriques et du cardia sont fréquemment
regroupés dans la littérature, ce qui pose des problèmes de relevé
des données épidémiologiques et de l’élaboration des référentiels.
Le terme d’adénocarcinome de la jonction œsogastrique est préfé-
rable à celui de cancer du cardia. Les cancers de la jonction
œsogastrique se subdivisent en trois types selon leur position par
rapport au cardia anatomique. Cette classification, simple en
théorie, pose des problèmes pratiques de détermination selon
l’exploration réalisée, de recoupement possible avec les cancers
gastriques et de corrélation avec le staging TNM. L’évolution
apparemment divergente des incidences des adénocarcinomes
gastriques en diminution et des adénocarcinomes de la jonction
œsogastrique en augmentation est en fait sous la responsabilité
d’une augmentation isolée des adénocarcinomes de la jonction
œsogastrique de type I et la diminution des adénocarcinomes
gastriques distaux et des formes histologiques intestinales. Les
facteurs de risque de ces deux pathologies sont différents et des
arguments existent pour penser que l’augmentation des cancers de
la jonction œsogastrique de type I n’est ni directement ni indirec-
tement liée à l’éradication d’Helicobacter pylori. Aucune étude n’a
permis de montrer une différence dans la réponse thérapeutique
oncologique entre les adénocarcinomes de la jonction œsogastri-
que et gastrique. Au total, les cliniciens doivent plaider pour
l’autonomisation d’une entité particulière des cancers de la jonc-
tion œsogastrique qui, tenant compte des trois types, permettrait
l’élaboration d’un thésaurus spécifique.
Mots clés : adénocarcinome gastrique, adénocarcinome du cardia, jonction
œsogastrique
Les adénocarcinomes du cardia et de l’estomac sont souvent regrou-
pés ou confondus en une seule entité pour des raisons de simplifi-
cation ou par pragmatisme du fait des similitudes histologiques de
ces deux cancers. Cette approximation pose des problèmes dans l’inter-
prétation des données épidémiologiques et la mise au point des référen-
Hépato-Gastro, vol. 14, n°4, juillet-août 2007
Tirés à part : E. Buc
317
doi: 10.1684/hpg.2007.0117
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

tiels. Le but de cette mise au point est de mettre en
évidence les points communs et les différences de ces
deux lésions.
Problèmes posés
par les définitions
Le cancer du cardia (terme d’origine grecque souli-
gnant la proximité du cœur de cette zone) est la
dénomination la plus usitée des cancers de la jonction
œsogastrique, terminologie théoriquement préférable
car correspondant à une réalité clinique. Ces cancers
de la jonction œsogastrique sont définis par la locali-
sation du centre de la tumeur dans une zone de 10 cm
de hauteur centrée sur le cardia anatomique. Le cardia
anatomique est défini comme situé immédiatement
au-dessus de l’origine des plis gastriques. Il existe une
particularité histologique de cette zone avec une
richesse singulière de cellules sécrétrices de mucines
[1]. La classification internationale distingue :
–les tumeurs de type I ou Siewiert I situées entre 5 et
1 cm au-dessus du cardia anatomique : il s’agit donc
de cancers situés sur le bas œsophage (figure 1) ;
–les tumeurs de type II ou Siewert II situées entre 1 cm
au-dessus et 2 cm au-dessous du cardia anatomique
qui sont les réelles tumeurs du cardia anatomique
(figure 2) ;
–les tumeurs de type III ou Siewert III situées entre 2 et
5 cm en dessous du cardia anatomique qui sont les
tumeurs sous-cardiales (figure 3).
Cette définition pose le problème d’être endoscopique.
En théorie, elle est précise, simple et corrélée à l’histo-
logie mais, si le cardia correspond à la ligne Z en
l’absence d’endobrachyœsophage (EBO), il est situé
sous cette ligne en cas d’EBO, ce qui est une première
cause de confusion. Le développement de la tumeur
peut masquer le cardia anatomique. Une tumeur initia-
lement développée sur la jonction œsogastrique peut
avoir un développement prépondérant vers le haut ou
vers le bas. Prendre comme repère l’épicentre de la
tumeur est approximatif et imprécis, ce qui est une
deuxième cause de confusion. La corrélation entre
l’exploration endoscopique et les autres explorations
est difficile et source d’erreurs délétères à la prise en
charge. Les figures 4, 5, 6 montrent trois transits
barytés œsogastriques de tumeurs classées Siewert II
en endoscopie. Les figures 5 et 6 montrent nettement
l’ascension intrathoracique du fait d’une hernie hia-
tale. Dans ces deux cas, la classification endoscopique
risque d’induire une erreur de prise en charge, notam-
ment chirurgicale. La corrélation endoscopie-scanner
est aussi difficile et n’est possible qu’en l’absence de
hernie hiatale (figures 7, 8, 9). La prise de décision,
notamment chirurgicale, impose au clinicien de réaliser
l’analyse de plusieurs explorations comportant au mini-
mum l’endoscopie et une iconographie radiologique.
Le cancer de l’estomac se définit selon la classification
utilisée comme une lésion dont le pôle supérieur est
situé entre 2 et 5 cm de la jonction œsogastrique. Cela
est donc potentiellement responsable d’un risque de
chevauchement avec les cancers de la jonction œso-
gastrique de type III.
Ces problèmes de définition induisent directement un
problème dans la 6
e
classification de l’UICC de ces
cancers. En effet, il est prévu dans cette classification
que les cancers de la jonction œsogastrique soient
regroupés avec les cancers gastriques. Or le traitement
des cancers de type I est similaire à celui des cancers
œsophagiens dont la classification TNM est totalement
différente. À titre d’exemple, le statut N est déterminé
par la localisation pour les cancers œsophagiens et
par le nombre pour les cancers gastriques. La localisa-
tion cœliaque d’une adénopathie classe M1 un cancer
de l’œsophage et M0 un cancer gastrique. Classer le T
de deux localisations dont l’organisation histologique
est différente pose problème ; or, la jonction œsogas-
Figure 1.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type I.
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 14, n°4, juillet-août 2007
318
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

trique, contrairement à la paroi gastrique, n’est que
partiellement péritonisée, la définition des T2 et T3
devient non comparable.
Une épidémiologie différente ?
Une différence souvent affichée entre cancer gastrique
et cancer de la jonction œsogastrique est l’évolution
opposée de leur incidence. Qu’en est-il réellement ?
L’incidence du cancer gastrique est en diminution
depuis 50 ans. L’étude de Bouvier et al. [2] montrait
que le nombre de nouveaux cas en France était passé
de 7 100 à 8 700 entre 1980 et 2000, le faisant
ainsi passer de la quatrième à la neuvième place des
cancers. Si cette diminution n’est pas contestée, il faut
préciser qu’elle intéresse essentiellement les cancers
distaux de l’estomac, les formes histologiques intestina-
les [3] et certaines zones géographiques [4]. En
Europe, l’incidence des cancers du fundus reste stable,
les formes histologiques diffuses sont en augmentation.
L’incidence de l’adénocarcinome, dénommé cancer du
cardia dans la littérature, est reconnue comme étant en
augmentation constante depuis 20 à 30 ans. Cette
augmentation est le plus souvent présentée comme
intéressant globalement les trois types de cancer de la
jonction œsogastrique. Les adénocarcinomes œsopha-
giens englobant le plus souvent, dans les études épidé-
miologiques, ces cancers représentaient avant 1975
moins de 4 % de la totalité des cancers de l’œso-
phage. Depuis cette période, l’augmentation a été
constante et d’environ 10 % par an. L’équilibre entre
épidermoïdes et adénocarcinomes a été atteint vers
Figure 2.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type II.
Figure 3.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type III.
Figure 4.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type II, anatomie normale sans hernie hiatale.
Hépato-Gastro, vol. 14, n°4, juillet-août 2007 319
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

1995 pour basculer en faveur des adénocarcinomes
depuis cette période. Une analyse plus fine de l’épidé-
miologie permet de montrer que l’augmentation de ces
adénocarcinomes s’est faite essentiellement au profit
des adénocarcinomes de type I de Siewert. Les types II
et III ont vu leur incidence progresser beaucoup plus
lentement et se stabiliser à partir de 1990 [5, 6]. Au
total, la diminution de l’incidence des cancers gastri-
ques est liée à la raréfaction des cancers de l’antre et
des formes intestinales alors que l’augmentation des
cancers de la jonction œsogastrique est liée aux types I
de Siewert.
Des facteurs de risques différents ?
Outre les classiques facteurs de risque de l’adénocar-
cinome gastrique que représentent l’infection à Helico-
bacter pylori, la nutrition riche en sels ou fumée, il faut
noter les étiologies de gastrites atrophiques (anémie
pernicieuse, gastrite toxique, gastrectomie partielle), la
gastropathie hypertrophique de Métenier et les poly-
pes adénomateux [7]. Les formes génétiques sont rares
Figure 5.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique classé de type II en endoscopie, hernie hiatale. Figure 6.Opacification barytée : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique classée de type II en endoscopie, volumineuse hernie
hiatale.
Figure 7.Tomodensitométrie : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type I.
Mini-revue
Hépato-Gastro, vol. 14, n°4, juillet-août 2007
320
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

mais doivent être connues car accessibles au dépis-
tage : mutation de la E cadhérine, syndrome HNPCC
(polypose adénomateuse rectocolique familiale) et syn-
drome de Peutz-Jeghers. Concernant H. pylori reconnu
comme carcinogène de classe I, l’infection chronique
par ce germe multiplie par trois le risque de cancer
gastrique [8]. Sa fixation à l’antigène Lewis explique
probablement l’augmentation de la fréquence de ces
cancers dans la population de groupe sanguin A [9].
Son éradication, si elle survient tardivement dans la
vie, n’est peut-être pas protectrice du risque de cancer
[10]. La distribution géographique des différentes sou-
ches explique en partie les différences d’incidence
selon les pays ou les origines ethniques. Ainsi, la
souche CagA (cytotoxyn associated gene A) est nette-
ment plus carcinogène que les autres souches.
En revanche, la notion répandue que l’infection à
H. pylori puisse protéger du cancer de la jonction
œsogastrique mérite une analyse plus précise. L’hypo-
thèse classique était qu’elle diminuerait l’exposition
acide de la jonction œsogastrique par le biais de la
gastrite atrophique ou le tamponnement du pH par sa
sécrétion d’ammonium. En fait, certaines études épidé-
miologiques ne confirment pas cette hypothèse. Il en est
ainsi de l’étude cas témoin de Wu et al. [11] qui ont
comparé les données de 356 témoins à 127 malades
atteints de cancer gastrique distaux, 80 atteints de
cancers de l’œsophage et 87 de cancers du cardia.
L’infection à H. pylori était un facteur favorisant les
cancers gastriques mais n’amenant aucune protection
vis-à-vis des cancers de l’œsophage ou du cardia.
L’étude de Ye et Nyren [12], qui s’intéressait au risque
de cancer œsophagien et gastrique dans une popula-
tion de plus de 21 000 patients suivis pour anémie
pernicieuse en Suède, a montré qu’il n’y avait pas de
relation positive ni négative, c’est-à-dire que, s’il n’y
avait pas d’augmentation du risque, il n’y avait pas
non plus de protection, de l’atrophie gastrique vis-à-vis
des cancers de la jonction œsogastrique. Dans une
autre publication, Ye et al. [13] ont montré que la
protection de l’infection par H. pylori vis-à-vis des can-
cers du bas œsophage était significative mais indépen-
dante de la gastrite atrophique. L’augmentation de
l’incidence des cancers de la jonction œsogastrique
n’est donc pas liée à la diminution des cancers
gastriques.
Les facteurs de risques pour ces cancers sont unanime-
ment reconnus comme comportant l’obésité, le reflux
gastro-œsophagien (RGO) et, à un moindre degré, le
tabac. Quant est-il réellement pour les trois types de
cancer de la jonction œsophagienne ? Concernant les
types I, la littérature est homogène pour reconnaître la
relation entre le risque de cancer et l’existence d’un
EBO. L’EBO est la conséquence du RGO. Les nitrites
consommés, concentrés dans la salive, sont transfor-
més en nitrates au contact de l’acide avec synthèse de
radicaux libres carcinogènes. La métaplasie intestinale
précède la dégénérescence. Pour les types II, la rela-
tion entre l’adénocarcinome et un EBO, même limité,
est incertaine. Dans l’étude de Siewert et al. [14]
réalisée sur 1 000 malades, seuls 10 % des adénocar-
cinomes de type II étaient associés à un EBO. La même
équipe a montré qu’une métaplasie intestinale n’était
présente que dans 32 % des cas et développée soit sur
un EBO très court, soit directement sur la muqueuse
cardiale. Enfin, pour les types III, il n’y a pas de relation
entre le cancer et un EBO ; pour ces localisations, on se
rapproche de la carcinogenèse gastrique sans
Figure 8.Tomodensitométrie : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type II, interprétation imposant d’avoir éliminé une
hernie hiatale.
Figure 9.Tomodensitométrie : adénocarcinome de la jonction
œsogastrique de type III, interprétation imposant d’avoir éliminé une
hernie hiatale.
Hépato-Gastro, vol. 14, n°4, juillet-août 2007 321
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%