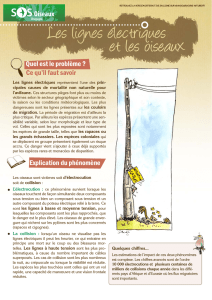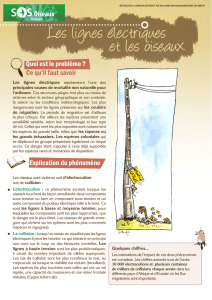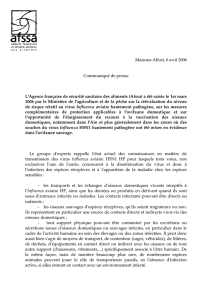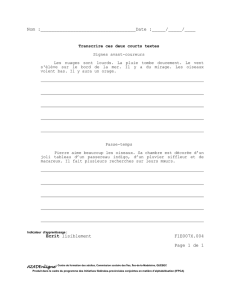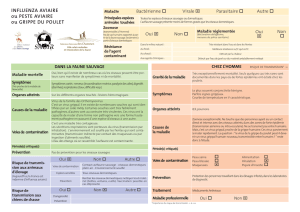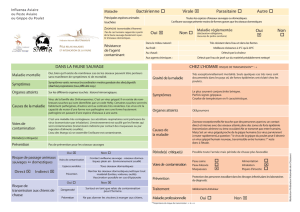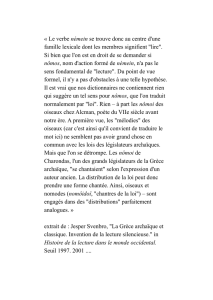Evolution de l`avifaune en Dyle : un espoir ?

1
Evolution de l’avifaune en Dyle : un espoir ?
par Marc Walravens
La vallée de la Dyle entre Wavre et Leuven est une zone naturelle unique en Brabant et
relativement bien préservée. Le fond de la vallée, quasiment non bâti, est traversé de peu de
routes et la rivière y coule librement, parmi des milieux semi-naturels riches et variés. Cette
richesse et diversité augmentent encore en y associant les zones non urbanisées des plateaux
voisins et des vallées adjacentes : zones humides (étangs, marais, prairies et bois alluviaux),
forêts et bois variés, zones agricoles ouvertes, grands parcs privés et même quelques
reliques de bruyères. Un tel maillage écologique recèle une belle biodiversité, notamment au
niveau de l’avifaune.
« Vogels in het Dijleland » (H
ENS
, 2000), rapporte 271 espèces d’oiseaux observées dans la
partie flamande de la région de la Dyle
1
, dont 109 nicheuses. S’y ajoutent 25 espèces
exotiques échappées de captivité ou introduites par l’homme, dont 7 se reproduisent.
L’avifaune dans la partie wallonne arbore une richesse comparable : l’ « Avifaune des Oiseaux
nicheurs de Belgique »
(D
EVILLERS
& al., 1988)
renseigne environ 107 espèces
nicheuses
2
.
Globalement, en Belgique
comme ailleurs, la richesse de
l’avifaune et sa diversité sont
de plus en plus menacées et le
nombre d’espèces qui
disparaissent de régions
entières ou dont les effectifs
régressent de façon alarmante sont légions (cf. Figure 1).
La nature en Dyle étant plutôt bien préservée et faisant même l’objet de soins particuliers
pour y maintenir et y développer la biodiversité, il est légitime de se demander comment y
évolue l’avifaune ?
L’inventaire mené de 2001 à
2005 dans le cadre du nouvel
atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie est optimiste, puisqu’il a permis de recenser 113
1
Le nombre d’espèces varie légèrement selon la nomenclature utilisées, certaines espèces étant parfois considérées
comme sous-espèces.
2
Sur base des carrés Hamme-Mille, Chaumont-Gistoux et Wavre. Inventaire réalisé principalement de 1973 à 1977.
Figure 1 Evolution des populations d’oiseaux commun dans l’Union Européenne
(http://ec.europa.eu/environment/indicators/pdf/leaflet_env_indic_2009.pdf)

2
espèces nicheuses dans la partie wallonne de la Dyle. L’analyse détaillée des résultats est
pourtant bien moins réjouissante car si le nombre d’espèces est resté stable, nombre d’entre
elles sont au bord de l’extinction. En fait, la réponse des oiseaux à la situation
environnementale actuelle est très différente selon les groupes d’espèces envisagés.
Comme mentionné dans le graphe à la figure 1, les régressions les plus alarmantes ces
dernières années concernent les oiseaux des milieux agricoles ouverts (champs, cultures,
pâtures) : alouettes, pipits, bruants, moineaux et linottes se font de plus en plus rares ou ont
déjà disparu. A titre d’exemple, le Pipit farlouse, petit passereau inféodé aux prairies et
bords de chemin herbeux était estimé à plus de 125 couples nicheurs sur 80 km² en 1977. En
2005, à peine 3 couples ont été retrouvés. Par contre, la population de la Bergeronnette
printanière, une espèce proche, semble stable. En fait, la bergeronnette s’est adaptée à son
nouvel environnement et niche aujourd’hui en cultures de céréales, parfois de betteraves,
alors que ce n’est pas le cas du pipit, qui a disparu avec les pâtures et les herbes folles.
Si pour cette espèce la régression est générale sur toute la zone étudiée, pour d’autres,
comme le Bruant proyer ou l’Alouette des champs, le recul est variable selon les endroits.
Ainsi, le plateau agricole situé à l’est de Gottechain est le dernier bastion du Bruant proyer
dans la région et conserve une belle population d’Alouettes (14 couples au km²), alors que sur
le plateau de Bossut tout proche, le bruant a disparu et l’alouette y est rare. Il est probable
que cela tient en grande partie aux conditions de culture locales (pesticides, jachères,
tournières, bords de chemins etc.)
Un deuxième groupe d’oiseaux en forte régression est constitué de migrateurs au long cours,
hivernant généralement en Afrique, souvent au sud du Sahara. Ces espèces se rencontrent
tant dans des milieux ouverts (Tarier pâtre), que boisés (Pouillot siffleur, Pipit des arbres,
Rougequeue à front blanc) ou humides (Rousserolle turdoïde, Locustelle luscinoïde). Certaines
d’entre elles étaient encore bien représentées en 1977 mais toutes ont (quasi) disparu
aujourd’hui. Pour la première fois, en 2009, aucun territoire de nidification n’a pu être
confirmé pour le Loriot, ni pour la Tourterelle des bois, et
la population du Coucou gris se réduit à une peau de chagrin
et désormais limitée aux milieux les plus favorables dans le
fond de la vallée de la Dyle. La plupart de ces espèces
migratrices ne parviennent plus à faire face à la
détérioration ou disparition de leurs milieux de nidification
en Europe, d’hivernage en Afrique et aux agressions qu’elles
subissent pendant les migrations.
Les causes de régression sont parfois plus spécifiques ou
inconnues. Ainsi, le Rossignol, hivernant en Afrique
méridionale, est désormais éteint en Dyle, alors que sa
cousine la Gorgebleue, qui passe la mauvaise saison dans le
Figure 2 Gorgebleue à miroir blanc
(Aquarelle M. Walravens)

3
nord-est du continent africain, fut en augmentation à la fin du 20
e
siècle et semble
actuellement stable. Pourtant les milieux occupés par le Rossignol il y a 15 ans à peine n’ont
apparemment pas évolué.
En fait, certaines détériorations du milieu nous sont à peine perceptibles : une évolution
subtile des espèces végétales peut amener des bouleversements dans l’entomofaune et,
quasiment sans que nous ne nous en rendions compte, la disparition des sources de nourriture
pour telle ou telle espèce spécialisée. D’une façon générale d’ailleurs, la spécialisation des
espèces s’accroît en période de reproduction et les modifications du milieu, aussi futiles
soient elles, n’en sont que plus dramatiques. C’est probablement pour cette raison que le
Tarier des prés a disparu et que le Tarier pâtre ne parvient pas à reconstituer ses effectifs,
malgré la restauration de prairies de fauches.
Heureusement, tout le tableau n’est pas aussi noir. D’une façon générale, certaines
populations d’anatidés ainsi que les rapaces se portent relativement bien.
Grâce à la protection dont ces derniers bénéficient désormais, les populations d’oiseaux de
proie, décimées pendant des décennies, ont pu en partie se reconstituer au cours de ces 30
dernières années. Ainsi, alors que la population de la Buse variable était estimée entre 1 et 5
couples sur 80 km² en 1977, l’inventaire de 2005 l’estime à une quinzaine de couples. Faucons
hobereaux, Eperviers et Autours sont des nicheurs bien établis et depuis quelques années, le
Faucon pèlerin est vu de plus en plus régulièrement en dispersion postnuptiale et un couple
non nicheur est même établi à Leuven. Petite ombre au tableau, le Busard des roseaux, rapace
migrateur nichant dans de vastes roselières, se reproduisait en Dyle dans les années
septante, mais n’y niche plus aujourd’hui. Par contre le Busard cendré, un oiseau rare,
autrefois nicheur sporadique (1943, 1956), fréquente annuellement les grandes plaines
agricoles et niche en très petit nombre dans les champs de céréales. En 2000, un couple s’est
reproduit à Beauvechain.
Les populations nicheuses et hivernantes d’anatidés sont typiquement tributaires de la
qualité de l’eau et de zones de quiétude. Il est par exemple remarquable de constater que
seulement 0 à 2 couples de fuligules se reproduisent à l’étang de Pécrot, où vit une
importante population de poissons fouisseurs : ceux-ci, par leur mode de vie, rendent l’eau
trouble et empêchent le développement d’une faune et d’une flore aquatiques favorables à la
biodiversité. Par contre, au marais de Laurensart, à la végétation plus variée et à l’eau plus
limpide, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de couples de Fuligules morillons et une douzaine
de Fuligules milouins qui nichent avec succès. S’il fallait encore démontrer l’importance de la
qualité de l’eau sur la biodiversité, l’exemple du Grootbroek à Sint-Agatha-Rode est sans
équivoque : cette ancienne pisciculture, rachetée il y a quelques années par la Région

4
flamande, a été vidangée au printemps 2005 pour en éliminer la population de poissons
fouisseurs. Alors qu’à peine l’un ou l’autre couple de Fuligule morillon ou de Grèbe huppé s’y
reproduisait, l’avifaune aquatique explose dès 2006 : Grèbes huppés et castagneux, Canards
colvert et chipeaux, Fuligules milouins et morillons s’y reproduisent en quantité et même un
couple de Sarcelles d’été y mène à bien une nichée. Dès l’hiver suivant, des Cygnes de Bewick
passent la mauvaise saison sur le site, ce qui n’était plus arrivé depuis près de 20 ans.
En dehors de la période de nidification, les populations d’oiseau d’eau sont également
nettement plus nombreuses depuis la mise en réserve et la gestion appropriée des étangs en
région flamande. La Dyle constitue à nouveau une zone d’hivernage importante en Belgique et
majeure en Brabant : centaines de Canards chipeaux, souchets, de Sarcelles d’hiver et de
Fuligules milouins et morillons et dizaines de Canards siffleurs, pilets et de Tadornes de
Belon.
Il est par ailleurs intéressant de noter que, depuis que le lâcher de Canards colverts à des
fins cygénétiques n’est quasi plus pratiquée, cette espèce n’est plus dominante et est même
régulièrement surpassée en nombre par le Canard chipeau.
L’évolution des populations d’oiseaux d’eau n’est effectivement pas uniquement liée à la
qualité de l’eau et à l’absence de dérangement : il y a également une extension ou un
déplacement de certaines populations orientales d’anatidés vers nos contrées. Ainsi, le
Fuligule morillon, qui n’était qu’un migrateur de printemps en Dyle dans les années 60, s’est
établi comme nicheur vers 1977 et est désormais devenu une espèce « banale ». Il en est de
même du Canard chipeau.
Les ambitieuses mesures environnementales prises en faveur de certaines zones humides en
Europe et la protection dont bénéficient désormais la plupart des grands échassiers portent
leur fruit. Ainsi, le Héron cendré est à nouveau un nicheur bien représenté dans notre région
Figure 3 Tadorne de Belon (Aquarelle M. Walravens)

5
et la Grande Aigrette, autrefois visiteur exceptionnel, est désormais un hôte régulier tout au
long de l’année avec une présence croissante à chaque migration (60 ex au dortoir de
Neerijse en octobre 2009 !). L’observation de ces espèces, tout comme celle régulière du
Butor étoilé (jusque 4 ex visibles en bordure du même plan d’eau) ou celle irrégulière des
Cigognes blanches et noires, des Hérons pourprés et garde bœufs, de la Spatule blanche, de
l’Aigrette garzette et même de l’Ibis falcinelle témoignent de l’attractivité des zones
humides de la vallée sur ces grands migrateurs.
Le réchauffement du climat est de plus en plus évoqué comme l’une des causes de l’évolution
de l’avifaune, notamment par le biais de la modification de la flore, des populations d’insectes
qui en dépendent, et donc de la nourriture disponible pour quantité d’oiseaux. Peut-être faut-
il voir là une des causes de la disparition du Pipit farlouse ou de la Pie-Grièche grise ou de
l’apparition de la mystérieuse Bouscarle de Cetti, cette fauvette aquatique méridionale
sédentaire apparue fin des années septantes, puis disparue suite à une succession d’hivers
froids avant de refaire un retour en force il y a quelques années.
Des modèles mathématiques complexes ont été utilisés pour simuler l’évolution de l’avifaune
européenne suite au réchauffement global probable du climat. Ce ne sont là que des
simulations, mais le bouleversement de l’avifaune serait considérable au cours du siècle à
venir : apparition ou retour comme nicheur d’espèces auxquelles nous rêvons parfois comme le
Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Merle de roches ou le Pipit rousseline et disparitions
d’espèces plus communes comme la Locustelle tachetée, le Pouillot fitis ou la Mésange boréale
(H
UNTLEY
& al., 2007).
On ne pourrait clôturer ce bref aperçu sur l’ évolution de l’avifaune de la Dyle sans évoquer le
cas des oiseaux exotiques échappés ou volontairement introduits et qui se reproduisent
désormais librement. Le cas de la Perruche à collier reste actuellement assez circonscrit
(Pécrot, Néthen et Hamme-Mille) et a probablement peu d’impact sur l’avifaune locale. Par
contre deux grandes espèces d’anatidés, la Bernache du Canada et l’Ouette d’Egypte ont
développé des populations importantes (dortoirs de respectivement plus de 500 et près de
100 ex) qui ont probablement un impact négatif pour les espèces indigènes : dérangement
pendant la nidification, eutrophisation des eaux (dortoirs).
En conclusion, le bilan de l’évolution de l’avifaune dans la région de la Dyle est plutôt en demi-
teinte : si le nombre d’espèces nicheuses et observées est relativement stable et si les
effectifs de certaines d’entre elles progressent (certains anatidés, grands échassiers,
rapaces), de nombreuses espèces, principalement celles des milieux agricoles ouverts et les
migrateurs au long cours sont au bord de l’extinction ou ont déjà disparu.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%