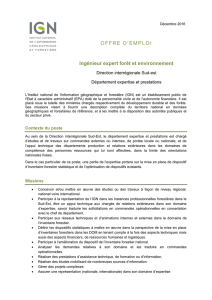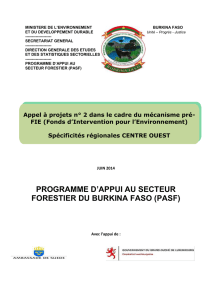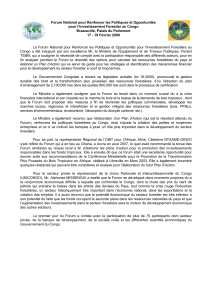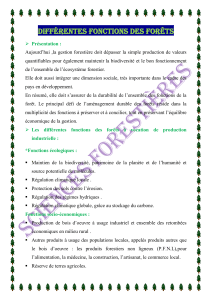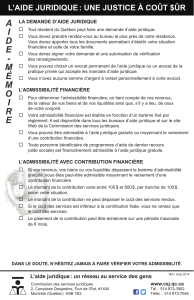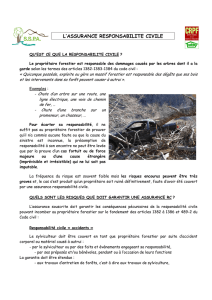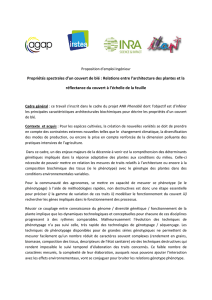Sensibilité des plantes aux perturbations de l`habitat et mesures d

Sensibilité des plantes
aux perturbations de l’habitat
et mesures d’atténuation appropriées
dans le contexte québécois
Bernard Tardif - Gildo Lavoie
Depuis l’adoption de la loi québécoise sur les espèces menacées ou vulnérables en 1989, des
efforts ont été déployés pour que la préoccupation de protéger ces espèces, qu’elles soient dési-
gnées légalement ou fassent partie de la liste officielle de celles susceptibles de l’être, soit
partagée dans la population et par les gestionnaires du territoire, notamment ceux qui ont à
autoriser des interventions. Aidés par la mise sur pied, au ministère de l’Environnement, du
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec affilié au réseau de centres de données
sur la conservation nord-américains, nous avions jusqu’à récemment donné des avis relativement
aux espèces floristiques menacées ou vulnérables sur une base
ad hoc
, principalement en regard
des différentes autorisations à émettre par le ministère de l’Environnement qui nécessitent une
évaluation environnementale (la faune relève d’un organisme indépendant, la Société de la Faune
et des Parcs).
À la suite de la tempête de verglas qui a touché le Sud du Québec en 1998, où se trouvent les
deux tiers des 375 espèces vasculaires menacées ou vulnérables (Bouchard
et al.
, 1983 et 1985 ;
Lavoie, 1992 ; Labrecque et Lavoie, 2001), l’instauration de programmes d’assistance financière
par les gouvernements canadien et québécois pour la récupération du bois en perdition par les
propriétaires de boisés ouvrait la possibilité de tenir compte de la présence des espèces
menacées ou vulnérables. Devant le volume important d’avis à émettre au ministère des
Ressources naturelles responsable de l’administration du programme, il est apparu nécessaire
d’utiliser une approche simplifiée et systématique d’analyse. Une revue de la littérature à ce sujet
a révélé que peu de développements ont été accomplis en ce sens, le travail de Robinson
et al.
(1981), qui traite de 160 espèces forestières rares du Sud-Est américain, faisant figure d’excep-
tion. De tels outils de gestion sont rares parce que fastidieux à produire. En effet, ils sont
élaborés sur une base régionale, en traitant des espèces au cas par cas, en relation avec chacune
des pratiques considérées individuellement. La méthodologie décrite dans cet article simplifie les
choses puisque des mesures tenant compte de l’ensemble des pratiques à considérer sont
obtenues rapidement, sur une base objective, pour un nombre illimité d’espèces dont la sensi-
bilité vis-à-vis des facteurs clés ayant un impact sur leur survie a été évaluée.
MÉTHODOLOGIE
La méthode est fondée sur la sensibilité relative des espèces végétales à trois facteurs écolo-
giques, ainsi que sur l’impact attendu des activités forestières sur ces trois mêmes facteurs. En
Rev. For. Fr. LVI - 3-2004 241
OUTILS ET MÉTHODES

considérant simultanément ces deux paramètres, sensibilité et impact, il devient possible de
déterminer si une mesure d’atténuation est requise, et l’intensité de cette mesure.
Facteurs écologiques
Les facteurs retenus pour rendre compte de la réaction des plantes aux perturbations occasion-
nées par les activités forestières sont le besoin en lumière, le besoin en humidité et le type
biologique. Ces facteurs permettent de définir respectivement la sensibilité des espèces à l’ou-
verture du couvert forestier, à l’altération du drainage et aux bris mécaniques. Le choix de ces
variables est en partie guidé par des considérations pratiques : les besoins en lumière et en
humidité ont été déduits des données d’habitat des espèces disponibles au Centre de données
sur le patrimoine naturel du Québec du ministère de l’Environnement (CDPNQ), alors que le type
biologique est tiré de Scoggan (1978-1979).
Espèces retenues
Le traitement porte sur 206 espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou suscep-
tibles de l’être au Québec, présentes dans l’aire considérée, pour lesquelles le Centre de données
(CDPNQ) possède au moins une occurrence suffisamment précise pour être localisée(1). Cette
sélection entraîne l’inclusion d’espèces non affectées directement par le verglas ou le prélève-
ment de matière ligneuse, puisqu’elles colonisent des milieux aquatiques, intertidaux ou terrestres
ouverts. Mais nous les avons délibérément conservées puisque leurs populations peuvent être
affectées par les activités forestières à proximité des sites visés par les interventions, notamment
en ce qui a trait à l’altération du drainage. Elles peuvent également être affectées par les acti-
vités connexes au prélèvement de la matière ligneuse telles l’aménagement des chemins et
pistes, la circulation des engins, ainsi que l’établissement d’aires de stockage.
RÉSULTATS
Sensibilité des espèces
• Ouverture du couvert forestier
Pour les fins de ce travail, le couvert forestier est constitué de l’ensemble des végétaux fournis-
sant de l’ombre aux espèces à protéger. Dans ce contexte, les plantes menacées ou vulnérables
de la zone touchée par le verglas se regroupent en quatre catégories, selon leur besoin en
lumière : sciaphile stricte, sciaphile tolérante, héliophile tolérante et héliophile stricte (tableau I).
Les espèces sciaphiles strictes atteignent leur optimum de développement dans les endroits
ombragés. Elles sont incapables de germer ou de croître en plein soleil (Gilbert, 1997). De ce fait,
elles seront éliminées dès qu’une ouverture du couvert forestier sera créée par quelque pratique
ou phénomène naturel que ce soit. Dans le contexte de la tempête de verglas, il est donc vital
pour ces espèces de préserver l’ombre résiduelle, indépendamment de la strate végétale qui la
fournit.
Par ailleurs, plusieurs autres espèces, bien que dépendant de la forêt, peuvent supporter des
variations majeures de l’intensité lumineuse. C'est le cas, entre autres, des géophytes printa-
nières accomplissant leur cycle épigé complet à la pleine lumière (Marie-Victorin, 1997). Ces
espèces, dites sciaphiles tolérantes (à la lumière), seront favorisées à brève échéance par un
242 Rev. For. Fr. LVI - 3-2004
BERNARD TARDIF - GILDO LAVOIE
(1) Leur liste est tenue, par les auteurs et la Revue, à la disposition des lecteurs intéressés.

Rev. For. Fr. LVI - 3-2004 243
Outils et méthodes
ensoleillement accru, mais incapables de se maintenir sous ces nouvelles conditions si elles
persistent, par suite de la compétition avec les espèces de milieux ouverts. Ainsi, les travaux de
récupération ayant pour objectif de rétablir le peuplement d’origine pourront favoriser ces espèces
forestières plus tolérantes à la lumière. C’est le cas également des héliophiles tolérantes (à
l’ombre), espèces adaptées aux gradients prononcés prévalant à la lisière des forêts ou qui
dépendent d’habitats créés par ces conditions, par exemple les bords de sentiers et de chemins
forestiers. Par conséquent, l’ouverture partielle du couvert forestier pourra favoriser l’expansion
de leurs populations, dans la mesure où les autres perturbations sont minimisées.
Finalement, les espèces héliophiles strictes sont les plus exigeantes en lumière et se rencontrent
dans les milieux ouverts. L’ouverture du couvert forestier n’aura donc pas d’incidence négative
directe sur elles. Cependant, il faudra tenir compte d’effets indirects tels un assèchement du
milieu causé par la baisse de la nappe phréatique.
• Altération du drainage
Les plantes menacées ou vulnérables de la zone touchée par le verglas se regroupent en quatre
catégories, selon leur besoin en humidité : aquatique, hygrophile, mésophile et xérophile
(tableau II, ci-dessous).
Les espèces ayant un besoin d’eau permanent sont parmi les plus sensibles à l’altération du
drainage. Elles comprennent les plantes hygrophiles, qui colonisent les sols saturés d’eau au
moins pendant une partie importante de leur cycle vital, ainsi que les plantes aquatiques,
présentes en eaux libres. Les plantes de ces deux catégories peuvent disparaître si l’humidité du
sol décroît par drainage ou si un assèchement superficiel résulte de la suppression partielle de
l’étage arborescent (Gilbert, 1997). Pour protéger les habitats qu’elles occupent, les travaux fores-
tiers devraient respecter les mesures énoncées dans la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (Gouvernement du Québec, 1996a). Les espèces mésophiles,
dans le territoire touché par le verglas, caractérisent l’érablière ou ses groupements de succes-
sion, là où la capacité absorbante de la matière organique confère un bon pouvoir de rétention
en eau (Dansereau, 1943). Elles tolèrent mal un excès ou un manque d’eau et les interventions
TTAABBLLEEAAUUIISSeennssiibbiilliittéé rreellaattiivvee ddeess eessppèècceess vvééggééttaalleess àà ll’’oouuvveerrttuurree dduu ccoouuvveerrtt ffoorreessttiieerr,,
sseelloonn lleeuurr bbeessooiinn eenn lluummiièèrree
Besoin en lumière Sensibilité relative
Sciaphile stricte Élevée
Sciaphile tolérante Faible à modérée
Héliophile tolérante Faible à modérée
Héliophile stricte Nulle
TTAABBLLEEAAUUIIIISSeennssiibbiilliittéé rreellaattiivvee ddeess eessppèècceess vvééggééttaalleess àà ll’’aallttéérraattiioonn dduu ddrraaiinnaaggee,,
sseelloonn lleeuurr bbeessooiinn eenn hhuummiiddiittéé
Besoin en humidité Sensibilité relative
Aquatique Élevée
Hygrophile Élevée
Mésophile Faible à modérée
Xérophile Faible à modérée

forestières dans leur habitat devraient être réalisées en réduisant au minimum l’assèchement ou
l’humidification du sol, tant par l’altération directe du drainage que par un accroissement trop
radical de l’ouverture du couvert forestier.
Quant aux espèces xérophiles, caractéristiques des lieux secs, elles seront perturbées par les acti-
vités forestières humidifiant leur habitat. La logique qui sous-tend leur protection est la même
que celle des plantes de milieux humides. Toutefois, la structure des sols des milieux xériques
est moins fragile que celle des milieux humides. Pour cette raison, les espèces xérophiles sont
considérées comme étant moins sensibles à l’altération du drainage (tableau II, p. 243).
• Bris mécaniques
Les plantes menacées ou vulnérables de la zone touchée par le verglas se regroupent en cinq
catégories, selon leur type biologique : phanérophyte, chaméphyte, hémicryptophyte, cryptophyte
et thérophyte (tableau III, ci-dessous).
Dans les milieux lourdement perturbés, seules les plantes annuelles (ou thérophytes) pourront
survivre, par le biais de leur banque de graines (tableau III). La sensibilité aux bris mécaniques
des autres espèces, toutes vivaces, dépend de la localisation des bourgeons permettant aux indi-
244 Rev. For. Fr. LVI - 3-2004
BERNARD TARDIF - GILDO LAVOIE
TTAABBLLEEAAUUIIVVRReeggrroouuppeemmeenntt ddeess 220066 eessppèècceess vvééggééttaalleess mmeennaaccééeess oouu vvuullnnéérraabblleess sseelloonn lleeuurr sseennssiibbiilliittéé
àà ll’’oouuvveerrttuurree dduu ccoouuvveerrtt ffoorreessttiieerr,, àà ll’’aallttéérraattiioonn dduu ddrraaiinnaaggee eett aauuxx bbrriiss mmééccaanniiqquueess(1)
Ouverture Altération Bris mécaniques Nombre %
du couvert forestier du drainage d’espèces d’espèces
E E E 1 0,5
E E I 1 0,5
EIE20
37 9,7
E I I 15 7,3
I E E 7 3,4
I E I 12 5,8
I E N 4 1,9
IIE35
74 17,0
I I I 13 6,3
I I N 3 1,5
N E E 14 6,8
N E I 28 13,6
N E N 10 4,9
NIE28
95 13,6
N I I 5 2,4
N I N 10 4,9
(1) E : sensibilité élevée ; I : sensibilité faible à modérée ; N : sensibilité nulle.
TTAABBLLEEAAUUIIIIIISSeennssiibbiilliittéé rreellaattiivvee ddeess eessppèècceess vvééggééttaalleess aauuxx bbrriiss mmééccaanniiqquueess,,
sseelloonn lleeuurr ttyyppee bbiioollooggiiqquuee
Type biologique Sensibilité relative Définition
Phanérophyte Élevée Bourgeons portés à plus de 25 cm de hauteur
Chaméphyte Élevée Bourgeons portés à moins de 25 cm de hauteur
Hémicryptophyte Élevée Bourgeons situés au niveau de la surface du sol
Cryptophyte Faible à modérée Bourgeons portés par des organes souterrains
Thérophyte Nulle Plante annuelle

vidus de se régénérer. Les cryptophytes (ou géophytes), plantes dont les bourgeons sont enfouis
dans le sol, sont moins sensibles que les autres espèces vivaces. Elles seront peu affectées par
des interventions modérées (coupes partielles), particulièrement si elles sont effectuées à un
autre moment que durant la saison de croissance. Les chaméphytes et hémicryptophytes, pour
leur part, passent facilement inaperçues parmi les débris végétaux en raison de leur faible taille
ou de leur port prostré. Elles seront donc particulièrement vulnérables aux interventions en sous-
bois. Finalement, la sensibilité des phanérophytes dépend de leur degré de développement. Les
arbres et arbustes à l’état adulte peuvent tolérer les assauts mécaniques, dans la mesure où ils
ne sont pas visés directement par les opérations forestières. Toutefois, les jeunes individus et
les arbrisseaux sont tout aussi vulnérables que les hémicryptophytes et les chaméphytes, ce qui
explique la sensibilité relative élevée des phanérophytes (tableau III, p. 244).
• Regroupement des espèces selon leur sensibilité
Les 206 espèces menacées ou vulnérables ont été regroupées en fonction de leur sensibilité
relative aux trois facteurs écologiques. Ceci produit 16 catégories d’espèces qui se distinguent par
leur sensibilité aux perturbations occasionnées par les activités forestières (tableau IV, p. 244).
Impact des activités forestières
Les activités forestières considérées sont fondées sur celles énumérées par Hunter (1990), le
Gouvernement du Québec (1996b) et Huot (1996). Celles ayant des impacts similaires ont été
regroupées pour simplifier. C’est le cas lorsque, tout en ayant des objectifs identiques, elles ne
se distinguent que par l’intensité des altérations écologiques produites : chemin principal ou
piste de débardage par exemple, ou encore coupe de récupération partielle et coupe de récupé-
ration totale.
Pour chacune des catégories d’activités, énumérées et décrites au tableau V (p. 246), une valeur
relative d’impact a été attribuée à chacun des trois facteurs écologiques. Dans tous les cas où
des ambiguïtés se sont présentées, nous avons adopté un principe de précaution et retenu la
valeur d’impact la plus élevée.
Mesures d’atténuation
L’annexe 1 (pp. 248 à 250) présente les mesures d’atténuation pour chacune des catégories d’es-
pèces rencontrées. Dans tous les cas, l’intensité des mesures est obtenue à partir d’une table de
contingence à double entrée, construite selon les valeurs relatives de sensibilité et d’impact
(tableau VI, p. 246).
Dans les cas où des mesures d’atténuation sont requises, qu’elles soient destinées à empêcher
ou atténuer l’intervention forestière, elles sont rédigées à partir des informations fournies à la
section traitant de la sensibilité des espèces. Par exemple, la récolte des arbres n’est pas souhai-
table dans l’habitat d’une sciaphile stricte puisqu’il s’agit là d’une catégorie d’espèces ayant une
sensibilité élevée à l’ouverture du couvert forestier, visée par une intervention ayant un impact
élevé sur ce même facteur. Empêcher l’intervention permet de préserver l’ombre résiduelle, vitale
pour les espèces de cette catégorie.
Dans une situation donnée, l’action favorisant au mieux le maintien ou le rétablissement des
populations d’espèces menacées ou vulnérables est celle qui tient compte des trois facteurs
simultanément. C’est donc l’addition des mesures destinées à chacun des trois facteurs, qui
constitue, en pratique, la recommandation finale à intégrer à un plan de récupération du bois en
perdition ou à un plan de restauration d’un jeune peuplement.
Rev. For. Fr. LVI - 3-2004 245
Outils et méthodes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%