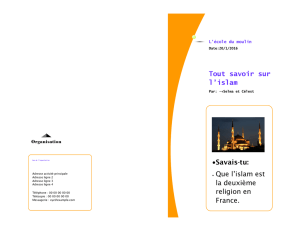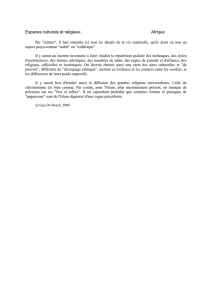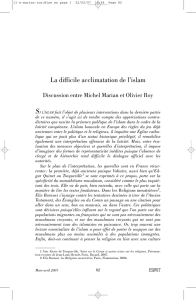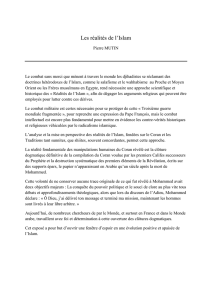Les trois monothéismes - Juifs, Chrétiens, Musulmans

#8FGEB<F
@BABG;S<F@8F


Daniel Sibony
#8FGEB<F
@BABG;S<F@8F
!H<9F;ESG<8AF$HFH?@4AF
8AGE8?8HEFFBHE68F
8G?8HEF78FG<AF
Éditions du Seuil

#4CESF8AG8S7<G<BA4SGS8AG<TE8@8AGE8IH8
C4E?h4HG8HE8G4H:@8AGS87hHA8CBFG9468<AS7<G8
*%
*%
S7<G<BA5EB6;S8
] O7<G<BAF7H*8H<?@4EF 8G=H<A
#8 B78 78 ?4 CEBCE<SGS <AG8??86GH8??8 <AG8E7<G ?8F 6BC<8F BH E8CEB7H6G<BAF 78FG<AS8F P HA8
HG<?<F4G<BA6B??86G<I8+BHG8E8CESF8AG4G<BABHE8CEB7H6G<BA<AGS:E4?8BHC4EG<8??894<G8C4EDH8?DH8CEB
6S7SDH868FB<GF4AF?86BAF8AG8@8AG78?h4HG8HEBH78F8F4L4AGF64HF88FG<??<6<G88G6BAFG<GH8HA8
6BAGE894RBAF4A6G<BAAS8C4E?8F4EG<6?8F#8GFH<I4AGF7HB7878?4CEBCE<SGS<AG8??86GH8??8

AGEB7H6G<BA
#hS@BG<BAF4<F<G?8@BA78beaucoup de monde4HKSISA8
@8AGFBZ?hBE<:<A88FG8ADH8FG<BA
#8F6E<F8F6B@@868??8F7HMoyen-Orient S@8HI8AG5<8A
C?HFDH87h4HGE8FC?HFDH8?h9E<DH8BH?8'SEBH`?8HE
<@C46G8FGC?4ASG4<E8B@@8F<4H78?P7HCSGEB?8<?L4I4<G?8
64E5HE4AG7hHA8@46;<A8E<86BF@<DH8G8EE8FGE88G6S?8FG8CBE
GS8C4EGEB<F@BABG;S<F@8Fd =H<96;ESG<8A8G<F?4@<DH8 dDH<
Fh^ 466EB6;8AG _F8:UA8AGFh4GG8<:A8AGF86EB<F8AGFBHF?8
F<:A87H7<I<A8G78?4@S@B<E878?h<78AG<GS8G78F4C8EG8
(H8?DH8FCB<AGF5E[?4AGF '4?8FG<A8!SEHF4?8@@BHI8@8AGF
8G OG4GF <AGS:E<FG8F <@@<:E4G<BA KSABC;B5<8 d ;4<A8 78
?h4HGE88G;4<A878FB<@U?S8F+BH=BHEFSCE8HI878?hBE<:<A8
d DH<78^ ?P54F _F8ESC8E6HG8<6<CH<FES4:<G?P54F`+8A
F<BA8EE4AG8IBL4:87hHA87S6;<EHE8#hS@<:E4G<BA@U?8C4E
GBHG8A&66<78AG78F6B??86G<9F6;ESG<8AF=H<9F8G@HFH?@4AF
d ?4X6F4HFF< 68HK6<E8:4E78AG4I86FGHC8HE68F499EBAG8
@8AGF7hHA4HGE8Q:8DH<CBHEG4AG?8FGBH6;8AG78CETF?8F
4A:B<FF8AGh4HG4AGDHh<6<BA^ <AGT:E8 _ 8G6h8FG=HFG8@8AG
DH4A7R4Fh<AGT:E8DH878F^ ;<FGB<E8F _FHE:<FF8AG64E4?BEF?8
7<99SE8AGFh4CCEB6;87H@U@88G?h<ADH<TG8IBL8M6894@8HK
^ IB<?8 _ G4AGDHh<?E8FG4<G4HKFBH>F74AFF8FDH4EG<8EFE<8A
PE87<E8BHF<C8H 6h8FGDH4A7<?8FG8AGES8A6?4FF8DH868?44
94<G 78F 9E<FFBAF ? L 4 4HFF< ?h8998G<AI8EF8 BZ ?8 @U@8
78I<8AG7<99SE8AG(H<C8HGGE4;<EFBABE<:<A8<@CHAS@8AG
#hS6E<I4<A)HF;7<88A8FG?864F?<@<G8 DH4A7<?E8I<8AG8A
G4AG DHh4HGE8 FHE FBA BE<:<A8 8G DHh<? ?4 6;4GBH<??8 78 F4
C?H@86h8FG?h8KC?BF<BA#H<DH<S6E<GP#BA7E8F<EE<G8?h E4A8G
Fh8AG8EE8 CBHE E8FG8E I<I4AG` 8A &66<78AG (H4A7 C4E
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%