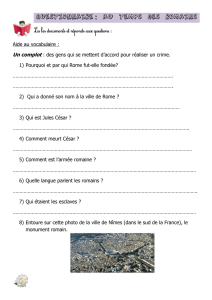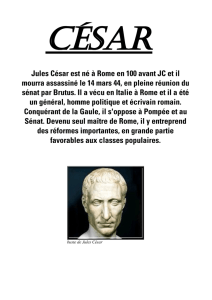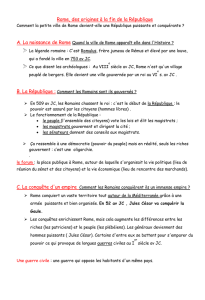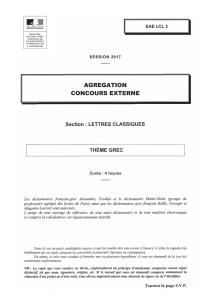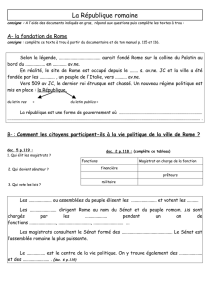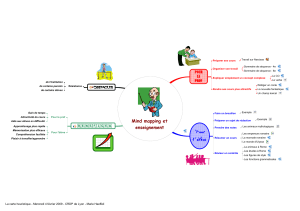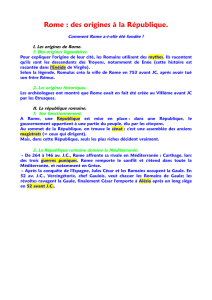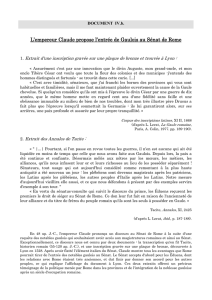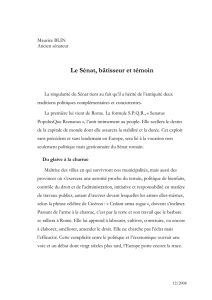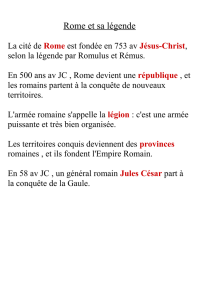Rome - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE UNIVERSELLE
Rome (de 754 à 63 av. J.-C.)
Par Marius Fontane

CHAPITRE PREMIER
Marche rétrograde des Aryens. - Philippe et Alexandre. - Athènes et Rome. - La péninsule italique.
- La mer et les îles. - Italiotes et émigrants. - La Sicile. - Le Tibre. - Première Rome. - Pélasges,
Hellènes, Sicanes, Ligures, Celtes et Étrusques. - Autochtones. La Rome légendaire. - Premiers
Romains. - L’enlèvement des Sabines. - Destinée de Rome
CHAPITRE II
De 754 à 578 av. J.-C. - Les premiers rois. - Janus. - Hercule et le brigand Cacus. - Énée et
Ascagne. - Numitor et Amulius. - Romulus et Remus. - Fondation de Rome. - Numa Pompilius. -
Tullus Hostilius, ou Tullius. - Destruction d’Albe. - Ancus Martius. - Tarquin l’Ancien (Démarate). -
La Rome carrée. - Servius. - La cité
CHAPITRE III
De 1500 à 300 av. J.-C. - L’Étrurie.- Ligures et Sicules. - Celtes, Latins, Opiques, Osques. -
Sabelliens et Samnites. - Iapygiens, Italiotes et Etrusques. - L’exode aryen. - Venue des Étrusques.
- Confédération. - Trafics. - Architecture. - Bijoux. - Sculpture. - Céramique. - Industrie. - Famille.
- Religion. - Divinités. - Culte. - Type. - Histoire. - Influences asiatique et hellénique. - Peinture. -
Caractère
CHAPITRE IV
De 598 à 491 av. J.-C. - Servius Tullius. - Tarquin le Superbe. - Les livres sibyllins.- Julius Brutus
et Tarquin Collatin, consuls. - Valerius, vainqueur des Étrusques. - Bataille de Régille. - Les
dioscures. - La République. - Gouvernement de Rome. - Lutte entre les patriciens et les plébéiens.
- Dictature.- Appius Claudius et Valerius. - Les tribuns. - La loi agraire. - Spirius Cassius, victime
du Sénat. - Les Fabius. - Publilius Valero. - Loi Publilia. - Ennemis des Romains. - Coriolan chez les
Volsques
CHAPITRE V
De 491 à 450 av. J.-C. - Coriolan marche sur Rome. - Sa retraite inespérée. - Èques et Véiens
contre Rome. -Trêve de Manlius Vulso. -Victoires de Quinctius. - Dictature de Posthumius. - Rome
menacée. - La peste. Cincinnatus dictateur. -Ténacité des plébéiens. - Conquête de l’égalité. - La
justice. - Quinctius Céson. - Herdonius au Capitole. - Retour de Cincinnatus. - Rome disloquée. -
Les plébéiens sur l’Aventin. - La loi Terentilla
CHAPITRE VI
De 450 à 448 av. J.-C. - Lois nécessaires. - Commissaires romains en Hellénie. - Le Droit
hellénique. - Suspension de la Constitution romaine. - Premiers décemvirs. -Les dix tables. -
Influences grecque et mosaïque. - Seconds décemvirs. - Appius Claudius.- Les douze tables. -
Patriciens et plébéiens. – Le droit romain. – Tyrannie des décemvirs. - Hostilités des Sabins et des
Èques. - Assassinat de Dentatus et meurtre de Virginie. - Abdication des décemvirs
CHAPITRE VII
De 448 à 376 av. J.-C. - Valerius et Horatius traitent avec le peuple révolté. - Vengeances. - Èques
et Sabins défaits. - Défense du patriciat. - Les censeurs. - Invasion repoussée des Volsques. - Mort
de Spurius Mœlius. - Cincinnatus dictateur. - L’armée. - Tribuns et plébéiens.- Assassinat de
Posthumius. - Victoires de Rome. -Camille.-Invasion des Gaulois. - Destruction de la Rome antique.
- Intervention des prêtres. - Rome rebâtie. - Réformes militaires. - Le Latium pacifié

CHAPITRE VIII
De 390 à 280 av. J.-C. - La nouvelle Rome. - Réclamations plébéiennes. - La question agraire. -
Fléaux. - Introduction des jeux étrusques. - Latins et Gaulois. - Guerre des Samnites. - Révolte de
légions. - Fabius et Appius. - Étrusques et Gallo-Samnites. - Le peuple sur le Janicule. -
Confirmation des conquêtes plébéiennes. - Villes italiennes. - Derniers efforts des Etrusques et des
Serions. - Agitation en Grande-Grèce. - Les Tarentins appellent Pyrrhus
CHAPITRE IX
De 336 à 323 av. J.-C. - Alexandre, roi de Macédoine. - Destruction de Thèbes. - L’empire perse. -
L’Égypte.- Alexandre en Asie Mineure. - Bataille d’Issus. - Prise de Tyr. - Fondation d’Alexandrie. -
L’Égypte macédonienne. - Bataille de Gaugamèle et d’Arbèles. - Fuite de Darius. - Révolte de
Sparte. - Antipater. - Fin des Grecs. - Alexandre dans l’Inde. - Taxile et Porus. - Retraite des
Macédoniens. - Alexandre à Babylone, dieu ; sa mort
CHAPITRE X
De 323 à 278 av. J.-C. - La succession d’Alexandre. - Arrhidée. - Troubles sanglants à Babylone. -
Perdiccas et Méléagre. - Partage de l’empire. - Pithon et Eumène. - Ptolémée, Antipater et
Séleucus. - Destruction de la famille d’Alexandre. - Cassandre. - Démétrius de Phalère à Athènes. -
Antigone. - Séleucus et Ptolémée. - Paix. - Alexandre le Grand et son oeuvre
CHAPITRE XI
De 336 à 272 av. J.-C. - Fin de la Grèce. - Démosthène et Alexandre. - Phocion et Démade. -
Lycurgue. - Sparte contre les Macédoniens. - Eschine et Démosthène le Procès de la Couronne. -
Arpale à Athènes. - Condamnation et mort de Démosthène. - Guerre lamiaque. - Mort de Phocion. -
Invasion de Gaulois. - Pyrrhus, roi d’Épire. - Les Épirotes. - Pyrrhus en Italie et en Sicile. -
Triomphe de Curius Dentatus. - Mort de Pyrrhus
CHAPITRE XII
De 272 à 264 av. J.-C. - Rome condamnée à la guerre. - La Sicile et Carthage. - L’Italie domptée. -
Fin de l’Étrurie. - Le nord de l’Afrique : la Cyrénaïque, la vallée du Catabathmon, la Numidie, la
Mauritanie. - Libyens et Carthaginois. - Marseille, Corse et Sardaigne. - L’Atlantique. - Îles
Britanniques et côte occidentale d’Afrique. - Magon, Asdrubal et Amilcar
CHAPITRE XII (Suite)
La nouvelle Carthage : Gouvernement, moeurs, divinités, arts, commerce, armée. - La nouvelle
Rome, Politique, municipes, colonies, voies militaires, gouvernement, armée. - Rome, Carthage et
la mer Méditerranée. - L’Afrique
CHAPITRE XIII
De 265 à 240 av. J -C. - Première guerre punique. - Hostilités en Sicile. - Hiéron et Hannon. - Les
Hannon et les Barca. - Première flotte romaine. - Succès de Duillius. - Amilcar en Sicile. - Bataille
navale d’Ecnome. - Romains en Afrique. - Carthage, irréconciliable ennemie. - Claudius. - L’armée
d’Amilcar. - Paix entre Rome et Carthage

CHAPITRE XIV
De 241 à 201 av. J.-C. - Soulèvement de la Gaule cisalpine. - L’Illyrie et la Macédoine. -
Mercenaires de Carthage. - Amilcar. - Asdrubal en Espagne. - Annibal passe les Alpes. - Bataille de
la Trébie. - Désastre de Cannes. - Rome toute armée. - Défection de Capoue. - Philippe de
Macédoine. - Mort d’Hiéron. - Siège de Syracuse. - Archimède. - Annibal devant Rome. - Mort
d’Asdrubal. - Publius Scipion en Espagne. - Deuxième guerre punique. - Scipion l’Africain. - Rome
éblouie
CHAPITRE XV
La Grande-Grèce. - Peuplement de l’Italie du sud. - Grecs et Italiotes. - Influence d’Athènes. -
Socrate et Platon. - Pythagore. - Aristote. - Rhéteurs et grammairiens. - Épicure et Hégésias. - La
Médecine. - Héroricos et Hippocrate. - Eudoxe. - Astronomie. - Sciences mathématiques et
physiques. - Géographie
CHAPITRE XVI
De 323 à 117 av. J.-C. - Dispersion des Hellènes à Rhodes, Pergame, Éphèse, Smyrne et
Alexandrie. - Grecs et Juifs à Alexandrie et en Palestine. - Les hellénistes d’Égypte. - Les
Ptolémées. - Trafics et Monnaie. - Administration. - Philosophie : Théophraste et les platoniciens. -
Culte et Divinités. - Néo-Juifs. - Sculpture. - Architecture. - Peinture. - Littérature. - Le Musée. -
Poètes. - Callimaque, Apollonius et Théocrite. - Histoire. - Théâtre
CHAPITRE XVII
De 281 à 189 av. J.-C. - L’Orient attire le Sénat. - L’Asie. - Le royaume des Séleucides. - Derniers
efforts des Grecs. - Achéens et Étoliens. - Aratus. - Cléomène. - Situation de Rome. - Antiochus. -
Philippe V, de Macédoine. - Guerre déclarée à la Macédoine. - T. Quintius Flamininus. - Bataille de
Cynocéphales. - La Grèce libre. - Annibal chez Antiochus. - Antiochus chassé de Grèce. - Lucius
Scipion. - Manlius Vulso. - Les Galates. - Eumène répond de l’Asie. - Fin des Grecs
CHAPITRE XVIII
De 198 à 133 av. J.-C. - Ibères et Celtibères. - Soumission de la Cisalpine et de l’Istrie. - Mort de
Philopœmen, d’Annibal et de Philippe. - Persée. - Bataille de Pydna. - La Macédoine, l’Illyrie, l’Epire
et la Grèce succombent. - Triomphe de Paul Émile. - Andriscos et Metellus. - Pillage de Corinthe. -
La Grèce, province romaine : Achaïe. - Destruction de Carthage. - Asdrubal et Scipion Émilien. -
L’Afrique, province romaine. - L’Espagne soulevée. - Viriathe. - Reddition de Numance. Le
Royaume de Pergame. - Les Attalides. - Province d’Asie. - L’Empire romain
CHAPITRE XIX
Romains. - Influence hellénique. - La Grande-Grèce. - Grækes et Italiotes. - Littérature. - Poésie. -
Névius, Andronicus, Ennius. - La langue latine. Le théâtre à Rome. - Les édiles. - Plaute. - Térence.
- Les spectateurs. - Acteurs et machineries. - Les gladiateurs. - Philosophes et philosophie
CHAPITRE XX
Première Rome. - Organisation sociale. Patrons et gentes. - Prolétaires. - Le gouvernement. -
Tribus. - Provinces. - Le Tribunat. - Veto et plébiscite. - La politique du Sénat. - Le peuple. -
Campagnards et marins. - Esclaves et affranchis. - Gladiateurs. - Patrons et clients. - Sénat et
peuple. - Bourgeoisie. - Forum. - Justice

CHAPITRE XXI
Finances romaines.- Fausse monnaie. - Banquiers. - Manieurs d’argent et usuriers. - Commerce et
marine. - Accapareurs. - Industrie. - Agriculture. - Misère générale. - Délateurs. - L’armée. -
Recrutement. - Infanterie et cavalerie. - Science militaire. - Subsistances. - Généraux et soldats. -
Corruption universelle. - Indifférence. - La Rome nouvelle
CHAPITRE XXII
De 195 à 121 av. J.-C. - Caton le Réformateur. - Scipion Émilien. - Les stoïciens. - Révolte des
esclaves en Sicile. - Eunus le Syrien. - La Loi agraire. Tiberius Gracchus. - Les triumvirs. - Scipion
Nasica. - Carbon, tribun. - Caïus Gracchus. - Réformes révolutionnaires. - Le Sénat contre Caïus. -
Livius Drusus l’emporte. - Opimius, consul. - La noblesse a triomphé des Gracques. - La plèbe et la
soldatesque
CHAPITRE XXIII
De 121 à 110 av. J.-C. - Inquiétude des Grands. - Scandales. - Le Royaume des Numides. -
Micipsa, Adherbal et Hiempsal. - Jugurtha. - Guerre de Numidie. - La corruption romaine. - Cécilius
Metellus. - Les Gétules. - Marius. - Bocchus. - Rome triomphante. - La nouvelle Province. - Aix et
Narbonne
CHAPITRE XXIV
De 110 à 99 av. J.-C. - Invasion des Cimbres et des Teutons. - Helvètes. - La Gaule et les Gaulois.
- Celtes. - Cimmériens du Bosphore. - Scythes et Thraces.- Galates. - Marius en Gaule. - Défaite
des Teutons. - Les Cimbres en Italie. - Nouvelle victoire de Marius. - Deuxième révolte des
esclaves. - Marius et Sylla
CHAPITRE XXV
De 103 à 88 av. J.-C.- Marius à Rome. Incapacité et vénalité de la noblesse. - Le Parti populaire. -
La Guerre au Sénat. - Troubles et réaction. - Saturninus. - Les Italiens. - Guerre sociale. -
L’anarchie légale. - Confédération italienne. - Intervention et retraite de Marius. - Fausses
concessions aux Italiens. - Mithridate. - Marius et Sylla. - La Terreur à Rome
CHAPITRE XXVI
De 92 à 78 av. J.-C. - L’Asie romaine. - Mithridate, roi de Pont. - Tigrane. - Bithynie et Cappadoce.
- Victoires et défaite de Mithridate. - Flaccus et Fimbria. - Carbon et Marius le jeune. - Sylla
traverse Rome. - Soulèvement des Italiens, de l’Espagne et de l’Afrique. - Sylla maître de Rome. -
Vengeances et réformes. - Mort de Sylla
CHAPITRE XXVII
De 81 à 63 av. J.-C. - Les consuls Lepidus et Catulus. - Sertorius en Espagne. - Perpenna. -
Pompée. - Émeute des gladiateurs. - Spartacus. - L’héritage de Sylla. - Débuts de Cicéron. -
L’anarchie à Rome. - Les pirates. - Dictature de Pompée. - Mithridate et Tigrane d’Arménie. -
Victoires de Lucullus. - Pompée en Asie. - Fin de Lucullus. - Pompée en Judée. - Les Juifs et les
Hellènes en Palestine. - Les Macchabées. - Pompée à Jérusalem. - Mort de Mithridate. - L’Asie
romaine
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
1
/
199
100%