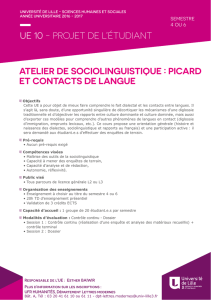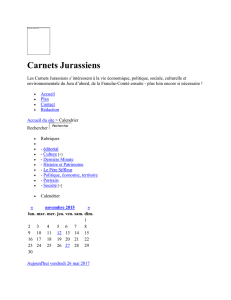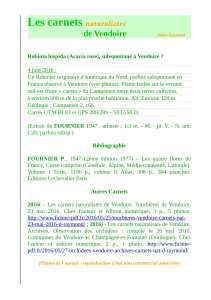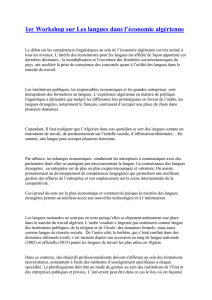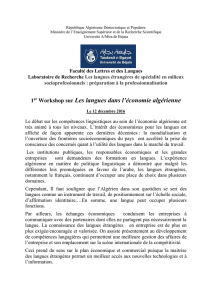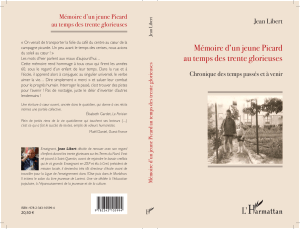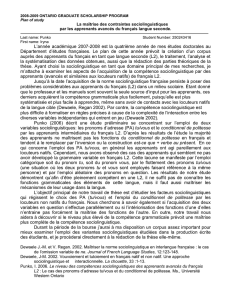ou : L`avantage d`être né sur le continent au

3
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 2
Mis languages est bons, car en France fui nez
ou : L’avantage d’être né sur le continent au
XIIème s.
Jacques Chaurand
Université Paris 13
Avant d’avoir écrit cette phrase (La vie de Saint Thomas Becket, v.
6165) où la fierté n’est pas absente, Guernes s’était donné à connaitre :
Guernes li clers del Punt fine ici sun sermon
Del martir saint Thomas et de sa passiun (v. 6156-6157).
Et il avait dit précédemment :
Guernes li clers, del punt sainte Messence nez (v. 5877).
Une contemporaine, que l’histoire littéraire médiévale connait sous le
nom de Marie de France, avait avec plus de discrétion renseigné ses
lecteurs sur ses origines :
Marie ai nom, si sui de France.
France a été interprété comme s’il s’agissait de l’Ile-de-France. De
même la fière proclamation de Guernes a été mise en rapport avec la
situation de Pont-Sainte-Maxence aux confins de l’Ile-de-France et de la
Picardie. Il aurait été plus exact de dire « avec ce qui deviendra l’Ile-de-
France et la Picardie », car le nom de Picardie n’est pas encore né au
XIIème s. et celui d’Ile-de-France n’est attesté qu’au XIVème s. Il est
impossible de dessiner sur la carte les confins auxquels il est fait
allusion. Les tendances dialectales sont antérieures au découpage

J. Chaurand
4
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 2
historique qui nous est devenu familier et que nous utilisons par
commodité pour les désigner. En raison d’une interprétation abusive de
sa proclamation, Guernes a été considéré comme un représentant du
« francien », dialecte fantôme né de la conjonction de réflexions sur un
état postérieur de la langue et de la sensibilité des romanistes français de
la fin du XIXème s. à une situation historique, celle de la période qui a
suivi la guerre de 1870.
Ce que dit et ce que ne dit pas le meilleur manuscrit
La conclusion du chapitre d’introduction consacré à la langue par
Emmanuel Walberg, éditeur de l’œuvre, est la suivante :
« … la langue de Guernes de Pont-Sainte-Maxence n’offre
que peu de traits dialectaux. C’est la langue de l’Ile-de-
France, avec, par-ci par-là, une légère teinte d’anglo-
normandisme, souvenir du séjour prolongé que l’auteur fit en
Angleterre où l’on sait que son poème fut composé. Les
rares ‘picardismes’ que nous avons relevés ne sont que très
naturels, vu que la ville natale du poète est située à bien peu
de distance des confins de la Picardie » (cité dans Gilles
Roques Les régionalismes dans la vie de saint Thomas
Becket).
Quelques nuances sont toutefois à apporter ; le ms B, retenu comme
ms de base, a été considéré comme le meilleur et les raisons invoquées
sont les suivantes : le caractère anglo-normand de son texte n’est pas
trop accentué ; les règles de la déclinaison y sont relativement bien
observées et les vers irréguliers du point de vue de la métrique ne sont
pas très nombreux (Introduction de l’édition Minor p. XV). Les mss C et
D sont déclarés « inutiles pour l’établissement du texte » : ils sont
« remplis d’anglo-normandismes et de fautes de toute espèce ». Ainsi la
proportion d’anglo-normandismes est déterminante pour juger de la
qualité du manuscrit, et le dialecte de l’Ile-de-France qui en fait n’est pas
représenté dans la littérature de l’époque, semble être regardé comme le
modèle dont l’écrivain soucieux de bien écrire doit ne pas s’écarter,
tandis que l’anglo-normand est la tare à éviter.

J. Chaurand
5
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 2
Le meilleur manuscrit, qui provenait de la Bibliothèque du duc de
Brunswick (B), était malheureusement lacunaire. Il y manquait les vers
1-1080 et 1231-1440. Le manuscrit a donc été complété grâce
essentiellement au ms H de Londres son contemporain (début du
XIIIème s.). Nous devons à ce rhabillage de lire dans les passages
réajustés des traits anglo-normands ou de l’ouest que nous ne retrouvons
pas dans la suite du texte. Le démonstratif neutre, qui a régulièrement la
forme ceo, courante en anglo-normand, jusqu’au v. 1080, s’écrit ço aux
v. 1085 et 1087 et dans la suite du texte. Le développement d’un son
vélaire entre aet ndans la 1ère moitié du XIIIème s., donc à l’époque de la
copie, est une caractéristique de l’anglo-normand que nous trouvons
seulement au début du texte :
Chamberleng ne sergaunt, seneschal ne garçun,
Nul ki taunt limgement servist en sa maison (v. 337-338)1.
E. Walberg déclare « probablement inauthentique » ( ?) la strophe
336-340 qui figure dans P seul, mais d’autres exemples du même trait se
retrouvent dans les variantes des autres mss, soit celles de P (522
komaundise, 971 saunz fin ; 1039 taunt), soit celles de PW (527 graunté,
1455 dous aunz). « Jeune » se dit joefne au v. 201, mais nous avons
joevenes au v. 1653 (joevenes e chenuz), tandis que les exemples relevés
du v. 4614 au v. 5278, et qui s’appliquent au jeune roi, ont toujours la
forme jovene2. Nous avons toutefois saint Estiefne au v. 1549. Des
formes spécifiques de l’Ouest comme reddes (v. 3083) ou reddement (v.
553) sont cependant fournies par l’ensemble de la tradition manuscrite3.
E. Walberg se fondait sur les critères phonétiques et morphologiques
pour déterminer le dialecte auquel se rattachait l’œuvre. Il invoquait en
particulier les rimes qui devaient lui fournir des indices sûrs : il procédait
en cela comme le faisaient habituellement les éditeurs de texte à son
époque (la première édition, dite édition major, date de 1922). La rime
garantissait en effet avec une certaine probabilité l’accès à ce qu’avait
écrit l’auteur lui-même, alors qu’à l’intérieur du vers le copiste avait plus
de liberté pour intervenir. Ainsi relève-t-on des rimes en al de alatin
1C’est nous qui soulignons.
2Voir NazirovićM., 1980, Le vocabulaire de deux versions du Roman de Thèbes,
Clermont-Ferrand, 103.
3Ibid. p.142 dans P seul mais d’autres ex. du même trait.

J. Chaurand
6
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 2
accentué + l, ex. al au lieu de el « autre chose » v. 571 et suiv. ; an et en
sont distincts sauf exception ; fere « fière » rime avec emperere (v.
2624-2625) ; la voyelle suivie de l’affriquée zne rime pas avec celle qui
est suivie par la sifflante s.
Toutefois quand l’éditeur nous dit que l’indicatif imparfait de la 1ère
conjugaison est en –eit (p. XIX) sa constatation ne vaut que pour les
formes à la rime ; à l’intérieur du vers nous trouvons des formes en –ot
et en –out (du latin -abat). Ex. :
Le meilleur vin usout que il trover poeit,
[…] Et gingibre e girofre a puignies mangeit (v. 3916 et
3919)4.
Nous aboutissons à une bigarrure morphologique, pour nous assez
étrange, mais qui ne devait pas désarçonner des lecteurs habitués à
rencontrer deux paradigmes de même valeur temporelle.
Autre méthode, autres résultats. Les mots effectivement employés par
le poète et relevés dans son œuvre sont pour Gilles Roques, les témoins
qui autorisent le rattachement de son texte à une région. Sa conclusion
est bien différente de celle d’E. Walberg, qui était trop modeste quand il
n’apercevait que « çà et là » des anglo-normandismes :
« Le vocabulaire de Guernes présente les caractéristiques des
bons textes anglo-normands de la seconde moitié du
XIIème s., c’est-à-dire qu’il ne se distingue que fort peu de
celui des textes de l’Ouest du continent à la même époque
[…]. Sa langue, bien qu’il fût né à Pont-Sainte-Maxence, ne
peut nullement passer pour celle de l’Ile-de-France. La
France dont il se réclame est la même que celle de Marie ; ils
veulent l’un comme l’autre dire : ‘Nous sommes natifs du
continent par opposition aux natifs de l’Angleterre’ ».
Il est difficile de ne pas souscrire à ces paroles et de ne pas
reconnaitre que la qualité de la langue dont le poète se prévaut tient à ce
qu’il a écrit un de ces « bons textes anglo-normands ». Pour ma part
4C’est nous qui soulignons.

J. Chaurand
7
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique 2007 n° 2
j’irais jusqu’à dire « un des plus beaux textes écrits en ancien français ».
Quant à l’espace désigné par le nom France, au Moyen Age, celui
qu’emploie Guernes, il est à géométrie variable - la variabilité ayant
évidemment ses limites - suivant les écrivains et suivant leur contexte.
Une opposition est sous-jacente ; l’un des deux termes est exprimé, mais
l’objet désigné reste vague, tandis que le terme infériorisé ne fait
qu’affleurer à l’esprit à la faveur du contraste : continent/insulaires. Il
faut avoir beaucoup d’assurance pour ne pas craindre d’offenser
l’auditoire mais il semble possible de gagner sa complicité. Reprenant
l’expression célèbre qui figure dans la chanson de Roland, le
Soissonnais Gautier de Coinci parle du païs de douce France qu’il
oppose à Tolède, ville d’Espagne devenue païenne depuis l’invasion
arabe (I, Mir., 11, v. 2052) : Gautier est alors prieur d’une communauté
de moniales qui se trouve à Vic-sur-Aisne, et ce lieu n’est pas très
éloigné de Pont-Sainte-Maxence. Il y a lieu d’examiner la charge
d’affectivité qui accompagne la mention plutôt que de chercher à tracer
des frontières d’après une réalité qui échappe à la géographie mentale.
Il est évident que Guernes en écrivant son poème se souciait moins
des habitants de sa ville natale que des pèlerins visitant à l’abbaye de
Canterbury le tombeau du martyr, et qui constituaient le public auquel il
s’adressait. Dans le feu de l’action se souciait-il le moins du monde des
habitants de sa ville natale ? Le travail conscient sur la langue de ce
texte, que le lecteur sent très travaillé, traduit un effort en vue de
partager son émotion et de faire admirer son héros devant un public pour
qui le français d’Angleterre était familier. Les traits « anglo-normands »
ne sont pas du tout des repoussoirs comme semble les considérer E.
Walberg mais ils appartiennent à une langue littéraire qui a ici et à cette
époque, son prestige, et qui ne se distingue pas fondamentalement de
celle de l’ouest du continent. Quant aux picardismes, échappent-ils à ce
travail conscient qui doit favoriser l’échange entre les habitants des deux
rives de la Manche ? Nous reviendrons sur cette question.
Parti pris de l’oralité
Le texte a été écrit en Angleterre de 1171 à 1174 (Introduction p. V) ;
le public auquel il était destiné était certainement dans sa grande
majorité insulaire ; les sources sont pour une bonne partie orales et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%