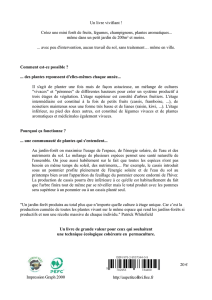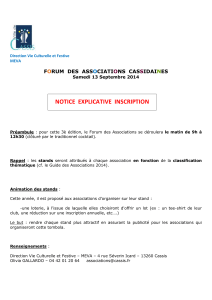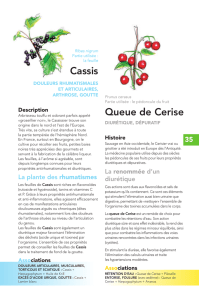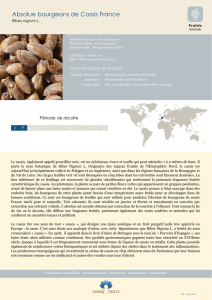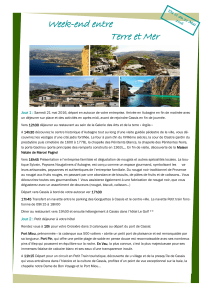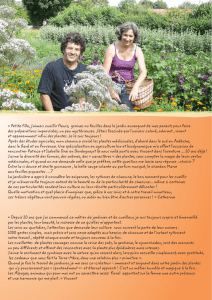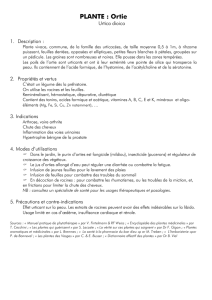30 PLANTES UTILES

Paul-Victor Fournier
30 PLANTES UTILES
Herbes, arbres, plantes alimentaires :
leur histoire, leurs vertus
Introduction de Clotilde Boisvert

Sommaire
Introduction par Clotilde Boisvert .................................................... I
Achillée millefeuille ........................................................................ 7
Amandier .......................................................................................... 13
Angéliques ........................................................................................ 18
Arnica ................................................................................................. 24
Aubépine ........................................................................................... 31
Bouleau .............................................................................................. 37
Bruyères ............................................................................................. 41
Camomilles ....................................................................................... 45
Cassis ................................................................................................. 52
Citronnier et Oranger ..................................................................... 55
Consoude ........................................................................................... 65
Eucalyptus ......................................................................................... 70
Fenouil ............................................................................................... 73
Genévrier ........................................................................................... 79
Laurier ............................................................................................... 92
Lavandes ........................................................................................... 94
Marronnier d’Inde ........................................................................... 101
Mélisse ............................................................................................... 105
Menthes ............................................................................................. 110
Olivier ................................................................................................ 121
Orties .................................................................................................. 126
Pervenches ........................................................................................ 135
Pins et sapins ................................................................................... 138
Plantains ............................................................................................ 146
Romarin ............................................................................................. 152
g

Ronces ................................................................................................ 154
Rosiers, églantiers ............................................................................ 160
Sauges ................................................................................................ 171
Sureaux .............................................................................................. 180
Vigne .................................................................................................. 190
30 PLANTES UTILES

Introduction
Le chanoine Paul- Victor Fournier était un grand botaniste. La
première édition de son ouvrage fondamental, le Dictionnaire des
plantes médicinales et vénéneuses de France, date de1947. Il a comblé
d’aise les botanistes, les phytothérapeutes, tous les amoureux des
plantes. Avoir sous la main ce qui nous reste de tant de recherches
faites tout au long des siècles, des propriétés, dûment expérimen-
tées, des plantes médicinales, leurs noms vernaculaires et étrangers,
savoir, en détail, la façon de les distinguer les unes des autres et de
les utiliser, leur toxicité éventuelle: quelle richesse !
Ce livre restera une base privilégiée pour prendre conscience tant
des actions multiples de ces plantes qui sont notre quotidien que
du travail de nos ancêtres depuis les temps les plus anciens. Il n’a
ni vieilli ni démérité. Il décrit les mille cinq cents plantes médici-
nales de la flore française.
Cette « bible », nous avons voulu la rendre accessible à un public
plus large. Trente plantes ont été sélectionnées dans toutes les
régions de France, terre aux contrastes particulièrement affirmés.
Ce sont des plantes qui vous entourent : des étangs aux chemins,
du bord de mer à la garrigue, de la prairie à la montagne. Ce choix
englobe des herbes, des arbres et aussi des plantes usuelles, alimen-
taires même, jusqu’à celles, toxiques, qui sont néanmoins de grands
médicaments. Nous avons fait ce choix, difficile certes, mais pra-
tique, en favorisant les plantes exploitées à l’heure actuelle par les
phytothérapeutes*.
Clotilde Boisvert
*
Nous remercions le docteur Jean- Michel Morel, phytothérapeute
exerçant à Besançon où il a initié le DU de Phytothérapie, qui a bien
voulu revoir la liste de ces plantes, garantissant leur actualité au sein
de cette science.
I

et droguistes, les plus petits s’emploient dans la distillerie ; il s’en
fait une énorme consommation pour la fabrication des vermouths.
La vente en est donc considérable et les prix en sont élevés.
Cassis Ribes nigrum L.
Cassissier, Cassier, Groseillier noir, Cacis, Cassis à grappes ; all.: Scwarze Jo-
hannisbeere ; angl.: Black currant ; ital.: Ribes vero.
D’où vient ce curieux mot de Cassis ? On suppose qu’il est
d’origine poitevine et dérivé de Cassia, « casse », le Cassis ayant été
employé, dit-on, pour remplacer la casse. En tout état de cause, il
n’a rien à voir avec la ville de Cassis, dont le nom est d’origine phé-
nicienne, et il est beaucoup plus récent (esiècle).
Cet arbrisseau, connu de tous, qui peut atteindre 1,50 et même 2 m,
se signale par son odeur forte, aromatique ou désagréable suivant les
goûts, par ses feuilles parsemées en dessous, ainsi que les bourgeons,
de petites glandes jaunes résineuses, par ses fruits noirs en grappes
pendantes, à odeur également spéciale. Les fleurs se montrent en
avril-mai ; les fruits mûrissent en juillet-août. Spontané dans quelques
bois de Lorraine, d’Alsace, du Dauphiné, de Belgique et de Suisse, le
Groseillier noir se rencontre à l’état sauvage depuis la Grande-Bre-
tagne jusqu’en Mandchourie. Dans les régions méridionales, il n’existe
que cultivé ; entre celles-ci et son aire naturelle, on le trouve assez sou-
vent subspontané ou naturalisé dans les haies, les bois humides, les
aulnaies, les marécages et les fonds de vallées. Ses fleurs fournissent
aux abeilles un nectar qu’elles recherchent assez peu.
Historique Pas plus que ses deux congénères, le Cassis n’était
connu des Grecs ni des Romains. Originaire des régions septentrio-
nales, il ne commence à être mentionné que dans la première moitié
du e siècle. Rembert Dodoens (1583) en donne déjà une bonne
figure, tandis que Matthiole (1554), en Italie, ne le connaissait pas
encore. La première trace de l’emploi médicinal des feuilles comme
des fruits se rencontre chez le médecin Peter Forestus (1614) qui
raconte qu’ayant eu à soigner, vers la fin du siècle précédent, un
paysan n’ayant pas uriné depuis dix jours et qui, par avarice, avait
négligé de recourir au médecin, il lui administra une décoction de
sommités de Cassis, ce qui provoqua une abondante émission d’urine
sanguinolente. « Forestus, dit le DrH.Leclerc, considère ce remède
comme le plus actif pour combattre l’ischurie liée à la présence d’un
CASSIS
52
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%