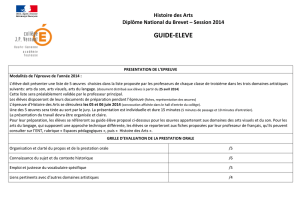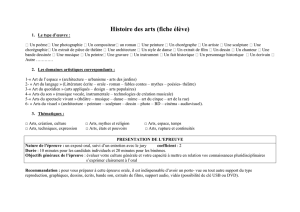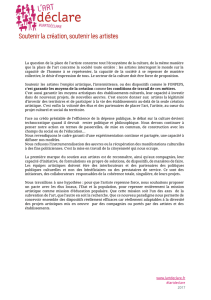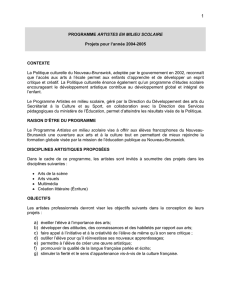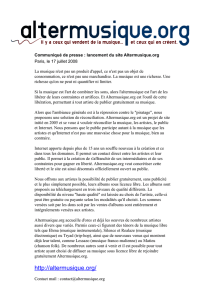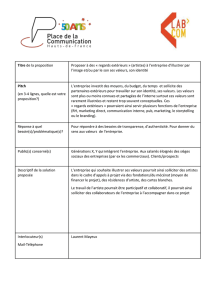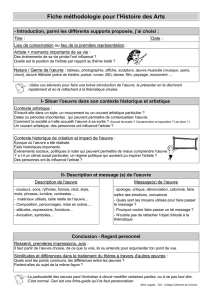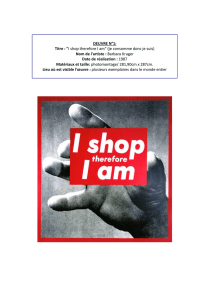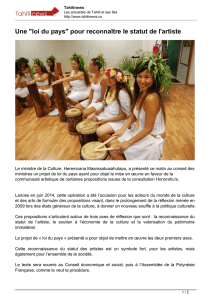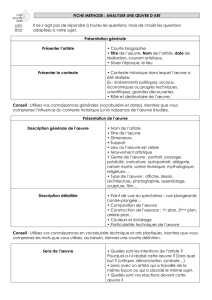adr-valeurs-croisees-jeanpierre

30
laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise
Dans un article scientifique célèbre de la fin des années 1960, l’anthropologue
norvégien Fredrik Barth renouvelait profondément les conceptions communes
ou traditionnelles de ce qui fait l’identité des groupes humains. Il proposait
de penser l’identité culturelle ou ethnique non plus comme une somme de
traits définis et en nombre limité ou comme un réseau cohérent de pratiques,
mais comme le produit d’un travail constant et permanent d’établissement, de
maintien ou de transformation de frontières (boundaries). L’existence d’une unité
culturelle discrète ou d’un monde social relativement autonome présuppose
toute une activité de différenciation, « des processus sociaux d’exclusion et
d’incorporation », des pratiques d’identification et d’attribution, qui, selon
Barth, doivent constituer l’objet propre de l’ethnologue. La position de Barth
ne consistait pas seulement à décentrer l’analyse anthropologique du cœur des
cultures de groupes à leurs franges, ni à critiquer les conceptions implicites
des cultures ou des sous-cultures comme entités closes, ni même à étendre
métaphoriquement la signification de la catégorie de « frontière » afin qu’elle
serve pour analyser toute forme de contact ou de rencontre. Barth allait plus
loin en retournant une des présuppositions implicites les plus ancrées dans nos
représentations du monde selon laquelle les groupes préexistent logiquement
et analytiquement à leurs « frontières ». Or pour lui, ce sont au contraire ces
frontières qui définissent les mondes sociaux dans leur spécificité et qui en
déterminent non seulement les contours mais également les valeurs et les
normes indigènes. Les identités d’un groupe sont pensées dans ce cadre non
pas comme des causes mais plutôt comme des effets, comme les produits d’une
interaction ainsi que d’une activité complexe de reconstruction contingente,
continuée et, sous certaines conditions, cumulative, de frontières.
| ENGLISH P. 76
laurent Jeanpierre est sociologue et maître de conférences à
l’université de Strasbourg (Institut d’études politiques). Ses travaux
portent sur les configurations sociales, les normes d’action et
les politiques des mondes artistiques et scientifiques et sur leur
internationalisation. Il propose à partir de ces recherches une critique
des théories critiques et de leurs effets et s’intéresse à ce qui, dans
l’art et dans d’autres pratiques, peut relever d’un agir expérimental
entendu comme critique en acte.

En quoi une telle démonstration peut-elle bien intéresser
l’art contemporain ? Une réponse à cette question apparaîtra
peut-être à condition de se représenter schématiquement la
dynamique historique de l’art à l’époque moderne comme
un mouvement d’élargissement de territoire et d’ouver-
ture de frontières. En tant qu’univers défini d’abord par
ses frontières, c’est-à-dire différencié et séparé d’autres
mondes sociaux spécialisés, le monde de l’art des deux
derniers siècles n’a cessé en effet d’accueillir de nouveaux
protagonistes, de nouveaux objets et de nouvelles prati-
ques – bien au-delà des genres constitués auparavant par la
division traditionnelle du système des beaux-arts, division
elle-même remise en cause et bouleversée pendant cette
période. La présence et le domaine de l’art contemporain se
sont étendus et s’étendent toujours, dans des pays de plus
en plus nombreux et en des lieux de plus en plus divers, par-
delà les murs des institutions qui lui étaient historiquement
dédiées, tels que le musée, la galerie, l’école des beaux-arts
ou plus récemment les centres d’art. S’il est naïf et excessif
d’en déduire que l’art contemporain se serait désormais
infiltré partout, il faut constater qu’en son sein cohabitent
des compétences, des actes et des objets des plus disparates,
en provenance des mondes sociaux les plus variés et anté-
rieurement distincts voire très éloignés de lui et de sa culture.
Cela n’exclut pas qu’il y ait, bien sûr, plusieurs indices de
clôture relative de cette culture de l’art contemporain, comme
des institutions spécifiques, des professionnels certifiés et
des publics spécialisés, au point qu’il sera toujours possible
pour l’idéologue qui le souhaitera – cela vaut d’ailleurs pour
tout monde relativement spécialisé – de stigmatiser ce qui
serait son hermétisme, sa portée limitée, voire son élitisme.
Il reste que l’univers de l’art contemporain apparaît comme
plus fluide et plus incertain dans ses contours et ses éléments
constituants que ne le sont aujourd’hui, par exemple, les
autres secteurs de pratiques culturelles. L’épreuve historique
et définitoire de l’art des deux derniers siècles est à ce titre
une épreuve des frontières.
Cela signifie aussi que l’art se redéfinit et se différencie
continuellement dans la rencontre avec le non-art, c’est-
à-dire avec un ensemble de pratiques qui lui sont, dans
un premier temps, étrangères, comme – pourquoi pas ? –
des pratiques scientifiques ou techniques, médicales
ou sportives, industrielles ou artisanales, amateurs ou
professionnelles, ordinaires ou exceptionnelles, etc., et dont
les artistes (ou celles et ceux qui le deviennent sans le vouloir
ou le savoir) intègrent occasionnellement une partie – quel-
ques éléments, quelques gestes, quelques principes. Dans
son mode d’existence actuel, l’élément de l’art est donc par
nature hétérogène, toujours hybride ou impur – ce qui n’em-
pêche en rien que des esthétiques y soient périodiquement
élaborées autour d’une visée de purification contraire à ce
processus historique (retrouver l’essence de la peinture,
détacher le cinéma de toute dépendance envers la narrati-
vité littéraire, inventer pour la danse son langage propre,
etc.). Ainsi, de même que toute culture se définit, pour Barth,
suivant les frontières qu’elle produit et qu’elle consolide en
interaction avec d’autres cultures, il n’existe pas réellement
de définition substantielle et stabilisée de l’art contemporain.
Toutes celles qui peuvent ou qui pourraient être données
découlent en réalité de cette dynamique de différenciation et
d’absorption aux frontières et sont, pour cette raison même,
appelées à devenir caduques.
L’économie, le monde du travail et, en son sein, l’entreprise,
font sans aucun doute partie, au même titre que de nombreux
autres univers et agencements humains, des mondes ou des
cultures par lesquels l’art contemporain peut construire ne
serait-ce qu’un élément de son identité. Nul besoin d’être
historien d’art pour souligner d’ailleurs que les pratiques
artistiques ont toujours eu leur économie propre et qu’elles
ont cependant émergé aussi comme activités autonomes et
distinctes en se différenciant spécifiquement des pratiques
économiques, d’abord artisanales, puis industrielles.
Comme le montre plus largement Hannah Arendt dans La
Condition de l’homme moderne, l’histoire de l’œuvre d’art
et l’histoire du travail sont profondément interdépendantes,
même lorsqu’elles tendent à se séparer et à diverger. Les
Ateliers de Rennes qui viennent d’avoir lieu se sont efforcés
d’interroger ces rapports pour la période contemporaine.
Et plutôt que de partir d’une hypothèse d’identité ou, au
contraire, d’opposition des artistes et des travailleurs ou
du monde de l’art et du monde de l’entreprise, il s’agissait
de construire un poste frontière, une zone tampon : espace à
la fois d’hybridation et de différenciation, de passage et de
séparation entre les deux mondes, espace de défamiliarisation
ou d’« étrangisation » (comme dit Victor Chklovski) pour tous
les protagonistes. Une situation artificielle a donc été créée,
31
|

32 | ENGLISH P. 76
laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise
contraignant les artistes et les acteurs de l’art contemporain
– comme les acteurs des entreprises ou des institutions
participantes – à réinterroger les ressemblances et les
différences entre art et travail, et à construire collectivement
des circulations et des frontières éventuellement nouvelles
entre les pratiques artistiques et les pratiques d’entreprises,
ou bien à reposer le problème des rapports existant entre
relations esthétiques et transactions économiques.
Une expérience de ce type est presque naturellement destinée
à rencontrer une forte hostilité de la part de tous ceux qui ont
une représentation tranchée de ces rapports. L’idée que l’art
et l’économie – la firme, le marché – portent des systèmes de
valeurs opposés est en effet largement dominante parmi les
acteurs du monde de l’art comme parmi les protagonistes
du monde du travail ou du monde marchand. Certes, une
hypothèse contraire, minoritaire, s’affirme depuis quelques
décennies en partant paradoxalement de prémices identi-
ques : les oppositions anciennes de l’artiste et du travailleur
ou de l’art et de l’économie auraient bien existé, mais elles
tendraient à disparaître sous l’effet d’une évolution très
contemporaine du capitalisme, ce dernier intégrant peu à peu
l’appel à la créativité et les valeurs portées par les pratiques
artistiques. Solidaires dans leur opposition même, ces deux
modes de représentation des rapports entre mondes culturels
et mondes du travail soit sous-estiment, soit surestiment la
dépendance de l’art envers l’économie. C’est ce que suffira
à rappeler ici un examen rapide de leurs thèses principales,
avant que ne soit précisé plus avant l’intérêt théorique et
stratégique du pari, effectué en partie dans cette première
édition des Ateliers de Rennes, de suspendre expérimenta-
lement tout jugement afin d’analyser in vivo, plutôt qu’in
vitro, l’état de ces relations de dépendance et d’interdépen-
dance aujourd’hui.
inCoMMensuraBilités
Que l’alliance ou la rencontre de l’art et de l’entreprise
paraissent en règle générale contre-nature n’a rien de bien
surprenant. Les productions artistiques entretiennent, avec le
travail qui les rend possibles, un rapport ambigu. D’un côté,
en effet, toute œuvre est produite, elle est le résultat d’une
activité. D’un autre côté, les conditions de sa production
sont longtemps restées cachées ou occultées, du moins pour
le public ou la postérité. Avec l’affirmation par les artistes
eux-mêmes d’un ensemble divers mais relativement spéci-
fique et autonome de valeurs, de normes et d’institutions (les
académies, les salons, les écoles) régulant leurs pratiques,
les œuvres se sont présentées comme des objets détachés de
toute vie sociale, matérielle, ordinaire. Ce processus est sans
doute ancien en France où, dès le x v i i e siècle, la profession
d’artiste s’est constituée en s’arrachant à l’artisanat dont
elle était issue et en subordonnant la main technicienne à la
main habitée par l’esprit. Les anciens ateliers ont ainsi donné
naissance tout à la fois aux académies et aux manufactures,
de sorte que les beaux-arts ont peu à peu refoulé leur rapport
originel à la technique et à l’économie. Le romantisme du
x i x e siècle est l’idéologie accomplie de ce refoulement, avec
sa mythologie, diffuse et toujours persistante, du génie ou
de l’inspiration, de la liberté de l’artiste, de la création spon-
tanée et du « créateur incréé ». Plutôt que d’être croisées, les
valeurs de l’art et de l’entreprise ont donc avant tout été
inversées, comme la bohème s’opposait formellement à la
bourgeoisie dans le Paris du x i x e siècle. Le discours de « l’art
pour l’art » qui émerge alors est à la fois un symbole et le
modèle de cette opposition : il affirme le désintéressement
fondamental du geste artistique par opposition à la logique
d’accumulation qui anime un capitalisme dont Marx révèle
les lois à la même période. La photographie, le cinéma, la
vidéo, dont le développement a pourtant largement dépendu
de changements techniques et de ressources économiques
importantes, n’ont pas modifié cette mise en scène d’elle-
même d’une grande partie de la culture : la dissimulation
du labeur et l’aversion envers les passions économiques
font partie, depuis plusieurs siècles, des comportements
cardinaux des mondes artistiques.
Cette détermination initiale de la table moderne des valeurs
de l’art contre celle du monde du travail et de l’économie est
d’ailleurs si ancrée dans les schèmes ordinaires de percep-
tion du monde qu’elle a fourni et continue à offrir une
somme potentiellement infinie d’archétypes sociaux au sens
commun. Ainsi la figure de l’artiste et celle du travailleur se
repousseraient comme la liberté s’opposerait à la contrainte,
l’inspiration ou la paresse à l’effort et au labeur, le travail
improductif au travail productif, le beau à l’utile ou à la
valeur marchande, la créativité à la routine, le tour de main
singulier au procédé de production, etc. Avec de tels couples

33
|
polarisés, employés alternativement ou symétriquement par
les artistes comme par les salariés ou les entrepreneurs, les
frontières entre l’art et l’entreprise ont été bien gardées.
Une telle étanchéité entre mondes esthétiques et écono-
miques, un tel rejet de part et d’autre, a en même temps
été la condition pour que l’art dispose d’une extériorité de
principe vis-à-vis de l’univers du travail et donc d’une prise
critique sur lui. Pour certains artistes, toute pratique artis-
tique doit adopter l’ascèse de se restreindre à l’exercice de
cette critique des valeurs économiques et bourgeoises, voire
du capitalisme comme système d’exploitation ou d’aliéna-
tion (« Capitalism kills », rappelle dans l’exposition Valeurs
croisées l’artiste Claire Fontaine). Fût-ce au prix d’un déni
des conditions économiques, sociales et matérielles de sa
propre production, un tel art entend réaffirmer toujours
et partout l’idéal régulateur du monde de l’art autonome
comme au-delà déjà-là de l’économie : non pas tant la visée
du Beau, donc, que le désintéressement esthétique comme
étape inaugurale vers l’expression pleine et l’émancipation
de tous les individus.
Bien entendu, il a existé parallèlement, depuis l’autono-
misation du champ artistique au x i x e siècle, des courants
défendant cette même visée émancipatoire de l’art au moyen
d’une alliance (plutôt que d’un principe de séparation) avec
une partie au moins du monde économique et de ses valeurs :
défense de l’artisanat contre l’industrie capitaliste avec le
mouvement Arts & Crafts ; art mis au service d’un projet
socialiste de construction de nouvelles formes de vie avec
le Bauhaus ou le constructivisme russe, etc. Adoptant le
projet politique de modification, de suspension ou d’abolition
des structures capitalistes de l’économie – notamment la
propriété, mais aussi le monopole de l’échange marchand sur
les autres formes de réciprocité – certains artistes ont ainsi
pu concevoir leurs pratiques dans le cadre d’une nouvelle
organisation du travail et d’un rapport plus optimiste aux
possibilités libérées par la technique et l’industrie. L’épreuve
des frontières à laquelle l’art contemporain est essentielle-
ment confronté s’est donc parfois jouée à l’intérieur même
du monde économique. Toute l’histoire de l’architecture, du
design, des arts dits appliqués et des conflits en leur sein
pourrait être reconsidérée sous cet angle. Il faut ajouter que
la mythologie ou le fantasme d’un art absolument détaché
des valeurs et des pratiques de l’entreprise industrielle n’a
pas seulement été remis en cause par certains courants artis-
tiques de l’avant-garde moderniste : il a aussi été contesté
depuis le monde économique lui-même. De sorte que si l’ar-
tiste n’a probablement jamais été vierge ou indépendant
des forces économiques et du capitalisme, il l’est pour cette
raison encore moins aujourd’hui qu’hier.
ConVergenCes
Afin de saisir la portée de ces convergences éventuelles
entre les valeurs esthétiques et les valeurs économiques, il
convient cependant de différencier l’entreprise et le marché
comme institutions économiques à la fois distinctes et
complémentaires. Nul ne contestera le poids croissant des
mécanismes marchands dans l’établissement des hiérarchies
artistiques. Maisons d’enchères surpuissantes, galeries à
portée mondiale organisées comme des entreprises avec
leurs filiales et leur second marché, poids des grands collec-
tionneurs internationaux, multiplication des grandes foires
à échelle internationale sur plusieurs continents, alignement
tendanciel des acquisitions ou des orientations esthétiques
des musées et des programmations d’expositions sur les
choix de l’ensemble de ces acteurs privés, phénomènes de
concentration et d’intégration par un même agent des diffé-
rents maillons de la chaîne de valorisation artistique : tous
ces facteurs renforcent l’effacement des critères d’évaluation
des œuvres définis par les artistes et les critiques derrière
le seul critère de la valeur marchande. Aux différences,
certes débattues, de qualités des œuvres ou de parti pris
des artistes, se substituerait ainsi peu à peu une hiérarchie
des cotes et des prix rétroagissant sur l’ensemble des juge-
ments de goût. Ceux qui disaient dès les années 1960 que
l’art était désormais une marchandise comme les autres, et
l’art contemporain le signe distinctif des nouvelles classes
bourgeoises ascendantes, ont ainsi vu leur prophétie ou leur
théorème de mieux en mieux fondé.
De telles transformations – lorsqu’elles ont été perçues et
considérées par les artistes – ont provoqué nécessairement
des tentatives de redéfinition des fondements de l’autonomie
relative du monde de l’art. Démultiplier (comme chez Pinot
Gallizio, exhumé à nouveau à Rennes) ou dématérialiser
l’œuvre, la réduire à son concept, à son processus, aux rela-
tions qu’elle pourrait provoquer, faire de sa vie d’artiste, ou

des interactions autour de cette vie, les lieux mêmes de
l’œuvre, ne semble pourtant plus y suffire : toutes ces straté-
gies artistiques conçues comme antimarchandes et virtuel-
lement garantes de cette nouvelle autonomie des artistes
finissent, avec le temps, par être reconnues, valorisables,
et parfois valorisées sur le marché. Tout se passe comme si
la dénonciation du caractère marchand du monde de l’art
finissait par être prise dans un paradoxe pragmatique inso-
luble. Pour être conséquente voire efficace, la critique en acte
des mécanismes du monde de l’art doit en effet être visible
dans le monde même qu’elle dénonce. Et cette visibilité est
simultanément l’appui même à partir duquel le processus de
sa valorisation marchande est possible (quand bien même
il ne se réalise pas toujours).
Que reste-t-il dès lors à faire ? Dévaloriser l’art, comme
disaient autrefois les situationnistes, détruire les fausses
valeurs du monde de l’art devenu simple marché ? Mais
comment ? Avec quelles techniques, quels moyens, « combien
de divisions » ? Depuis quels appuis indigènes ou extérieurs ?
Ces questions animent une fraction sans doute croissante de
protagonistes des mondes de l’art qui entendent aujourd’hui
précisément s’en échapper (comme l’expriment de nombreux
participants de la Biennale de Paris – certains d’entre eux
étant également présents à Rennes), disparaître, et continuer
cependant à faire de l’art en dehors de l’art, ou bien à faire
tomber la distinction et la frontière entre l’art et le « non-art ».
Faire de l’art comme un jeu. Faire de l’art le plus grand des
jeux. Faire du jeu même la raison d’être et l’horizon de l’art.
Faire de l’art gratuitement, hors des circuits de la valori-
sation économique. Et pourquoi pas, aussi, faire de l’art là
même où une grande partie de la population passe sa vie
quotidienne, au travail, en entreprise par exemple, a fortiori
si l’on s’interdit de bénéficier des ressources procurées par
le monde de l’art.
C’est une voie qui n’est pas exclue par des artistes qui refu-
sent plus ou moins totalement l’économie du marché de
l’art et le type de valorisation qu’elle implique. En sorte
que la critique de ce marché peut paradoxalement aller de
pair avec une acception de l’économie d’entreprise et de ses
règles, et qu’à la figure héroïque de l’artiste entrepreneur
flanqué de son aréopage d’assistants produisant des œuvres
de plus en plus monumentales et nombreuses, pourrait
bien s’opposer un jour une petite armée d’employés ou de
consultants artistes, spécialistes parfois anonymes de l’écart
et de l’infra-mince. Contre la tendance à la concentration
par quelques créateurs de la reconnaissance économique
des compétences artistiques, pourrait s’affirmer – à condi-
tion que cette stratégie de sortie de l’art se généralise – une
démocratie artistique plus égalitaire, un communisme des
talents (explicitement recherché, par exemple, par le collectif
At work). Que tout le monde par conséquent devienne ce qu’il
est déjà sans le savoir forcément – un artiste – et les fausses
valeurs du monde marchand de l’art en viendraient à tomber.
Peu importe, au fond, que la réalisation d’un tel programme
ait depuis le x i x e siècle rencontré de nombreux obstacles et
que le monde marchand de l’art se maintienne et croisse,
quelle que soit par ailleurs la multiplication effective des
pratiques artistiques amateurs ou profanes : les frontières de
l’art et de l’économie s’en trouveraient au moins déplacées
puisqu’au face-à-face de leurs deux mondes pourrait se
substituer à terme une confrontation entre l’élite des artistes
entrepreneurs et la masse des employés artistes. Curieux
champ de bataille imaginaire, pourtant, qui ressemble à s’y
méprendre à la structure sociale effective des mondes de l’art
d’aujourd’hui. Les milieux artistiques sont en effet parmi
les plus concurrentiels et les plus inégalitaires des univers
professionnels : la concentration des profits symboliques et
économiques y est extrême, les espérances de succès compa-
rables à celles de la loterie nationale. Curieuse utopie, en
somme, qui accentuerait (mais sans les politiser) les traits
de la réalité…
S’il est vrai que l’artiste tend de plus en plus à devenir un
travailleur comme les autres, c’est que, symétriquement, de
l’autre côté de la frontière entre l’art et l’économie, les règles
du jeu du travail en entreprise sont, elles aussi, en train de
changer. A l’échelle micro-économique, au niveau du manage-
ment avant tout, l’injonction à la créativité et à l’innovation
aurait pris la place du travail répétitif et routinier prédo-
minant à l’ère taylorienne. Au niveau macro-économique,
les industries dites créatives ou les pôles de compétitivité
tournés vers l’innovation scientifique et technique sont
aujourd’hui considérés comme des facteurs irremplaçables
de la croissance et de la prospérité collective. Le mode de
fonctionnement par projets des mondes artistiques est donc
paradigmatique pour le « nouvel esprit du capitalisme » et
34 | ENGLISH P. 76
laurent Jeanpierre l’art contemporain au seuil de l’entreprise
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%