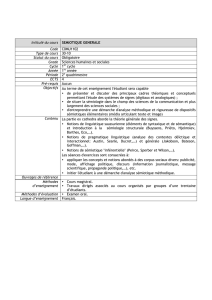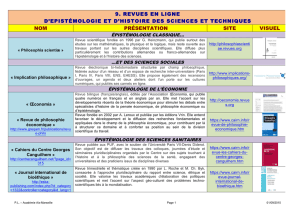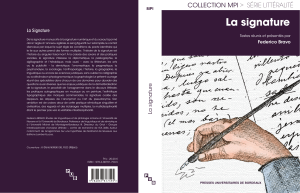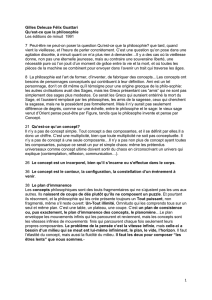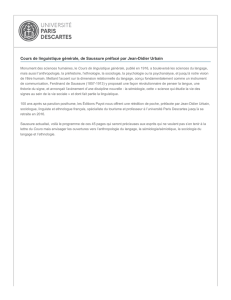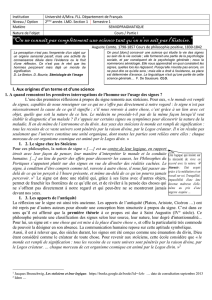Beividas, Waldir. Sur l`épistémologie du Résumé

1
SUR L’ÉPISTÉMOLOGIE DU RÉSUMÉ : PAS DE PHILOSOPHIE SANS LINGUISTIQUE.
Par Waldir BEIVIDAS (USP-BR)
O. Introduction
Je souhaiterais que ma communication dans ce Colloque sonne
comme un hommage à Hjelmslev, évidemment à mon échelle, pour
deux raisons de statut différent :
(a) Prémièrement, un hommage de réparation devant la situation
d’une disproportion monstrueuse entre, d’un côté, la pensée de ce
Maître, si riche en profondeur théorique pour le monde des idées, si
féconde par les initiatives opératoires en métholologie descriptive du
langage naturel et, de l’autre coté, la presque complète
méconnaissance de cette pensée par la linguistique mondiale
d’aujourd’hui, dans la plupart des cas. Ici, Claude Zilberberg a la
formulation la plus précise et la plus avisée :
On tombera certainement dans l’illusion ou dans l’utopie en
imaginant qu’un jour l’immense tableau des catégories du Résumé
puisse devenir un appareil descriptif courant dans les classes de
linguistique. L’imaginaire scientifique de la linguistique a pris un
chemin autre : Prague a vaincu Copenhague, depuis la phonologie de
Jakobson/Troubetzkoy aux fonctionalismes et chomskysmes ambiants.
Il n’empêche pourtant qu’ici, comme des fourmis devant des
élephants, nous puissions travailler cette pensée qui prime par les
deux vertus majeures de l’esthétique choisie par Hjelmslev :
l’objectivité et la précision en tant qu’« aspiration à la beauté »
(« Entretien sur la théorie du langage », 1941, In : Nouveaux Essais, p.
86).
(b) Deuxièmement, j’estime – et c’est la première hypothèse que je
me propose de développer ici – qu’à la suite de F. de Saussure, le père
de la linguistique structurale, le fils direct et incontestable, Hjelmslev,
nous a laissés des pistes et des éléments très solides pour la création –
bien au delà d’une métholologie descriptive du langage – d’une

2
véritable épistémologie immanente pour les sciences – je me risquerai
à dire : pour les sciences de l’homme et pour les sciences de la nature
– épistémologie qui peut avoir une portée concurrente, rivale voire
équivalente à l’épistémologie actuelle des sciences et à celle qui
commande les raisonnements philosophiques en général. Selon mes
vues, cette épistémologie est née avec le geste saussurien de la
proposition du principe de l’arbitrarité du signe, de l’acte sémiologique
qu’il instaure, et du pacte sémiologique qui en découle. Comme un fil
rouge, cette épistémologie prends source chez Saussure, traverse la
pensée de Hjelmslev, passe par Greimas et atteint quelques
sémioticiens d’aujourd’hui, notamment Cl. Zilberberg, mais comme un
fil très fin qui demande à être tissé en toutes ses trames et couleurs.
Je vous présenterai mes réflexions en deux volets, l’un autour de
cette épistémologie immanente, sémiologique, qu’il faut encore édifier,
l’autre autour des rapports entre sémiotique et philosophie.
1. Pour une épistémologie immanente.
Mon propos dans ce volet sera de relever les indices et la portée
de cette épistémologie au sein de la pensée de Hjelmslev, en
particulier autour de la gigantesque construction catégoriale du
Résumé. Je pars de la communication au IVe Congrès International de
Linguistes (1936), intitulée « Essai d’une théorie des morphèmes »,
publiée en 1938 et publiée dans les Essais linguistiques (1971: 161-
173). On est frappé à la dernière page de ce texte par le basculement
surprenant du niveau de réflexion. En effet, même si dans Raison et
poétique du sens (1988 : 72) Cl. Zilberberg considère cet article du
maître danois comme une présentation brève et « accessible » –
quoique les guillemets entourant « accessible » marquent sûrement,
avec une pointe d’ironie, un effet concessif – de ce que sera le Résumé
et de ce qui aurait été l’oeuvre majeure, avec Uldall, An Outline of
Glossematics, ce texte puissant se distingue par le degré de
raffinement d’une technicité éminemment linguistique des catégories
et des fonctions mises en scène.
Il se trouve que dans les dernières lignes de ce texte, le lecteur
devient étourdi : d’un seul coup, Hjelmslev bouleverse le raisonnement

3
technique en proposant et en insistant cette fois sur les conséquences
philosophiques que sa théorie engage : La formulation nous vient en
quatre coups, dirons-nous, secs et tranchants (p.173) :
(ι) « Les faits du langage nous ont conduits aux faits de la
pensée » ;
(ιι) « la langue est la forme par laquelle nous concevons le
monde » ;
(ιιι) « Il n’y a pas de théorie de la connaissance, objective et
définitive, sans recours aux faits de la langue » ;
(ιϖ) « Il n’y a pas de philosophie sans linguistique ».
Je vois un poids exorbitant, du point de vue épistémologique,
dans ces quatre formulations – pour ainsi dire, les quatre filets épais
des rêts du pêcheur – ce qui nous autorise, si même il nous oblige, à
une réflexion approfondie sur l’épistémologie qui en découle, d’autant
plus qu’elle s’avère entièrement immanente au langage. Sur la
première formulation la déduction est cristalline : pas de faits de la
pensée sans avoir d’abord, comme source, des faits de la langue. Ce
premier filet reprend et confirme Saussure :
« Prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n’est
nécessairement délimité. Il n’y a pas d’idées préétablies, et rien n’est
disctinct avant l’apparition de la langue » (Cours..., p. 155) ;
Du deuxième filet de Hjelmlsev on stipule un argument
également vigoureux : le monde qui nous entoure n’est autre que le
monde du langage naturel. Du troisième découle que la théorie de la
connaissance doit se subordonner à la théorie du langage ; le
quatrième est suffisamment éloquent. On voit donc l’enjeu et la
gageure qu’on a dans les mains.
Dans cette direction, en assemblant l’immense tableau des
catégories du Résumé, à partir des formulations hjelmsleviennes
autour et à coté de ses Prolegomènes, de ses Essais et des Nouveaux
Essais, entre autres, et d’après les progrès de la linguistique issue de
Saussure, de la sémiotique danoise qui a inspirée la pensée de
Greimas, jusqu’à la sémiotique des dernières années, en particulier

4
dans les mains de Cl. Zilberberg, il est possible de revendiquer un
regain d’interêt pour la construction de cette épistémologie, que
j’estime foncièrement langagière (donc immanente) dont je viens de
parler – on pourrait la nommer sémiologique, ou même discursive, le
choix du nom est secondaire –, et dont le statut soit à même de
rivaliser avec les arguments philosophiques (tous transcendantaux du
point de vue de Hjelmslev) et avec l’épistémologie scientifique
(presque toujours réaliste), en ce qui concerne les questions de
l’emergence et de la construction du sens pour le monde humain, voire
en ce qui concerne les questions générales et globales des contraintes
de l’existence de l’homme dans le monde.
Si je pars de ces quatre formulations inserées abruptement à la
fin d’un texte très descriptif et technicien ce n’est que parce que, de
l’aveu même de Hjelmslev, ce texte n’est qu’une esquisse des
contours d’une « synthèse intégrale » qui annonce son oeuvre
majeure, le déjà mentioné Outline of Glossematics. Donc on a le droit
de supposer que les formulations exorbitantes ci-dessus pourraient
être considerées comme la clef de voûte de sa pensée, dans le sens
suivant : voilà où tout ça mène.
Il s’agit d’une conception « maximale » de la langue par
Hjelmslev – j’emprunte ce mot de mémoire à Cl. Zilberberg – c.a.d. la
langue comme la seule forme dont nous concevons le monde. Cette
conception maximale s’éparpille en divers endroits des textes du
maître danois. À l’ouverture des Prolegomènes, dans une des plus
belles pages à jamais écrite dans l’histoire de la linguistique, le
langage apparaît comme « l’instrument grâce auquel l’homme
façonne… [pesons chaque gramme des mots qu’il emploie] :
(i) sa pensée – et ceci concerne tout ce qu’on peut nommer par la
raison et ses multiples raisons, des simples raisonnements du
honnête homme pour demander un verre d’eau, aux
cogitations les plus subtiles du philosophe pour en résoudre
les apories ;
(ii) ses sentiments, ses émotions – et ceci indique la structure
langagière du psychisme humaine, soit au niveau conscient,

5
soit au niveau de l’inconscient – « structurée comme un
langage », défendait vigoureusement un Lacan saussurien ;
(iii) ses efforts, sa volonté – voyons-y tous les aspects de
l’intentionalité (phénoménologique) et du désir
(psychanalytique) ;
(iv)ses actes – dont la sémiotique narrative a déjà beaucoup rélevé
la nature et la syntaxe ;
(v) il influence et est influencé – également ici la sémiotique de la
manipulation tout comme les propositions freudiennes sur le
transfert ont déployé les tenants et les aboutissants ;
(vi)l’ultime et plus profond fondement de la societé humaine – et
voilà le vaste monde du social plongé dans l’immanence du
langage.
Rien à reprocher à ces définitions de la conception maximale du
langage de Hjelmslev sauf les deux métaphores utilisés dans
l’occurrence :
(i) la métaphore du langage comme « instrument », ce qui peut
eventuellement faire du langage quelque chose d’« externe »
dont on peut se servir et, par conséquence, qu’on peut mettre à
coté, ce qui contredit la portée de la conception elle-même ;
(ii) la métaphore tisseuse : le langage comme « un fil profondément
tissé dans la trame de la pensée » (p. 9), c.a.d. le langage
comme des fils ourdis avec les fils de la pensée peut donner
marge à la vieille dichotomie langage-pensée et réactiver les
voeux d’autonomisation de la pensée, qui depuis toujours (et
peut-être à jamais) hante la philosophie et la psychologie, et
nous plonger une nouvelle fois en des discussions interminables
sur les antécédences et les priorités d’un coté ou de l’autre ;
Or, si ces définitions nous mènent, pour cause et par
conséquence, directement à une théorie immanente et si, au nom de
l’immanence, la théorie refuse toutes les interventions transcendantes
de la philosophie, mais aussi de la psychologie, de la sociologie, c.à.d.
des branches des sciences humaines bien contemplées dans les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%