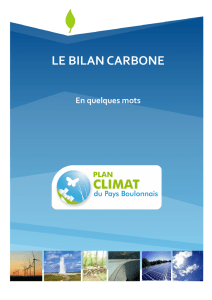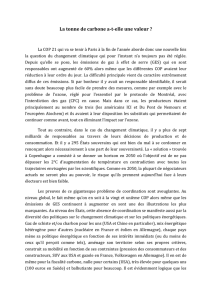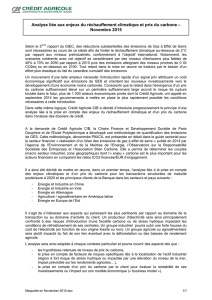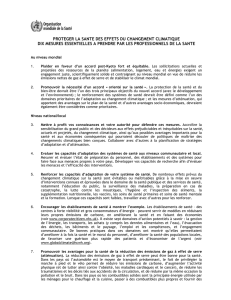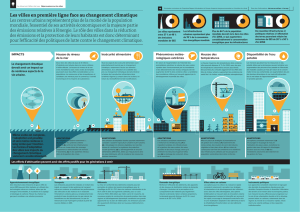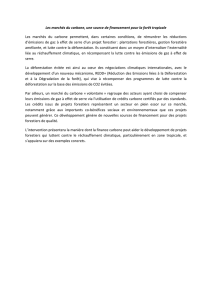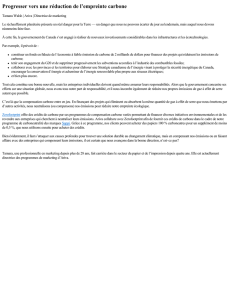Format PDF - Association d`Économie Financière

1
L'ENTREPRISE RESPONSABLE
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
LE RÔLE DES ENTREPRISES
DANS LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ALAIN GRANDJEAN*
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UNE COURSE CONTRE LA MONTRE
N o tre monde connaît aujourd’hui des dérèglements climatiques impor-
tants, notamment un réchauffement global du climat extrêmement rapide
à l’échelle de l’histoire de la planète. La communauté scientifi que1 a établi
que les activités humaines sont la cause de ce processus alarmant. En brûlant du
charbon, du pétrole et du gaz pour répondre à la demande croissante en énergie
dans le monde, nous émettons du dioxyde de carbone, un gaz qui augmente le
pouvoir d’effet de serre de l’atmosphère. Nous émettons par ailleurs du méthane,
du protoxyde d’azote et d’autres gaz à effet de serre (GES). Au total, nous avons
émis en 2012 environ 50 milliards de tonnes de GES2 et cette quantité croît avec
le PIB mondial. Le dioxyde de carbone représente environ 60 % de ces émissions ;
la baisse de la consommation d’énergie fossile (80 % de l’énergie consommée
dans le monde, le reste provenant des barrages hydroélectriques, du bois et du
nucléaire) est donc bien l’un des enjeux majeurs de la lutte contre le changement
climatique.
Dans un scénario « tendanciel », la température moyenne planétaire pourrait
croître d’environ 4 °C dans ce siècle, ce qui se traduirait par un changement de
période climatique en moins de cent ans. Il y a vingt mille ans, la température
planétaire était plus basse en moyenne de 5 °C par rapport à l’époque actuelle.
La déglaciation a pourtant conduit au remplacement, en France, d’un paysage de
type Nord-sibérien par celui que nous connaissons aujourd’hui, et cette transition
a mis environ dix mille ans à se produire. Une hausse de quelques degrés de la
moyenne planétaire en un siècle se traduirait par un bouleversement de l’environ-
nement d’une brutalité sans précédent pour la biosphère et notre espèce.
* Cofondateur et associé de Carbone 4.
L’auteur tient à remercier Emmanuelle Paillat, manager chez Carbone 4, pour ses contributions à cet article.

RAPPORT MORAL SUR L’ARGENT DANS LE MONDE 2013
2
Cette dérive climatique pourrait entraîner des bouleversements écologiques,
sociaux et économiques incontrôlables. Nicolas Stern3 avait estimé que dans
certains scénarios, l’impact macroéconomique de ces bouleversements pourrait
être de l’ordre de 30 % du PIB mondial. Les effets de cette dérive pourraient
être d’autant plus impressionnants qu’elle se produit dans un contexte de crois-
sance démographique encore forte (la population humaine d’environ 7 milliards
d’individus pourrait encore croître de 2 milliards d’individus d’ici à 2050) et de
pression déjà excessive sur les ressources physiques et biologiques de la planète.
Avec les technologies et les modes d’organisation et d’aménagement du territoire
actuels, le rattrapage largement souhaité du niveau de vie occidental par
l’ensemble des citoyens du monde conduirait sans aucun doute à un effondrement.
C’est le rapport de Dennis Meadows au Club de Rome qui le premier a attiré
l’attention sur ce risque systémique (Meadows et al., 1973). Malheureusement,
la réactualisation de ces travaux montre que nous sommes assez précisément sur
la trajectoire qu’il décrivait comme conduisant à cet effondrement (Meadows
et al., 2004 ; Turner, 2008).
Pour éviter ce scénario, il est donc nécessaire de « changer de trajectoire » et de
modèle socioéconomique. Dans le domaine du climat, pour parvenir à une
limitation suffi sante de la concentration en CO2 de l’atmosphère planétaire,
préalable indispensable à une stabilisation à terme de la température moyenne,
les experts du climat (GIEC – Groupement intergouvernemental sur l’évolution
du climat) recommandent de diviser au moins par deux les émissions humaines
de CO2 d’ici à 2050, comme l’illustre le graphique 1.
Graphique 1
Émissions humaines de CO2
(en %)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
50 % atteint vers 2050
Point correspondant au plus haut niveau de concentration
de CO2 à 500 ppmv* vers le milieu du XXIe siècle
et diminuant à 450 ppmv aux alentours du XXIIe siècle.
Plus haut niveau des émissions annuelles
avant 2020
Pays en développement
Reste du monde
Pays développés
* Parties par million en volume (parts per million by volume).
Source : Meinshausen et al. (2009).

3
L'ENTREPRISE RESPONSABLE
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
LA DISPARITÉ DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
DANS LES DIVERS PAYS DU MONDE
Les chiffres globaux cachent d’énormes disparités. Entre les pays développés et
les pays émergents ou moins avancés, qui ne peuvent donc pas s’engager sur les
mêmes trajectoires, comme le suggère le graphique 1. Mais également au sein de
ces groupes de pays.
Graphique 2
Émissions de CO2 par pays (hors déforestation)
Source : données 2007, Banque mondiale.
Si la Chine est aujourd’hui le plus gros émetteur mondial de GES, c’est
loin d’être le cas en termes d’émissions par habitant. Ces émissions varient de
plusieurs dizaines de tonnes par an pour le Qatar à plus de 20 tonnes pour
les États-Unis, l’Australie, le Canada et à quelques centaines de kilos pour les
habitants les plus pauvres de la planète. Diviser les émissions mondiales de CO2
par deux d’ici à 2050 (nous serons alors 9 milliards), et le faire de manière égali-
taire, signifi e que chaque individu pourrait émettre 1,8 teqCO2 par an. En France,
il s’agirait donc de diviser par quatre nos émissions nationales, soit un effort de
– 4 % par an sur quarante ans.
Mais cette manière de raisonner est inéquitable car elle ne tient pas compte
6 533
5 832
3 983
1 611 1 536 1 254
368
787 539 374 371
185 64 63 44
5
8
1
10 9
18
6
12
55
19
11 10
22
0,3
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7
000
Chine
États-Unis
Union européenne
Inde
Russie
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Australie
France
Brésil
Égypte
Finlande
Qatar
Bangladesh
0
10
20
30
40
50
60
En millions de tonnes de CO
2
par an
(échelle de gauche)
En tonnes de CO
2
par personne et par an
(échelle de droite)

RAPPORT MORAL SUR L’ARGENT DANS LE MONDE 2013
4
des émissions faites sur un territoire pour satisfaire les habitants d’un autre
territoire. Du fait de sa consommation, un Français, par exemple, a émis en
moyenne 10,3 teqCO2 sur l’année 2011. Ce chiffre représente en équivalent
CO2 la somme des GES relâchés dans l’atmosphère pour fournir à un habitant
de l’Hexagone la construction de son logement, ses déplacements personnels et la
production des biens et des services qu’il a consommés sur l’année. Cet indicateur
(ECO2 Climat)4 prend en compte les émissions de GES des produits fabriqués à
l’étranger qui sont consommés en France. Il diffère donc des émissions directes
faites sur un territoire donné, rapportées au nombre d’habitants, que nous
évoquions plus haut, et calculées en France par le CITEPA (Centre interprofes-
sionnel technique d’études de la pollution atmosphérique)5.
Graphique 3
Émissions de CO2 par habitant en France en fonction de ses besoins
(en kgeqCO2/habitant)
Source : Carbone 4.
On note une différence importante avec l’indicateur ECO2 Climat : alors que
l’on constate une hausse des émissions relatives à la consommation des Français
de 25 % entre 1990 et 2010, l’inventaire du CITEPA enregistre une baisse des
émissions entre 1990 et 2010 de 10 %.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Construction et
gros entretien
des logements
Consommation
d’énergie des
logements
Alimentation Biens de
consommation Déplacements
de personnes
Services
Autres Services publics Voitures Produits électroniques
Fret Produits laitiers Viandes Chauffage
••••
•••
••••
•••
••••
•••
••••
•••
••••
•••
••••
•••
••
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
4 %
400
12 %
1 200
22 %
2 300
24 %
2 400
19 %
2 000 19 %
1 900
▲▲▲
▲▲
▲▲▲
▲▲
▲▲▲
▲

5
L'ENTREPRISE RESPONSABLE
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Graphique 4
Variation entre l’indicateur ECO2 Climat et l’inventaire du CITEPA
(en millions de tonnes de CO2)
Source : Carbone 4.
Pourquoi ? Entre 1990 et 2010, d’une part, nous avons augmenté nos impor-
tations de produits fi nis (notamment les produits électroniques) et, d’autre part,
nous avons délocalisé une partie de notre outil de production, si bien que les
émissions ayant lieu sur l’Hexagone ont diminué, mais que les fl ux de carbone
importés ont quant à eux augmenté ! Pour autant, les GES étant brassés dans
l’atmosphère, c’est leur augmentation globale qui compte en matière de change-
ment climatique.
Pour conclure, on comprend par cet exemple l’intérêt d’une comptabilisation
complète des GES intégrant l’ensemble de tous les gaz contribuant à une activité
donnée.
0
100
200
300
400
500
600
700
Émissions nationales
(CITEPA)
ECO2 Climat
1990
2010
–10 %+25 %
0
100
200
300
400
500
600
700
▲
▲
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%