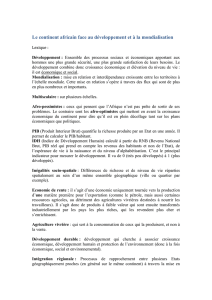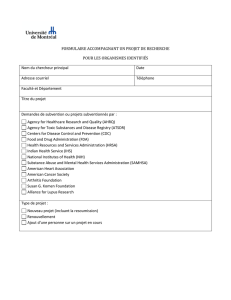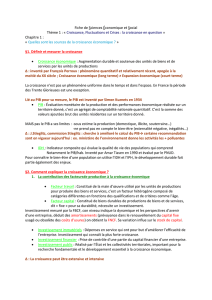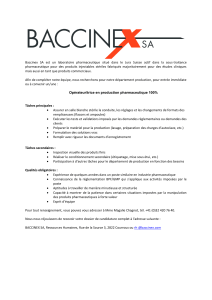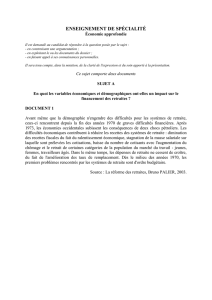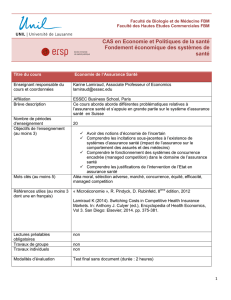Contributions du secteur de la santé à la croissance économique

1
Contributions du secteur de la santé à la croissance économique dans les
pays développés : une revue de la littérature
Yusuf Kocoglu
*
, Rodrigo De Albuquerque David
†
Introduction ................................................................................................................................2
I. Etat de santé et croissance..................................................................................................5
I.1. Les études macroéconométriques worldwide.................................................................6
I.2. Les études macroéconomiques spécifiques aux pays développés................................ 11
II. Innovations dans le secteur de santé et croissance........................................................... 18
II.1. Des dépenses de R&D importantes et dynamiques pour le secteur pharmaceutique...19
II.2. Des dépenses de R&D pour quelle efficacité ? ............................................................ 21
II.3. Des activités de R&D pour quels résultats sur la croissance ?.....................................24
Conclusion................................................................................................................................ 30
Bibliographie sélective.............................................................................................................32
*
Laboratoire d'économie appliquée au développement (Léad), Université du Sud Toulon–Var et Chercheur
Associé au Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE)
†
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise et Laboratoire d’Economie et de Gestion des Organisations
de Santé (LEGOS/LEDA), Université Paris Dauphine
Cet article est issu d’une recherche originale financée par la Drees dans le cadre d’une convention de recherche
avec le Centre d’Etudes de l’Emploi.
Nous tenons à remercier Olivier Bontout (DREES) ainsi que son équipe pour leurs remarques et suggestions sur
une version provisoire de ce travail. Les points de vue exprimés dans celui-ci sont ceux des auteurs et non des
organismes qui les emploient. Nous restons donc seuls responsables des erreurs et omissions qu’il contiendrait.

2
Introduction
Le domaine de la santé est, dans les pays développés, généralement analysé par les
décideurs publics sous l’angle des dépenses de santé. En effet, les dépenses de santé sont
principalement des dépenses publiques qui, par conséquent, se heurtent à la problématique de
leur maîtrise. Ainsi, en 2005, la part du financement public des dépenses de santé se situe
entre 70 % et 90 % dans la majorité des principaux pays développés ; seuls les Etats-Unis se
distinguent avec une part à 45 % (Eco-santé, 2008). La gestion du système de santé suscite
alors une réflexion sur la place accordée par la société à la santé car sous contraintes
budgétaires fortes, le décideur public opère des arbitrages entre le différents postes de
dépenses : éducation, justice, sécurité, politiques sociales…Une hausse des dépenses
publiques de santé implique, toutes choses égales par ailleurs, une baisse des autres dépenses
publiques. Il s’agit alors d’évaluer les préférences des sociétés, mais aussi le coût
d’opportunité de chacune des dépenses publiques et leur « productivité ». La question est de
savoir si la productivité marginale des dépenses de santé sur le bien être de la société est
supérieure à celle des dépenses d’éducation ou de sécurité, par exemple. Il est ainsi admis que
l’amélioration du niveau d’éducation a un impact positif sur la santé. Aussi est-il légitime de
se demander s’il n’est pas préférable, compte tenu des productivités marginales sur l’état de
santé de la population, de consacrer plus de ressources à l’éducation et moins à la santé.
La mesure de l’efficacité du système de santé est difficile et fait débat car elle repose
sur des concepts qualitatifs et subjectifs comme l’amélioration de la qualité de vie ou de l’état
de santé, pour lesquels l’objectivation par une mesure quantitative et monétaire pose
problème. Cependant, les économistes proposent des évaluations des gains économiques
attribuables au secteur de la santé. Ces évaluations peuvent être de plusieurs natures : une
évaluation des gains du traitement d’une maladie comparés aux coûts de celle-ci (cf. Encadré
1) ou une approche en termes de contribution à l’efficacité du système productif que cela soit
à un niveau microéconomique (effets sur la quantité et la qualité de l’offre de travail et le
capital humain principalement) ou macroéconomique (sur la croissance du PIB). La présente
publication se focalise sur les études concernant la contribution de la santé à la croissance
économique. Par croissance économique nous entendons la croissance de long terme, telle
qu’analysée dans les modèles de croissance de type Solow (1956) ou de croissance endogène
(Romer, 1990 ; etc.)

3
La relation entre état de santé et taux de croissance a été, durant la période 1950-1980,
présentée et analysée dans le sens allant de la croissance vers l’amélioration de la santé :
l’augmentation du revenu moyen dans une économie permet aux individus et à la société de
mieux prendre en charge les problèmes de santé et par conséquent la croissance améliore
l’état de santé général de la population. L’objet des travaux macroéconomiques plus récents
sur la relation état de santé de la population et croissance est de démontrer que l’état de santé
a un effet positif sur le taux de croissance et donc que la relation allant de la santé vers la
croissance est aussi à prendre en considération. Plus généralement, la contribution du secteur
de la santé à la croissance économique passe principalement, mais pas uniquement, par deux
effets : l’effet de l’amélioration de l’état de santé général de la population et l’effet des
activités de R&D du secteur de la santé.
Bien que la question de l’effet de la santé sur la productivité des individus ait été
étudiée depuis le début des années 70, avec notamment le modèle précurseur de Grossman
(1972)
1
, cette question n’a été que peu abordée à un niveau macroéconomique pour les pays
développés. L’étude et la mise en avant de cette relation positive au niveau macroéconomique
ont en effet longtemps été cantonnées aux pays en développement (PVD), pour lesquels les
enjeux de santé publique sont importants. Si pour les PVD cette relation positive est
largement admise, pour les pays développés la question reste posée. L’état de santé dans les
pays développés a atteint un niveau relativement élevé et par conséquent, sous l’hypothèse de
rendements marginaux décroissants de la santé, l’effet positif d’une amélioration de l’état de
santé sur la croissance peut être considéré comme relativement faible. Avec cette analyse en
termes de rendements marginaux décroissants, il peut même exister un niveau d’état de santé
général de la population au-delà duquel les bénéfices de son amélioration ne compensent pas
les coûts de cette amélioration, on sera alors en présence de rendements marginaux négatifs.
Cette vision néglige un point important : l’amélioration de l’état de santé peut élever le taux
de croissance de long terme. En effet, le secteur de la santé à travers les effets sur le capital
humain et sur l’innovation permet d’augmenter le taux de croissance potentiel d’une
économie. Nous avons alors non plus un taux de croissance optimal exogène, mais un taux de
croissance optimal endogène dépendant des efforts de la société en termes de santé.
1
Plus récemment, Sanso et Aisa (2006) ont développé un modèle d’équilibre général dynamique semblable à un
modèle de croissance endogène classique, mais où le processus permanent d’accumulation de capital humain à
travers l’éducation est remplacé par l’accumulation de connaissances médicales motivée par la lutte contre la
détérioration biologique des individus. La recherche médicale devient alors par son effet indirect sur l’état de
santé (et donc sur la productivité) le moteur de la croissance.

4
Ce dernier effet positif peut alors contrebalancer l’effet négatif des rendements marginaux
décroissants et justifier l’amélioration continue de l’état de santé de la population. Cependant,
peu d’études empiriques ont réussi à démontrer l’effet de la santé sur la croissance dans les
pays développés.
Pour apporter des éléments de réponse à ce débat, cette synthèse de la littérature se
propose de présenter, dans une première partie, les résultats des travaux concernant les effets
de l’amélioration de l’état de santé sur le taux de croissance en exposant notamment les
principaux résultats sur les PVD et ceux centrés plus spécifiquement sur les pays développés.
La seconde partie présentera les travaux centrés sur les activités de R&D dans le secteur de la
santé (en particulier dans l’industrie pharmaceutique) et leur importance pour la croissance
économique.
Encadré 1 : Les études basées sur des analyses de coûts
Les évaluations des gains de la santé sur l’économie peuvent reposer sur des analyses de
coûts de la maladie
2
(coûts directs du traitement et coûts indirects liés aux pertes de
productivité sur le marché du travail notamment) ou de l’économie du bien être dont les
travaux visent à quantifier la valeur monétaire des améliorations de l’état de santé par
l’approche en termes de « consentement à payer »
3
. Ce consentement peut être estimé soit à
partir d’enquêtes auprès de personnes, soit à partir de la méthode des prix hédoniques afin
d’estimer la valeur d’une année de vie statistique supplémentaire. Cette valeur de la vie
statistique peut ensuite être appliquée à la valorisation monétaire (en % du PIB, par exemple)
des baisses dans les indicateurs de mortalité et/ou de morbidité, en termes d’années de vie
ajustées par la qualité, ou QUALYs. Ensuite, dans le cadre des analyses coût-efficacité (ou
coûts-bénéfice) utilisées dans le domaine de la santé
4
, le coût des traitements ou interventions
est mis en balance avec les résultats, exprimés par exemple en années de vie gagnées ou de
cas prévenus, dépistés ou guéris. Afin de déterminer si les gains obtenus valent les dépenses
engagées et d’effectuer des arbitrages entre les différentes affectations possibles des fonds
publics, il est courant d’attribuer une valeur monétaire à une vie « anonyme » (statistique), et
ce en dehors de toute considération productiviste.
2
Voir par exemple Ross (2004) pour une évaluation du coût du tabagisme dans l’UE à 25 ou encore Amalric, dir
(2007) pour le coût du cancer en France.
3
Murphy et Topel (2006), par exemple
4
Voir par exemple, Cutler et McClellan (2001)

5
Au-delà des méfiances éthiques que peut engendrer cette approche, c’est comme le souligne
Dormont (2009), le seul moyen de rendre visibles les bénéfices liés aux dépenses de santé et
de dégager des critères clairs et explicites pour les décisions publiques (Kocoglu et De
Albuquerque David, 2009 pour une revue de ces études). Ainsi par exemple, Cutler et
McClellan (2001) estiment monétairement (à partir d’une valeur statistique d’une année de
vie de $ 100 000) le bénéfice en QUALYs de l’introduction d’une nouvelle opération de la
cataracte à $ 95 000, alors que celle-ci n’a augmenté le coût de l’opération traditionnelle que
de $ 3 000 (rendement de plus de 31 pour 1 !).
De même, les études en termes de « plein revenu »
5
, cherchant à saisir la valeur
monétaire des réductions de la mortalité, donnent des résultats illustratifs de cette importance,
alors même qu’elles ne tiennent pas compte des gains de bien-être obtenus grâce à la
morbidité réduite qui accompagne en général la réduction de la mortalité. Ainsi, Suhrcke et al
(2008), estiment à partir de fonctions d’utilité pour deux individus hypothétiques (méthode
développée par Nordhaus, 2003), que dans les pays d’Europe occidentale, la valeur de
l’allongement annuel moyen de la vie entre 1970 et 2003, représenterait entre 29% (Espagne)
et 38% (Turquie) du PIB par habitant de 2003 et varierait selon le pays, tout en dépassant
largement les dépenses nationales de santé annuelles de chaque pays
6
.
I. Etat de santé et croissance
La relation entre état de santé et croissance dans les analyses macroéconomiques
trouve sa justification dans les travaux microéconomiques montrant le lien entre état de santé
et offre de travail (quantité et productivité) d’une part et entre état de santé et capital humain
d’autre part (cf. encadré 3). L’état de santé peut alors être introduit dans la fonction de
production agrégée comme un élément important de la croissance. Implicitement, ces modèles
macroéconomiques supposent que l’état de santé est le résultat d’investissements dans le
secteur de la santé. Il existerait alors une fonction de production qui aurait pour output l’état
de santé et pour input les ressources du secteur de la santé (en capital, en travail et en
technologies).
5
Ce terme fait référence à la somme de la valeur de la croissance du PIB et de la valeur des années d’espérance
de vie gagnées.
6
Les gains d’espérance de vie s’expliquent néanmoins aussi par de nombreux facteurs autres que ceux
déterminés par les dépenses de santé et les interventions en faveur de la santé (cf. infra). Néanmoins, comme le
remarquent Suhrcke et al (2008), la productivité sociale « réelle » des dépenses de santé peut être plusieurs fois
supérieure à celle d’autres formes d’investissement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%