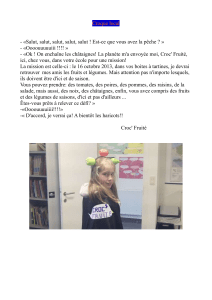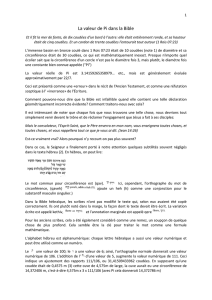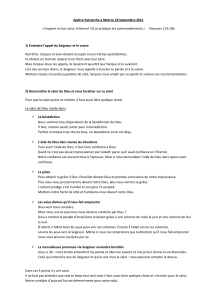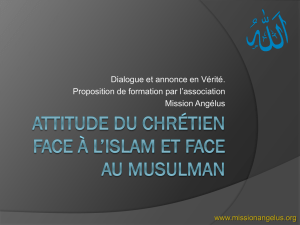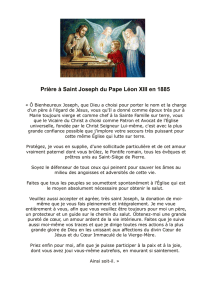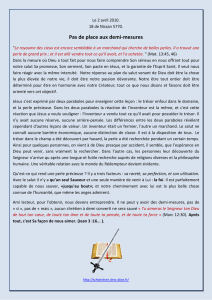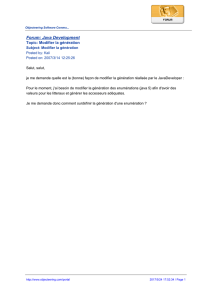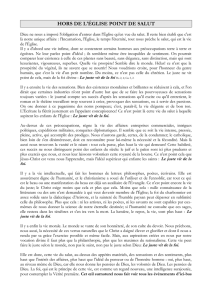Télécharger l`outil - enseignement Catholique

!
Tex te % de s % i nte r ve nt i o n s !

!
Session théologique 26 et 27 août 2013 – Texte des interventions!
"!
"!
Le texte travaillé lors de cette 4e session théologique d’été était le premier chapitre du livre
d’Adolphe Gesché intitulé La destinée (Paris, Cerf, 2004², p. 27-69). Le chapitre, « Topiques de la
question du salut », pose quatre questions distinctes à propos du salut : Sauvés, de quoi ? par
qui ? pour quoi ? à quoi le voit-on ?
« Être sauvé », est-ce l’expression un peu vétuste pour désigner ce qu’on entend aujourd’hui par
« réussir sa vie » ? Les dogmes qui prétendent refléter le message de la révélation sont-ils à la
hauteur de l’espérance chrétienne ? Le salut a-t-il quelque lien, direct ou lointain, au désir qui nous
fait vivre et agir ? Comment le langage de la théologie croise-t-il les autres discours ?
Cette formation était organisée sous la responsabilité de B. Bourgine et P. Scolas, professeurs en
théologie dogmatique.
Les objectifs en étaient :
• initier au langage de la théologie par la pratique.
• comprendre l’apport de la théologie à une question particulière, et par là mieux percevoir la
nature et les possibilités d’une réflexion théologique.
• exercer la capacité de lecture de textes théologiques fondamentaux ;
• apprendre à élaborer une problématique théologique et à en saisir les enjeux ;
• approfondir la réflexion théologique sur le thème de l'engendrement de la foi.
TABLE DES MATIÈRES
1. Benoît Bourgine : Introduction à la session 2
2. Paul Scolas : Du bon usage du dogme. Quelques suggestions 3
3. Benoît Bourgine : Le langage de la théologie parmi les autres langages 9
4. Jean-Pol Gallez : Sauvés, mais de quoi ? 14
5. Paulo Rodrigues : Sauvés, mais par qui ? 21
6. Dominique Martens : Sauvés, mais pour quoi ? 29
Faculté de théologie
Collège Albert Descamps,
Grand-Place 45 bte L3.01.01,
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tél: +32 (0)10/47.36.04
http://www.uclouvain.be/teco.html

!
© U.C.L. Faculté de théologie (Prof. B. Bourgine)!
#!
À QUOI BON LE SALUT ?
LECTURE D'ADOLPHE GESCHÉ
Session théologique 26 et 27 août 2013 Faculté de théologie
« Topiques de la question du salut »
dans Adolphe GESCHÉ, La destinée, Paris, Cerf, 2004², p. 27-69.
!
!
!
!
!
!"#$%&'(#)%"*+*,-*./..)%"*
Benoît'Bourgine'
!
$%&! '()*%+&! &%! ,&-.! )&'/0!1! -%&! *%)23,-4)*3%! 5+%+2(6&! /23/30+&! /(2! 7(-6! 8436(0! &)! '3*9':'&!;!
/-*0!-%&!/2&'*<2&!&./+2*&%4&!,&!6&4)-2&!,(%0!4&)!(-,*)3*2&=!!
>&0!)23*0!(-)2&0!,&'*9?3-2%+&0!0&!,+23-6&23%)!43''&!*6!&0)!,@-0(5&!/3-2!6&0!0&00*3%0!,&!)A+3635*&!1!
6&4)-2&! &%! ()&6*&20! (/2<0! -%&! 43-2)&! *%)23,-4)*3%! &)! (B(%)! -%&! 2&/2*0&! ,(%0! -%! &./30+!
,@(//23C3%,*00&'&%)=!
D%!B3-0!/23/30&!,3%4!,@(E32,!-%&!2+C6&.*3%!F!,&-.!B3*.!0-2!6(!)A+3635*&G!0-2!6(!C32'&!/-*0!0-2!6&!
43%)&%-!1! "H! 6(! C32'&!1! &0)94&! I-&! 6(! )A+3635*&! (! 0(! /6(4&! /(2'*! 6&0! ,*043-20! &%! B*5-&-2!,(%0! 6(!
034*+)+J!#H!6&!43%)&%-!1!,&!I-3*!/(26&9)9&66&!J!K3''&%)!2+0-'&2!4&!I-@&66&!(!,*2&!J!
K3''&%4&2! /(2! -%&! *%)23,-4)*3%! -%! /&-! ex# cathedra!&0)! -%&! *%%3B()*3%=! 73-2I-3*!J! D%! (! 6&!
0&%)*'&%)! I-&! 6&! C300+! 0@+6(25*)! )3-?3-20! /6-0! &%)2&G! ,@-%&! /(2)G! 6@&./+2*&%4&! I-&! %3-0! C(*03%0! ,-!
'3%,&!L!-%!'3%,&!&%!+B36-)*3%!(44+6+2+&!L!&)G!,@(-)2&!/(2)G!6&0!'3)0!I-*!/32)&%)!6(!C3*!(-!6(%5(5&=!
K&!C300+!&0)!03-24&!,&!'(6(*0&G!,@A+0*)()*3%G!B3*2&!,&!'-)*0'&=!D%!0&!,&'(%,&!':'&!0@*6!&0)!6+5*)*'&!
,&!/23%3%4&2!6&0!'3)0!,&!6(!C3*=!D%!(!/&-2!,&!/(26&2G!/(24&!I-@3%!(!/&-2!,&!%&!/(0!:)2&!43'/2*0=!!
D%!B3-,2(*)!,+C&%,2&!4&!'()*%!-%&!)A<0&!0*'/6&!F!/23/30!,&!6(!)A+3635*&!;!4&))&!)A<0&G!6(!B3*4*!1!%3%!
0&-6&'&%)!&66&!(!-%!,*043-20!0&%0+G!I-*!&0)!)3-)!0(-C!,35'()*I-&G!'(*0!&%432&!*6!&0)!-25&%)!,&!6&!C(*2&!
&%)&%,2&=! >(! )A+3635*&! '+2*)&! B3*.! (-! 4A(/*)2&G! 4@&0)! -%! ,*043-20! I-*! /&2'&)! (-.! :)2&0! ,&! 0&!
43%0)2-*2&G!I-*!'3%)2&!6&!4A&'*%!,@-%&!&.*0)&%4&!E&66&!F!B*B2&=!
* *

!
Session théologique 26 et 27 août 2013 – Texte des interventions!
M!
M!
0'*1%"*'.-2/*&'*&%23/*
4'/,5'/.*.'22/.#)%".*
6-',*7(%,-.*
Avant-propos
Je ne veux pas faire de ceci un exposé systématique sur cette question, par ailleurs
intéressante : Qu’est-ce qu’un dogme ?
Cette question a été formulée comme telle et a fait l’objet d’un vrai débat dans le contexte de
la crise moderniste au début du vingtième siècle. Un des protagonistes en était Maurice
Blondel qui a particulièrement bien mis en évidence les enjeux d’une telle question au regard
de la modernité. Il y a au moins deux aspects importants à cette question. D’abord celle du
fonctionnement du dogme : s’agit-il d’un fonctionnement purement autoritaire ? Dieu,
l’Eglise, imposeraient de croire des vérités inaccessibles à la raison. Ensuite la question de ce
que le dogme donne à connaître de la réalité qu’il est supposé viser : la cerne-t-il ? l’évoque-t-
il seulement ? indique-t-il surtout l’attitude à adopter devant elle ? Ceci pour mettre en
évidence qu’il s’agit d’une question qui touche aux fondements de la foi et, du coup de la
théologie.
Je tiens avant tout à relier cette question à ces deux aspects de notre session que sont d’une
part le théologien que nous allons lire, Adolphe Gesché qui a une manière propre et surtout, à
mes yeux, relevante de se référer aux dogmes et d’autre part la thématique du salut qui est liée
intimement aux dogmes les plus centraux et je dirais volontiers au dogme le plus central du
christianisme.
Introduction
Gesché présente volontiers le travail et la responsabilité de la théologie comme consistant à
retrouver les questions auxquelles répondent les affirmations de la foi qui sont, à ses yeux, en
quelque sorte des réponses à ces questions. Dans l’introduction à son ouvrage La destinée,
dont nous allons lire des extraits, il l’exprime en invitant à revisiter les vieux mots de la foi en
ce qu’ils recèlent de précieux pour aborder les grandes interrogations humaines : « Ne serait-il
pas indiqué qu’avant de tourner la page, un peu trop rapidement peut-être, nous cherchions à
tout le moins à revisiter nos vieux mots ? » (p. 10) ; « Nous avons des mots précieux que nous
n’avons pas le droit de trahir sans en réentendre la cause » (p. 11).
Le grand présupposé qui traverse toute l’œuvre théologique de Gesché, c’est précisément que
ce que la foi confesse tantôt en racontant, tantôt en célébrant, tantôt encore en spéculant ou en
affirmant, cela concerne toujours et au plus haut point les grandes interrogations humaines. Et
la foi ne livre sa vérité qu’en ce lieu-là. Ces interrogations ne sont pas d’abord des
interrogations théoriques - même si elles peuvent et doivent être aussi reprises dans une
réflexion théorique comme le fait la philosophie -, mais des interrogations existentielles et
vitales. Et celles-ci convergent toutes dans la question, pour le coup vitale au plus haut point,
de notre destinée. C’est bien de cela qu’il est question lorsque la foi parle de salut : propter
nos et propter nostram salutem.

!
© U.C.L. Faculté de théologie (Prof. B. Bourgine)!
N!
Ce que Gesché appelle la salutarité constitue dès lors la clé pour, si je puis dire, faire parler la
confession de foi. C’est cette clé que nous voulons mettre en œuvre avec lui dans cette session
à propos du mot salut qui paradoxalement est peut-être celui des mots de la foi qui parle le
moins spontanément de salutarité à des oreilles contemporaines. Ainsi s’exprime l’argument
qui en présente le projet : «Que faire de ce vieux mot de ‘salut’ ? Avec quoi rime-t-il ? Quelle
espérance désigne-t-il ? ‘Être sauvé’, est-ce l’expression un peu vétuste pour désigner ce
qu’on entend aujourd’hui par ‘réussir sa vie’ ? Le salut a-t-il quelque lien, direct ou lointain,
au désir qui nous fait vivre et agir ? Comment regarder avec des yeux neufs la réalité du salut
proposée par le christianisme en tenant compte de la tradition biblique et dogmatique ? » Ce
principe de salutarité vaut-il aussi pour les définitions et affirmations dogmatiques ? Sans
aucun doute à condition d’une part de bien les situer par rapport à la confession vive de la foi
et d’autre part de bien voir ce qu’elles visent fondamentalement. Ce seront les deux points de
mon exposé.
I. Bien situer le dogme par rapport à la confession de foi
• La foi s’exprime d’abord dans une confession qui est un acte de liberté, un
engagement de l’existence, qui fait fond sur une parole à laquelle on donne sa confiance. Le
modèle de cette confession en ce qui concerne la foi chrétienne, c’est la confession de Pierre
à Césarée, confession qui se situe à une charnière de la narration des évangiles synoptiques et
qui est présente autrement dans le quatrième évangile à la fin du discours sur le pain de vie :
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, et
nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » (Jn 6, 68.69) Il ne s’agit pas de l’affirmation
d’une vérité abstraite, on n’est pas dans le registre du langage constatif, mais dans un langage
hautement implicatif qui exprime la reconnaissance de Jésus comme Christ, ce qui engage
l’existence de celui qui reconnaît et confesse. Du reste, il est intéressant de noter que, si d’une
certaine façon, Pierre sait ce qu’il dit (Christ est un mot chargé de sens dans la tradition à
laquelle il appartient), d’une autre manière, il va d’emblée manifester qu’il est loin d’avoir
saisi de la sorte l’identité profonde du Christ Jésus. C’est à tel point que Jésus lui déclarera
très vite après cette juste confession : « Passe derrière moi, Satan ! Tu me fais obstacle, car tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » (Mt 16, 23). Il est intéressant
pour notre réflexion sur le dogme de noter ceci qui n’enlève rien à la vérité de l’engagement
de Pierre lorsqu’il reconnaît Jésus comme Christ. Sa confession est juste et vraie et pourtant il
n’en a pas saisi la portée.
Un autre type ou modèle de la confession de foi chrétienne, c’est la profession de foi
baptismale qui s’enracine dans la foi de la génération apostolique et ouvre au-delà d’elle sur la
tradition. Significativement, elle est précédée d’une renonciation à une certaine voie qui met
en évidence la portée existentielle d’une profession qui est nécessairement conversion,
retournement de vie. Cette profession baptismale est engagement dans un passage, dans une
pâque à la suite du Christ. Il faut noter qu’elle s’exprime déjà de manière structurée en
articulant la confession de Jésus comme Christ et Seigneur avec la foi au Dieu unique et
créateur et l’espérance de la vie éternelle.
La confession est le lieu propre où la foi manifeste sa vérité. Rendre possible la confession de
la foi est aussi le but de tous les modes d’expression de la foi.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%