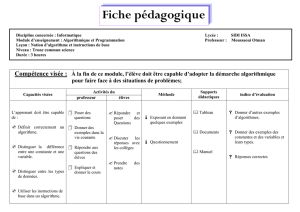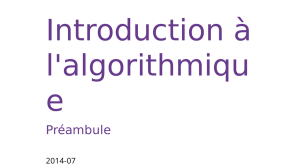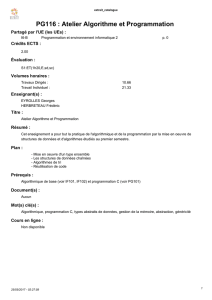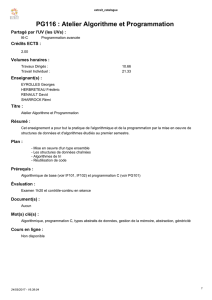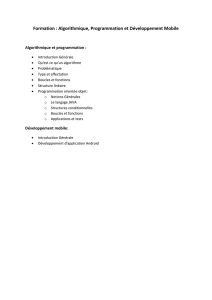Le projet de réforme du droit des contrats : le destin manqué de la

1http://lamyline.lamy.fr
Numéro 117 I Juillet 2015 RLDI I 55
ÉTUDE
Perspectives
Par Luc-Marie AUGAGNEUR
Avocat associé
Lamy & Associés
Le projet de réforme du droit des contrats: le destin
manqué de la transformation numérique
Si le projet de réforme du droit des contrats apporte de nombreux facteurs de sécurité et de
clarification juridique, il aurait pu être vecteur d’innovations, notamment sur les sujets liés au
numérique. Tel est le sens de la présente analyse.
Depuis le 26 février, le ministère de la Justice a soumis à
consultation publique le projet de réforme du droit des
contrats et du régime général des obligations juridiques.
Cette réforme en germe depuis près de 15ans devrait ainsi voir
le jour d’ici à la fin de la mandature. Son objet apparaît contrasté,
voire contradictoire. Dans sa consultation, le ministère souligne à
la fois qu’elle a pour objet de «consacrer dans le code civil des
solutions dégagées depuis plusieurs années par la jurisprudence»,
mais également «de proposer certaines innovations» parce que
«le droit commun des contrats est pour l’essentiel issu du Code
Napoléon de 1804».
Entre la consolidation par codification et la véritable réforme nova-
trice (son intitulé), le texte prétend à l’équilibre raisonnable, ni sub-
versif, ni immobiliste. Mais, à forcer le compromis de l’ambition, le
projet ne risque-t-il pas de passer à côté d’un destin au moment où
le monde est en train de changer de façon décisive?
La présentation de la consultation mesure l’enjeu que représente
la matière. Elle rappelle que le contrat constitue «le fondement
des échanges économiques» et constate que cet instrument, utili-
sé au quotidien par les citoyens et les acteurs économiques, n’est
plus adapté à la réalité des échanges, ni à la réalité de l’activité
sociale et économique. Aussi lecteurs et commentateurs pour-
raient-ils s’attendre à y trouver, sinon une rupture idéologique, du
moins une transformation paradigmatique.
Que trouve-t-on dans l’intention novatrice? Selon la chancelle-
rie des mesures «destinées notamment à renforcer la protection
de la partie faible au contrat». La donnée nouvelle consisterait à
devoir saisir le phénomène de force des rapports économiques.
On contestera difficilement l’intérêt de cet enjeu tant il est vrai
que, depuis1804, la concentration de la puissance économique
a conduit les États à organiser la régulation économique des rap-
ports entre les opérateurs et a vu l’émergence spectaculaire du
droit de la concurrence. Ou plutôt «des» droits de la concurrence.
Car, dans le droit français en particulier, s’est détaché un rameau
du droit de la concurrence qui est celui des « pratiques restric-
tives» destiné à réprimer les pratiques qui sont à la fois réputées
en soi néfastes, pour le libre jeu de la concurrence, et attentatoires
à la loyauté des relations économiques. Cette branche du droit
a connu un succès tel qu’elle déborde le droit des contrats et lui
dispute largement la prééminence. À tel point que les praticiens
savent qu’une bonne partie des enjeux contractuels ont migré vers
le droit des relations commerciales, c’est-à-dire dans le titreIV du
livreIV du Code de commerce qui a pour objet la transparence
et l’équilibre de ces rapports. Et ce droit de se rendre de plus en
plus autonome en affirmant que la notion de «relation commer-
ciale» ne se réduit pas à sa dimension contractuelle, qu’elle est
plus large, qu’elle est économique
(1)
.
La réforme du droit des contrats envisage ainsi de faire entrer la ré-
gulation du rapport de force, disséminé dans les branches du droit
économique que sont le droit de la concurrence et le droit de la
consommation, dans le giron matriciel du droit des obligations. Le
projet emprunte d’ailleurs à ces droits des concepts qu’ils ont for-
gés: pour l’existence de l’accord, c’est la consécration des condi-
tions générales dans le nouvel article1120, pour le vice du consen-
tement, c’est le cas de l’abus de dépendance économique dans le
nouvel article1142, pour le contrôle du contenu, c’est la généralisa-
tion du mécanisme de l’éradication des clauses abusives…
Sous le motif d’une intelligibilité d’un droit essaimé, le projet se
présente aussi comme une forme de concurrence corpusculaire vi-
sant à réaffirmer la place du noyau civiliste de la théorie générale
du contrat et des obligations.
Mais, le phénomène de force est-il la si grande nouveauté qu’il y
paraît depuis 1804? Pas tant que cela à regarder l’histoire écono-
mique. Fernand Braudel ou Jacques LeGoff par exemple n’ont
(1) Rapport de la Cour de cassation2008, voir AugagneurL.-M., L’antici-
pation raisonnable des relations commerciales, JCPE2009.
ÎRLDI 3803

1http://lamyline.lamy.fr
56 I RLDI Numéro 117 I Juillet 2015
cessé de décrire comment, dans le commerce au loin des mar-
chands-banquiers à partir du XIII
e
siècle, ou dans les relations entre
les centres économiques et leur périphérie (notamment par les
rapports de façonnage
(2)
), l’échange s’est longuement inscrit dans
l’asymétrie de puissance économique et d’information.
D’ailleurs, les nombreux efforts du législateur (les lois succes-
sives «Galland», «NRE», «PME», «LME», «Hamon»), de la
jurisprudence (les usages de la théorie de la cause pour écarter
des clauses excessives) et de la doctrine (théorie solidariste, etc.)
montrent que le déséquilibre n’est pas nouvellement appréhendé.
Pourtant, les rapports économiques ne manquent pas de nou-
veauté. Et c’est à cette transformation qui se réalise sous nos yeux
–celle de l’information numérique– que le législateur se trouve
indifférent.
Pour quelle raison ? Peut-être parce que, si le droit est omni-
présent, il est utilisé par tous sans que les juristes n’en aient ni le
monopole ni la maîtrise, et c’est tant mieux. Mais, en se vulgari-
sant, le droit se banalise, il devient un instrument technique parmi
d’autres. Il perd en partie de son exigence scientifique, de sa vision
philosophique et de sa portée politique. Alors, dans la transforma-
tion numérique, il suit comme il peut, mais il devance rarement.
La réforme du droit des contrats ne saisit pas ce phénomène. Elle
n’y renonce pas, elle y est aveugle.
Michel Serres
(3)
a souligné qu’à l’occasion de chaque révolution
portant sur le couplage entre un message et son support, il s’est
produit, comme par réplique, d’autres révolutions dans le domaine
du droit, de la politique, de l’économie mais aussi des sciences et
des religions. Ainsi l’invention de l’écriture est également celle du
Code d’Hammourabi, de la monnaie et de la cité. Quant à l’impri-
merie, elle s’accompagne de l’invention des instruments de com-
merce, de crédit, de banque et de comptabilité. Elle est contem-
poraine de la société-monde et de la naissance du capitalisme.
La nouvelle révolution que constitue l’information numérique,
qui porte elle aussi sur le couplage entre une information et son
support, appelle aussi, nous dit MichelSerres, une révolution du
même ordre dans ces domaines.
Sous cette perspective, l’enjeu de la réforme du droit des contrats
est peut-être tant ce qui s’y trouve que ce qu’il ne s’y trouve pas.
Au plan herméneutique, le projet éprouve un effort de résistance
du droit savant quand nous savons la force à laquelle le soumettra
la société numérique(I). Au plan substantiel, il omet d’appréhen-
der l’évolution de la circulation de valeur, passant de la transmis-
sion matérielle, exclusive et rivale, à la contribution immatérielle et
collaborative(II).
I.–LA FIN DU DROIT SAVANT
Le projet de réforme du droit des contrats s’assigne notamment
pour objectif de moderniser les concepts et d’en proposer de nou-
veaux. Le plus édifiant des débats porte sur celui de la notion de
(2) Voir AugagneurL.-M., Quelle réforme pour la sous-traitance?, RLDA.
(3) SerresM., Conférence à l’Inria, 11déc. 2007.
«cause ». «Instrument de régulation»
(4)
souple capable de tra-
verser les âges pour les uns, «auberge espagnole»
(5)
, inutile et
dangereuse, des débiteurs récalcitrants pour les autres, la cause
se trouve ostracisée par le projet pour avoir régné trop tyrannique-
ment sur les esprits fertiles des juristes.
À l’inverse, d’autres termes, qui ne manquent pas de souffle, fe-
raient leur entrée. Ainsi du «mal considérable» qui deviendrait,
dans le nouvel article1139, celui dont la crainte causerait une vio-
lence propre à vicier le consentement.
D’autres termes classiques sont contenus, par crainte d’être dilués
comme la cause. C’est le cas de la «réticence dolosive». Le nouvel
article1136 la limite à la «dissimulation» (intentionnelle), terme
que l’on sait lui-même ouvert aux vastes interprétations, des infor-
mations dont la fourniture est légalement prévue.
Enfin, des termes mythiques du droit traversent les frontières de
ses branches. L’« imprévision » connue du droit public entrerait
dans le droit privé. Mais la science sait qu’un corps entré dans un
environnement nouveau se trouve généralement modifié et subit
souvent des mutations qui transforment sa génétique.
On croit qu’en modifiant les mots, on est capables de maîtriser leur
destin prescriptif. Mais les mots du droit sont davantage comme
ceux de la poésie
(6)
que les termes d’une équation: ils échappent
à leur auteur, à l’intention. Cela est plus spécialement vrai dans le
contexte de la transformation numérique où tout savoir se trouve
facilement accessible et partagé par les facilités de communica-
tion.
Dans la codification justinienne, pour établir une loi claire, épurée
des interprétations anciennes, il a fallu –dit-on– détruire les ou-
vrages du droit ancien afin que ceux-ci ne pénètrent pas le droit
nouveau. La tabula rasa est une source possible de renouveau
maîtrisé. Dans sa nouvelle LeCongrès, où le narrateur poursuit le
projet insensé de rassembler tout le savoir pour finalement s’avi-
ser de l’aopie de l’entreprise, Jorge Luis Borgès conclut : « de
temps à autres il faut bruler la bibliothèque d’Alexandrie». C’est
ce que fit Justinien pour imposer son droit et c’est ce qui opposa
AndréAlciat aux juristes de son temps
(7)
pour décider si Justinien
avait fait œuvre salutaire ou commis un crime contre le génie des
jurisconsultes romains.
Dans la codification napoléonienne, l’intention se maîtrisait à l’in-
verse par l’élévation des travaux préparatoires (et la doctrine sur
laquelle elle reposait, notamment Domat et Pothier) au rang de
méta-droit, de source téléologique d’interprétation.
Mais, dans les deux cas, la science juridique était, comme les
autres disciplines scientifiques, l’apanage des savants, et au moins
des «sachants».
Mais le droit, pas plus que les autres disciplines, n’est plus désor-
mais savant. Il est «expert» certes, mais plus savant. Dans la révo-
(4) MazeaudD., Pour que survive la cause en dépit de la réforme!, Dr.
&patr., oct.2014, p.38.
(5) AynèsL., La cause, inutile et dangereuse, Dr. &patr., oct.2014, p.40.
(6) La vitalité du mouvement Droit et Littérature en est le témoin.
(7) AtiasC., Aux origines obscures du droit civil français, André Alciat
(1492-1550), RTDciv.2005.

ÉTUDE
Perspectives
1http://lamyline.lamy.fr
Numéro 117 I Juillet 2015 RLDI I 57
lution numérique, tout circule, collabore, s’échange, s’influence, se
coconstruit, en permanence. Le savoir devient «viral et métalep-
tique». Pas d’interprétation officielle, d’ailleurs parce que le projet
de réforme ne sera pas soumis au débat parlementaire. Pas non
plus de figure inspiratrice unique, puisque plusieurs avant-projets
doctrinaux se sont succédé.
Les mots du nouveau texte vivront leur vie. Les uns seront délais-
sés, lettre morte, d’autres au contraire seront saisis de convulsions
judiciaires. Nul ne sait leur destin en droit positif. Mais l’ouverture
des possibilités dans les mains des juristes va laisser se développer
une culture incontrôlable.
De ce contexte numérique, on comprend que le droit et son in-
terprétation ne peuvent rester les mêmes. Dans une récente in-
terview
(8)
, le célèbre psychanalyste SergeTisseron revenait sur les
caractères de l’évolution vers une culture numérique. Selon lui, la
culture du livre est celle de l’unique (un auteur pour un lecteur),
du linéaire et du vertical. Le savoir y est permanent et encyclopé-
dique.
Sans en reprendre les différentes expressions, la culture numé-
rique est celle de la pluralité, de la circularité et de l’horizontalité.
Les identités sont multiples (avatars ou au contraire usurpations
d’identité), la création est collaborative (type Wikipédia).
Notre droit repose sur une culture du livre. Le Code civil se conçoit
à l’image de la Bible. Le savoir y est ordonnancé et la loi délivrée
par le législateur comme elle est octroyée par un dieu. Chaque
bien identifié a un seul propriétaire. L’Administration procède à
l’enregistrement chronologique des propriétaires et des événe-
ments qui concernent chaque individu unique (état civil, conser-
vation des hypothèques, registre du commerce, etc.). Le droit des
obligations pouvait s’emparer de cette mutation.
II.–LA CIRCULATION ET LA VOLONTÉ
A.–La circulation de la valeur immatérielle
Le projet de réforme du droit des contrats confirme et consolide
l’architecture traditionnelle de l’échange contractuel. Il reprend
les catégories classiques de contrat : onéreux/gratuit; synallag-
matique/unilatéral ; commutatif/aléatoire. Ces distinctions nous
paraissent relever de l’évidence. Elles sont en fait le fruit d’une his-
toire et d’une conception des échanges.
L’échange synallagmatique onéreux est en particulier profondé-
ment marqué par la propriété rivale. Le propriétaire du bien ou
l’auteur de la prestation n’accepte de se déposséder que par ce
qu’il reçoit en retour.
De la même manière, l’objet de cet échange est empreint d’une
certaine conception des rapports. La rédaction du projet de ré-
forme met en évidence une utilisation de plus en plus générali-
sée de la notion de «prestation». Or le terme trouve son origine
dans un acte féodal d’engagement entre un vassal et un suzerain.
Il est étymologiquement une « prestation de serment» (praes-
tarefidem) qui en fait un acte de foi et d’allégeance. Les parties se
tiennent par un lien mystique qui scelle un abandon de leur liberté.
(8) <www.culturemobile.net/visions/serge-tisseron-culture-numerique>.
Le rapport contractuel apparaît ainsi comme une forme de contri-
tion difficilement compatible avec un modèle collaboratif.
Ces mécanismes traditionnels de scellement des liens, de rapport
de force et de circulation par l’échange sont parfaitement adaptés
à une forme économique qui a été la nôtre.
Dans sa forme consécutive à l’exploitation des ressources ter-
restres, l’économie a décentré sa création de richesse vers
l’échange marchand. Comme le montre notamment FernandBrau-
del, dès le XII
e
siècle, progressera sans discontinuer un mouvement
dans lequel la circulation des marchandises, puis celle de la mon-
naie, est un facteur d’accumulation du capital. C’est l’habileté de
la circulation qui constitua les fortunes des négociants-banquiers,
notamment dans leur capacité à éloigner les lieux de production
des lieux de consommation. Cet éloignement créa une opacité
(privatemarket) qui permit d’accroître les marges. Dans cette éco-
nomie de l’échange marchand, l’essentiel consiste à encadrer l’ins-
trument de la circulation, c’est-à-dire le contrat, et notamment le
contrat de vente qui domine presque tous les autres. Le droit civil
s’est donc concentré pour offrir le cadre matriciel le plus sécurisant
à la vie du contrat (formation, exécution, résiliation).
Dans le même temps, l’un des grands enjeux du droit a consisté
à appréhender les situations aléatoires en assurant la répartition
des risques. L’introduction du profit comme récompense du risque
n’avait d’ailleurs pas sans être une complexe évolution juridique
(9)
.
Au Moyen Âge, la religion prohibait en effet toute spéculation.
Un contrat retrouvé dans une abbaye cistercienne, daté de1193,
montre pour la première fois l’usage du terme «resicum
(10)
» pour
conditionner une vente fictive destinée à gager un prêt. Cette
utilisation permet ainsi de distinguer le risque-profit de la fortuna
romaine (providence divine) et du periculum (cas fortuit). Elle dé-
signe un aléa ou une renonciation à un gain (lucrumcessans) assu-
mée financièrement par l’un des contractants. Elle peut être aussi
la récompense du travail (stipendiumlaboris).
C’est encore sur une partie de ces fondements que repose le droit
actuel des obligations en faisant une place centrale aux contrats
aléatoires/commutatifs, repris dans le projet de réforme sans in-
terrogation.
Si la primauté de l’échange a longtemps prévalu, y compris dans
l’économie industrielle, qui a appelé d’autres défis juridiques, ses
caractères se modifient radicalement dans l’économie numérique.
À la logique verticale de la chaîne de distribution (producteur
–importateur –grossiste –détaillant –consommateur) se substi-
tue une économie à la fois plus circulaire et plus horizontale. Les
deux grands phénomènes qu’on y observe sont ceux d’un «âge
de l’accès» selon les termes de JeremyRifkin (L’Âge de l’accès:
la nouvelle culture du capitalisme, 2005), et de «l’âge de la multi-
tude» selon les termes de NicolasColin et d’HenriVerdier (L’Âge
de la multitude, entreprendre et gouverner après la révolution nu-
mérique, 2012).
(9) Piron S., L’apparition du resicum en Méditerranée occidentale,
XIIe-XIIIe siècles, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/do-
cid/37666/filename/apparition_du_resicum.pdf>.
(10) «Resicum», de l’arabe «rizq» : part de bien que Dieu attribue à
chaque homme, chance.

1http://lamyline.lamy.fr
58 I RLDI Numéro 117 I Juillet 2015
Par l’accès, l’utilisateur n’achète plus un bien, mais une expérience,
un service; plus une voiture mais du transport; plus un téléphone
ou un ordinateur mais de la communication. Ce phénomène induit
une modification majeure dans la conception du droit puisque la
circulation de valeur n’est plus portée par la vente mais par l’usage.
Par la multitude, il faut comprendre une économie de plate-forme.
Dans ce modèle, la plate-forme met à disposition un outil capable
de capter les externalités positives. Des opérateurs viennent créer
des applications à cette plate-forme, en sorte que se constitue
un écosystème horizontal de complémentarité économique, plu-
tôt que de rivalité stricte. Ce système de symbiose, dont la per-
formance repose sur la spécialité de chacun, implique là encore
de distribuer adéquatement le partage de revenus. Sans vecteur
juridique sécurisé, il risque de se développer des stratégies ago-
nistiques et de prédation mal encadrées. Le risque juridique dé-
courage ou même anéantit les applications ou les plates-formes
pourtant innovantes.
Ajoutons que, dans l’économie numérique, l’objet de la circulation
n’est plus seulement le bien ou le service principal, mais les don-
nées personnelles représentatives d’un potentiel de chiffre d’af-
faires. Or, ces données ont une nature hybride. Elles ont à la fois
une valeur patrimoniale pour le professionnel et un caractère de
liberté individuelle extrapatrimoniale pour le sujet de la donnée.
Cette absence apparente d’antagonisme est néanmoins l’objet
d’une insécurité juridique. Par un statut protéiforme, les données
personnelles s’avèrent finalement être un vecteur instable de cir-
culation de valeur. Les tribunaux peuvent notamment considérer
qu’elles ont une faible valeur, ce qui encourage prédation et op-
portunisme comme le montrent les nombreux exemples de cap-
tation sauvage.
Ces schémas qui déplacent la valeur dans de nouveaux méca-
nismes d’échange et dans de nouveaux vecteurs ont donc besoin
d’une adaptation du droit. Si la règle ne sait pas correctement dis-
tribuer et protéger les transactions sous-jacentes, elle risque de
faire obstacle à la correcte monétisation des objets de négocia-
tion. C’est la raison pour laquelle il faut savoir trouver une nature
suigeneris aux données personnelles. Il faut réussir à répartir les
droits respectifs (pouvoirs et bénéfices) des opérateurs qui intera-
gissent sur un espace qu’ils ont intérêt à utiliser en commun. D’où
la résurgence de la théorie des communs notamment dans les
travaux du prix Nobel d’économie ElinorOstrom. La logique pro-
prio-centrique pourrait être partiellement abandonnée pour régir
des plates-formes et infrastructures communes. La prééminence
de la commutativité, ou en tout cas la dichotomie commutatif/
aléatoire, doit être revue pour suivre la création de valeur décalée
dans une économie numérique collaborative où l’émetteur ne sait
pas toujours par avance ce qu’il recevra en retour.
Les droits archaïques ou anciens ont déjà connu des mécanismes
qui nous paraissent être déstructurées par rapport au couple pro-
priété/vente commutative qui domine notre économie. Ainsi le po-
tlatch des tribus d’Amérique du Nord popularisé par MarcelMauss
connaît-il le don avec un espoir de retour. De même, le partage
des droits sur l’eau dans la Dombes, en distinguant l’assèchement
et l’évolage, permettait-il de séparer la propriété du sol de la pro-
priété de l’eau en organisant sa circulation entre des propriétaires
voisins, ce qui est une forme d’organisation juridique d’un bien
commun.
La réforme du droit des contrats aurait donc pu anticiper les nou-
veaux mécanismes de circulation et devrait être regardée en paral-
lèle d’une réforme du droit des biens.
B.–L’algorithme, la volonté et la prévision
Le projet de réforme – ou plus exactement de consolidation –
du droit des contrats vise à réaffirmer la valeur de l’intégrité du
consentement et de l’expression de la volonté individuelle.
La décision éclairée est d’ailleurs au cœur des préoccupations du
texte puisque celui-ci vise notamment à lutter contre les rapports
déséquilibrés (dépendance économique, clauses abusives, modi-
fication de l’économie du contrat par l’admission de la théorie de
l’imprévision).
Ce faisant, le projet ne prend pas en considération les probléma-
tiques mises en évidence par l’économie numérique en matière
de volonté (initiale et poursuivie, c’est-à-dire d’anticipation écono-
mique). Or, les algorithmes constituent un phénomène incontour-
nable, au point que certains auteurs évoquent une «algorithmisa-
tion» du monde.
Au stade de la formation des contrats. Traditionnellement, le vice
du consentement est apprécié du point de vue d’une «victime du
consensualisme» dont l’expression de volonté pourrait être trom-
pée ou forcée. Au contraire, sous l’angle algorithmique, le vice du
consentement est celui de la partie forte. Dans cette perspective,
le problème est surtout celui du refus de contracter opposé par
une personne sur la base d’une aide à la décision procurée par
un système de traitement informatisé de données, c’est-à-dire un
algorithme prédictif. L’exemple topique est celui de la compa-
gnie d’assurances ou de l’établissement bancaire qui, à partir des
données du profil du demandeur à une couverture de risque ou
à un emprunt, se voitopposer un rejet en raison du risque qu’il
représente. Plus généralement, c’est la qualité ou le contenu du
consentement algorithmique qui pourrait être en cause. On pour-
rait ranger dans cette catégorie la définition d’une offre de prix
d’un service en fonction des données disponibles ou fournies par
le candidat contractant (yieldpricing). À partir d’une modélisation
des données accumulées à grande échelle, un algorithme définit
un profil du contractant, un niveau de risque ou un potentiel mar-
chand adapté qui détermine l’acceptation ou non du contrat ou les
conditions de celui-ci.
La modélisation calculatoire et la méthode sur laquelle elle repose
ont à l’évidence des conséquences déterminantes sur la conclu-
sion d’un contrat et sur le rapport économique qu’il va instaurer,
c’est-à-dire sur le consentement. L’intégrité du consentement est
donc susceptible de dépendre de celle de l’algorithme qui le dé-
termine en partie.
L’ordre public du droit des contrats est susceptible d’interve-
nir dans ce processus pour limiter la liberté des parties, ne se-
rait-ce que pour définir le curseur de différenciation acceptable.
Se trouvent ici en contradiction, d’une part, l’individualisation de
la transaction qui a vocation à être un facteur d’efficacité écono-
mique pure, même s’il peut altérer un facteur de mutualisation des
risques qui concourt de son côté au bien-être économique collectif
et, d’autre part, l’exigence morale de non-discrimination.

ÉTUDE
Perspectives
1http://lamyline.lamy.fr
Numéro 117 I Juillet 2015 RLDI I 59
Les spécialistes de la gouvernance des algorithmes
(11)
, dont les
travaux sont d’ailleurs synthétisés par le rapport du Conseil d’État
relatif aux droits fondamentaux dans la sphère numérique
(12)
, sou-
lignent que la protection de la partie faible implique notamment:
i)une vérification d’une intervention humaine suffisante préalable
à la décision prise à l’aide d’un algorithme prédictif (ce que la
loi «Informatique et libertés» de 1978
(13)
prévoit déjà, mais qui
pourrait avoir une vocation plus centrale dans le corpus du droit
des contrats); ii)un droit de vérifier la pertinence de l’algorithme
(transparence et reverse engineering), iii) un droit de discussion
contradictoire de la prédiction algorithmique, et peut-être par né-
gatif une forme de devoir de négociation de bonne foi pour l’autre
partie ne donnant pas un avantage excessif au système de trai-
tement informatisé; iv)un droit à la vérification de la pertinence
de la collecte et de la formatation des données dont est issu le
traitement.
On sait en effet qu’il existe de nombreux facteurs susceptibles de
fausser l’objectivité et la neutralité du processus de prédiction al-
gorithmique, et en particulier la «falsifiabilité» de Popper, les «at-
tracteurs étranges» de Lorenz, la «malédiction de la dimension»
de Bellman, etc.
(14)
La place que pourrait prendre le droit des algorithmes au sein du
droit des contrats constituerait une forme de démocratisation po-
sitive des enjeux numériques et de régulation économique autant
qu’éthique. Elle fixerait aussi la place de la technique et du pou-
voir technologique dans les rapports économiques et sociaux
(15)
.
Le pouvoir d’influence décisionnelle des algorithmes représente
ainsi un défi majeur pour le droit des contrats que la réforme aurait
pu envisager.
Au stade de l’exécution des contrats. Le projet de réforme intro-
duit en droit privé la théorie de l’imprévision et admet l’exception
pour risque d’inexécution. La mise en œuvre de ces notions est évi-
demment affectée par la nouvelle donne prédictive des bigdata.
Le risque d’inexécution peut être démontré par une extrapolation
anticipée de données statistiques sans que de véritables signes
précurseurs de défaillance n’apparaissent. La question est celle du
(11) Par ex., VerdierH., Gouvernement des algorithmes, <www.henriver-
dier.com/2014/10/gouvernement-des-algorithmes-whats-next.html>.
(12) <www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publica-
tions/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2014-Le-numerique-et-les-
droits-fondamentaux>.
(13) Article10 de la loin°78-17 du 6janvier 1978: « Aucune autre dé-
cision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne
peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de
données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains
aspects de sa personnalité.»
(14) InstitutG9+, Bigdata, l’accélérateur d’innovation, Livre blanc, p.50-51.
(15) MorozovE., The rise of data and the death of politics.
standard judiciaire de preuve de l’anticipation. Elle rejoint d’ail-
leurs plus généralement le standard de preuve du lien de causali-
té dans le régime de responsabilité, en ce compris la délimitation
du dommage prévisible. Le risque principal consiste en effet à
substituer un système corrélatif au régime causaliste qui préside à
notre droit. Les auteurs
(16)
soulignent en effet que l’exploitation des
données fait apparaître des corrélations entre certaines situations
indépendamment de toute démonstration scientifique effective
(par exemple, apparition d’un dommage en fonction des signes).
Si le principe causaliste n’est pas remis en cause, les règles d’ap-
préciation souveraine et de présomption peuvent conduire à une
émergence rampante d’une mécanique déductive. La corrélation
apparaît à la fois plus rationnelle, plus rapide et plus efficace que
la connaissance causale.
Il devrait donc appartenir au droit des contrats de fixer un cadre
d’appréciation de la preuve algorithmique qui détermine les situa-
tions et droits contractuels.
De même, la théorie de l’imprévision consiste à permettre d’exi-
ger une renégociation des contrats en cas d’évolution imprévisible
d’une situation économique. Cette preuve de l’imprévisibilité se
rapportera très vraisemblablement et fréquemment à un débat de
modélisation des données et d’anticipation économique. En sorte
que la définition de règles pour la démonstration de la prédictibi-
lité serait bienvenue.
L’ensemble de ces considérations ne doit évidemment pas oc-
culter que le projet de réforme apporte de nombreux facteurs de
sécurité et de clarification juridique. Mais il aurait pu être vecteur
d’innovations, notamment sur les sujets liés au numérique. Sug-
gérer les problématiques ne procure certes pas le succès face à la
gageure. La qualité des choix ouverts, le talent rédactionnel ainsi
que l’équilibre entre l’efficacité économique et la conception mo-
rale en feraient tout le génie. C’est tout ce qu’il resterait à faire.
(16) GuillaudH., Bigdata: nouvelle étape de l’informatisation du monde,
Internetactu, 14mai 2013.
1
/
5
100%