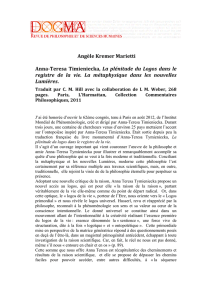Cours de PHILOSOPHIE Support écrit : dernière partie (SE2) 6. L

Joachim LACROSSE
Cours de PHILOSOPHIE
Support écrit : dernière partie (SE2)
6. L’héritage du Logos grec chez les Modernes
(Notes provisoires, novembre 2013)
a) Période de grandes découvertes et d’innovations techniques, marquée notamment par
l'apparition de la Réforme et l'essor de la bourgeoisie (déjà entamé à la fin du moyen âge), la
période que l'on appelle conventionnellement Renaissance est pleine de contradictions. Ainsi,
par exemple, l'humanisme universaliste prôné par certains philosophes semble avoir pour
contrepartie une sorte d'européo-christiano-centrisme : l'Homme mis en valeur par
l'humanisme est blanc, pétri d'hellénisme, capitaliste et rationaliste, mais surtout fils de la
chrétienté, à laquelle sont annexées la Kabbale et l'averroïsme, entre autres, au nom d'une
philosophie universelle.
Pendant la Renaissance, la prise de conscience par l'homme de sa puissance est à la
mesure de celle de sa finitude ; le pragmatisme politique d'un Machiavel y coexiste avec
l'utopisme d'un Thomas More ; l'évangélisme de la Réforme protestante, qui retourne à la
parole, au Verbe (Luther, Calvin) prend son essor, tandis que la scolastique médiévale a
encore de beaux jours devant elle dans les universités ; le rationalisme, d'inspiration
mathématico-scientifique (avec Bacon) est promu, au même titre que la « docte ignorance »
(avec le mysticisme de Nicolas de Cues) ou qu'une nouvelle forme de scepticisme (avec le
fameux « pyrrhonisme » de Montaigne).
Cette période se caractérise aussi par une séparation accrue entre philosophie et
théologie, une promotion des mathématiques comme école de la raison rigoureuse, et un
développement de la méthode expérimentale dans les sciences naturelles :
« Notre plus grande ressource et celle dont nous devons tout espérer, c’est l’étroite alliance
de ces deux facultés : l’expérimentale et la rationnelle, union qui n’a point encore été formée » (F.
Bacon, 1561-1626, Novum Organum, 1, 95).
Sur le plan de la pensée politique, Machiavel (1469-1527) écrit son célèbre Il Principe
(« Le Prince »), manuel de « bonne gouvernance » dédié à un Médicis (Julien, frère du Pape
Léon X), membre de la famille qui dirigeait Florence, dans le contexte d’une Italie divisée en
nombreux duchés et républiques.
Le gouvernant efficace est celui, dit-il, qui arrive à être à la fois craint et aimé.
Promesses non tenues, trahisons et manipulations ne sont pas interdites et même
indispensables, à condition d’avoir l’air de posséder toutes les qualités requises : honnêteté,
sincérité, générosité…
Les deux seules qualités qu’un dirigeant doit réellement posséder sont la chance
(fortuna, sans laquelle on ne peut rien) et la virtù (courage, force et capacité à agir comme il
faut en toutes circonstances). La virtù est tout autre chose que la « vertu » au sens éthique, il
s’agit de tirer profit de toute situation selon le principe « la fin justifie les moyens ».

87
Il s’agit donc d’une approche très pragmatique de la gouvernance : seule compte
l’efficacité, qui résulte d’un savant mélange entre la force du lion et la ruse du renard. Car
l'homme, mélange de bestialité et de noblesse, se situe dans une perspective amorale, pour
ainsi dire en-deçà du bien et du mal.
b) Philosophes « rationalistes »
La modernité radicalise le projet du logos philosophique, celui de dominer le réel, à
travers l’idéal, né avec la Renaissance, d’un être humain maître et possesseur de la nature.
Cette conception de l’homme s’incarne notamment à travers un important courant de
pensée, qualifié de rationaliste parce qu’il s’attache avant tout au pouvoir de la raison
démonstrative et déductive (autonome à la fois par rapport à la révélation religieuse et par
rapport aux données sensibles), qui prend pour modèle l’exercice de la raison mathématique
et dont le siège est l'ingenium (« esprit » en tant que chose du monde la mieux partagée et
caractérisé par son inventivité).
Descartes (1596-1650) fut mathématicien (il a fait la synthèse de l’algèbre et de la
géométrie), scientifique et philosophe. La « méthode » cartésienne, purement rationnelle,
comporte quatre règles énoncées (en français) dans le Discours de la méthode :
a) évidence (ne tenir pour vrai que ce qui est évident de façon claire et distincte, et qui
servira de point de départ à des « chaînes de raisons » comme en font les géomètres)
b) analyse (diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu’il se pourrait)
c) synthèse (partir des objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour aller
vers le plus composé)
d) dénombrements (afin de ne rien omettre).
Au début de ses célèbres Méditations métaphysiques, Descartes cherche donc un
fondement qui pourra servir de point de départ à une longue chaîne de raisons. Ce fondement
ne peut être la sensation, qui produit nombre d’illusions. Certes, à moins d'être fou, je suis
certain d'être ici, d'avoir des mains, mais, en vérité, qu’est-ce qui me prouve de façon claire et
distincte que je ne suis pas en train de rêver ? Cependant, même le rêve s’appuie sur un
espace, des proportions numériques, etc. Certaines choses résistent donc encore à l'hypothèse
du rêve : étendue, figure, grandeur, nombre, temps, lieu... Les mathématiques (arithmétique et

88
géométrie), qui fondent les autres sciences (astronomie, musique, optique, mécanique, etc.),
seraient-elles alors ce fondement recherché pour toute connaissance ? Non, pas encore, car il
faut que ce fondement puisse résister à l’hypothèse du doute de plus en plus intégral
(« hyperbolique »), que Descartes personnifie sous la forme d’un dieu trompeur, non pas le
Dieu souverainement bon du christianisme, mais un « Malin Génie » qui fait en sorte que je
sois systématiquement dans l'erreur chaque fois que je crois être dans le vrai.
Le scepticisme de Descartes n'est ici qu'une étape. Le but de cette hypothèse radicale est
de déterminer, dans la Seconde méditation, si quelque certitude résiste encore au doute
intégral. Et ce qui résiste à l’hypothèse du Malin Génie (car s’il peut me tromper, cela signifie
que je suis indubitablement une chose pensante), c’est le fameux Cogito (ergo sum), « Je
pense (donc je suis) » :
« Il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à
me tromper toujours. Il n’y a donc point de doute que je suis, s’il me trompe ; et qu’il me trompe
tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserai être quelque
chose. […] Je ne suis donc, précisément parlant, qu’une chose qui pense (res cogitans), c’est-à-
dire un esprit (mens) (animus), un entendement (intellectus) ou une raison (ratio), qui sont des
termes dont la signification m’était auparavant inconnue. […] Mais qu’est-ce donc que je suis ?
Une chose qui pense. Qu’est-ce qu’une chose qui pense ? C’est-à-dire une chose qui doute, qui
conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent ». (extraits de
la Seconde méditation métaphysique).
Ce qui résiste à l’hypothèse du Malin Génie et constitue le point de départ de la
connaissance, c’est donc la notion, typiquement moderne, d’une subjectivité pensante ou
conscience. Chez Descartes (contrairement à Spinoza), cette res cogitans (chose pensante) est
une substance indépendante du corps. De façon révélatrice, pour décrire cette substance
pensante, Descartes mobilise simultanément la terminologie latine de la « raison », de
l’« intellect » et de l’« esprit » (mens et animus). En outre, sa définition de la pensée voit large
et laisse la place à des activités de la conscience telles que « sentir » ou « imaginer ». Le sujet,
l'âme en tant que chose pensante, est au carrefour des facultés. A la fin de la seconde
méditation, l'exemple du morceau de cire, dont nous gardons une idée claire et distincte
malgré le changement dont il est affecté, persuade Descartes de l'existence d'objets conçus par
l'esprit, et différents des corps perçus. La cire « toute nue » ne peut être conçue sans un esprit
humain, qui possède ces idées en tant qu'elles sont innées.
La suite des Méditations de Descartes (de la troisième à la sixième) va s’atteler à
connaître le monde entier en prenant pour point de départ cette certitude : l’existence de la
pensée. Il le fera, notamment, en ayant recours à plusieurs variantes de l’argument
ontologique de saint Anselme (voir ci-dessus) :
« Car, ayant accoutumé dans toutes les autres choses de faire la distinction entre l'existence et
l'essence, je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu, et
qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant pas en acte. Mais néanmoins, lorsque j'y pense
avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut pas non plus être séparée de
l'essence de Dieu, que de l'essence d'un triangle rectiligne la grandeur de ses trois angles égaux à
deux droits, ou bien de l'idée d'une montagne l'idée d'une vallée ; en sorte qu'il n'y a pas moins de
répugnace de concevoir un Dieu (c'est-à-dire un être souverainement parfait) auquel manque
l'existence (c'est-à-dire auquel manque quelque perfection), que de concevoir une montagne qui
n'ait point de vallée » (extrait de la Cinquième méditation métaphysique).
Etablir l’existence de Dieu (puis l’existence du monde, garantie par celle de Dieu) n’est
cependant plus le seul but de la philosophie, il s’agit plutôt d’une étape dans un cheminement
qui vise à fonder la connaissance du réel par la seule raison. Et en ce qui concerne l'action, la

89
raison peut livrer les clefs du développement technique, mais pas de la morale. Celle-ci sera
« provisoire » et fondée sur les principes suivants :
a) le respect des lois et les coutumes ;
b) la modération dans les opinions, fermeté dans les actions ;
c) vaincre ses propres inclinations plutôt que l'ordre du monde ;
d) rechercher la vérité et cultiver la raison.
Ce qui est nouveau chez Descartes, on le voit, ce n’est pas tellement la doctrine
philosophique. L’idée d’un Dieu garant de la vérité, l’immortalité de l’âme, séparée du corps,
la séparation entre la substance et l’accident, la maîtrise des passions (parallèle à la maîtrise
technique de la nature) : tout cela est très proche de la scolastique médiévale, et donc loin de
faire « table rase » du passé. C’est surtout la méthode, dite « cartésienne », et le recentrement
sur la conscience subjective, qui vont marquer la pensée moderne.
Malebranche (1638-1715) est un « héritier » du logos intéressant, qui cherche à unifier
la subjectivité rationnelle, le logos du rationalisme moderne (cartésien) et le logos au sens
chrétien (augustinien) : la raison est un verbe intérieur qui éclaire la méditation du
mathématicien et du physicien (Galilée ne dit-il pas lui-même que le monde est écrit en
langage mathématique ?), identique au Verbe fils de Dieu qui s’est incarné pour notre salut.
Ainsi, Dieu est la cause de tous les phénomènes physiques, qui, d’une part, sont des
« occasions » pour lui de se manifester et que, d’autre part, la raison scientifique permet
d’exprimer en langage mathématique. Cette raison est une et universelle, c’est la même pour
un Français ou pour un Chinois, et elle livre des principes qui valent à la fois pour la
connaissance théorique (fondée sur les mathématiques) et pour l'action (fondée sur des
principes humanistes) :
« Les philosophes, même les moins éclairés, demeurent d’accord que l’homme participe à
une certaine raison qu’ils ne déterminent pas. C’est pourquoi ils le définissent animal rationis
particeps, car il n’y a personne qui ne sache, du moins confusément, que la différence essentielle
de l’homme consiste dans l’union nécessaire qu’il a avec la raison universelle, quoiqu’on ne sache
pas ordinairement quel est celui qui renferme cette raison, et qu’on se mette fort peu en peine de le
découvrir. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4, et qu’il faut préférer son ami à son chien, et je
suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne
vois point ces vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient point dans le mien. Il
est donc nécessaire qu’il y ait une raison universelle qui m’éclaire et tout ce qu’il y a
d’intelligence. Car si la raison que je consulte n’était pas la même qui répond aux Chinois, il est
évident que je ne pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes
vérités que je vois. Ainsi la raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-même est
une raison universelle. Je dis quand nous rentrons dans nous-même, car je ne parle pas ici de la
raison que suit un homme passionné. Lorsqu’un homme préfère la vie de son cheval à celle de son
cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a
horreur. » (Malebranche, De la recherche de la vérité, 10è éclaircissement)
Spinoza (1632-1677) était un juif portugais vivant à Amsterdam, auteur d’« effroyables
hérésies » au yeux de ses contemporains. Ce philosophe rejeté à la fois par la communauté
juive et les différentes communautés chrétiennes de son temps, a publié presque tout son
œuvre après sa mort. Il a refusé plusieurs postes académiques, préférant exercer le métier de
polisseur de verre. Le philosophe procède more geometrico, « à la façon d’un géomètre » :
l’œuvre majeure de Spinoza, L'Ethique, est constituée par des suites de définitions, de
propositions et de démonstrations qui s’enchaînent en se référant les unes aux autres.

90
Le premier livre de L'Ethique porte sur Dieu. Si Spinoza a dérangé les théologiens de
son époque, c'est parce qu'il proposait une conception d'un Dieu qui n'est ni un monothéisme
(Dieu est immanent et non transcendant), ni à proprement parler un athéisme. On trouve chez
Spinoza un panthéisme et un cosmopolitisme proches du stoïcisme : « Dieu, c’est-à-dire la
nature » (Deus sive natura), est une « substance » qui se déploie en fonction de modes (qui en
sont des effets, affections ou modifications de la substance divine) — lesquels constituent le
monde — et d’attributs (qui en découlent nécessairement) — lesquels sont en nombre infini,
même si nous n’en pouvons connaître que deux : l’étendue et la pensée, c’est-à-dire les corps
et les esprits. Cette conception originale permet à Spinoza de résorber le dualisme entre l’âme
et le corps, qui ne sont que deux aspects d’une seule et même substance divine, et aussi de
poser à nouveaux frais le problème du rapport entre la substance (Dieu et ses attributs, ou la
« nature naturante ») et les « accidents » de la substance (Dieu et ses modes, ou la « nature
naturée »).
Le second livre est consacré à l'Esprit. Du point de vue des attributs divins, il n’y a donc
qu’un seul monde possible, celui qui découle nécessairement des propriétés de la substance
divine. Les choses n'ont pas pu être produites autrement, ni dans un autre ordre. La
connaissance doit faire correspondre l'ordre des idées à celui des choses. La raison est donc à
la fois individuelle et universelle : l’esprit humain, capable de comprendre la structure de
l’univers, l’enchaînement des causes et des effets, s’unit au principe de tout dans un amour
qui est « joie » et « intelligence ». Cette compréhension intuitive des essences et de Dieu, sub
specie aeternitatis, est appelée par Spinoza connaissance du troisième genre, supérieure à la
connaissance par expérience vague ou par ouï-dire (connaissance dite du premier genre, la
seule qui puisse être cause de fausseté) et même à la connaissance des idées adéquates et des
proportions des choses (connaissance rationnelle au sens propre, dite du deuxième genre, qui
suit le modèle des mathématiques).
Le troisième livre de L’Ethique, consacré aux « passions », s’attache à déduire tous les
affects (comme par exemple la crainte, la pitié, la jalousie, le mépris, la gratitude, l’ambition,
le regret, etc.) à partir de trois affects premiers, en quelque sorte « axiomatiques », la Joie
(augmentation de puissance tendant vers plus de perfection), la Tristesse (diminution de
puissance) et le Désir (dont le moteur est le conatus, la persévérance dans l'être, et qui est à
l'origine des valeurs : on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais c'est parce
qu'on la désire qu'on la juge bonne). L’aridité des démonstrations quasi-géométriques
contraste avec l’enracinement existentiel du texte, ainsi que la simplicité des thèmes abordés.
Spinoza considère en somme que la haine, la colère, l'envie, etc. ont des causes précises,
démontrables, dont la connaissance est indispensable au bonheur.
Les quatrième et cinquième livres portent sur la servitude et la liberté de l'homme. En tant
que corps, l'homme est un tout petit fragment de l'étendue infinie, et en tant qu'âme de la
pensée infinie. Il est d'abord un eslave. Croire que nous sommes entièrement libres nous ferait
ressembler à une pierre qui, mue par l'impulsion d'une cause extérieure et persévérant dans
son mouvement, croirait être l'auteur de son propre mouvement, être libre. L'amour
intellectuel de Dieu, qui n'est autre que l'intelligence elle-même, est ce qui permet de
comprendre l'enchainement des causes et des effets, condition du bonheur.
Cette doctrine permet d'agir conformément aux commandements de la nature divine sans
attendre que Dieu nous décore de suprêmes récompenses, elle enseigne à supporter tout ce qui
ne dépend pas de nous (cf. le stoïcisme), elle préconise de vivre en société en ne haïssant,
n'enviant ou ne mésestimant personne, et elle montre comment conduire les citoyens pour en
faire des êtres libres, qui font librement le meilleur.
Ce grand solitaire qu’était Spinoza était résolument optimiste, y compris en ce qui
concerne la sociabilité des êtres humains, qui sont tous des parcelles de la substance divine et
auxquels la société des autres hommes apporte plus de puissance et de liberté :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%