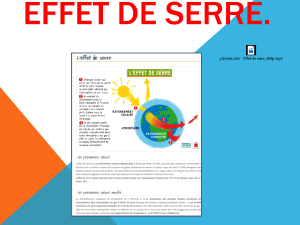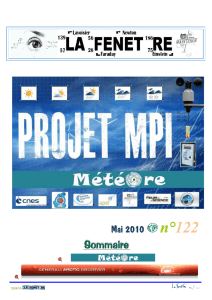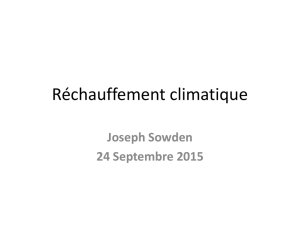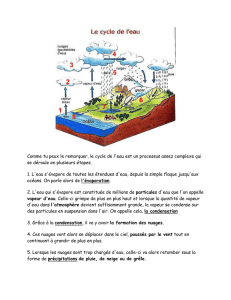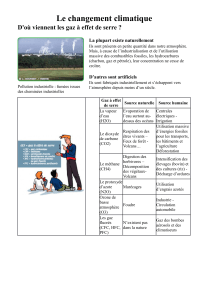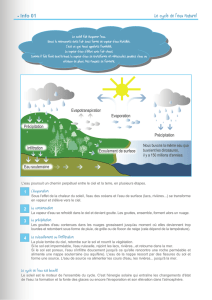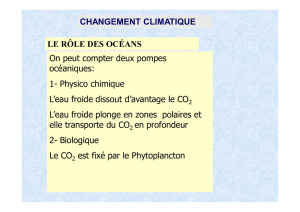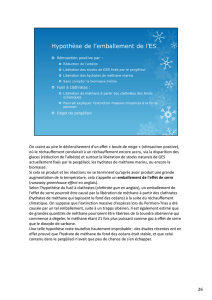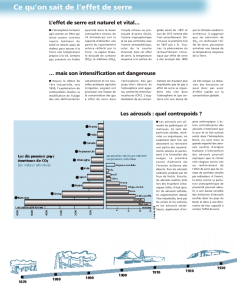CO2 et climat - Fondation La main à la pâte

Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org)
Accueil > CO2 et climat
CO2 et climat
Auteurs : Jean-louis Dufresnes(plus d'infos)
Résumé : Parallèlement à l’accroissement de la concentration en CO2 dans
l’atmosphère, on observe une augmentation de la température moyenne
de la surface de la Terre.
Publication : 26 Mars 2014
.
Évolution récente de la concentration en CO2
La combustion du charbon, du pétrole, du gaz ou du bois libère essentiellement de la vapeur
d’eau et du CO2. La vapeur d’eau ne reste que quelques jours dans l’atmosphère avant de se
condenser et de retomber sous forme de pluie. L’hypothèse que le CO2 puisse s’accumuler,
au moins partiellement, dans l’atmosphère date de la fin du xixe siècle. Elle a tout de suite été
contestée car les échanges de CO2 entre l’atmosphère et l’océan ou la végétation sont très
intenses et l’on pouvait donc supposer qu’ils évolueraient de façon à maintenir la
concentration en CO2 à peu près constante. C’est seulement à partir des années 1960 que
l’on a mesuré assez précisément la concentration en CO2, loin des zones où il est émis, et
observé qu’elle augmentait bien. Depuis, on a pu établir que l’océan et la végétation
absorbent environ la moitié des émissions anthropiques (c’est-à-dire d’origine humaine) de
CO2, l’autre moitié s’accumulant dans l’atmosphère. Il est important de remarquer que la
concentration en CO2 augmenterait deux fois plus vite si l’océan et la végétation ne jouaient
pas leur rôle. Continueront-ils de le faire dans les prochaines décennies ? De nombreuses
études montrent que ces puits naturels de carbone pourraient se réduire à cause du
réchauffement climatique.
La mesure de la composition chimique des bulles d’air emprisonnées dans la glace des
calottes polaires permet d’évaluer la variation de la concentration en CO2 depuis plus de six
cent mille ans. Celle-ci a varié de 200 à 300 ppm (parties par million) environ entre les
périodes glaciaires (concentration basse) et les périodes interglaciaires (concentration plus
élevée) selon un cycle dont la période est d’environ cent mille ans. Depuis 15 000 ans
environ, nous sommes dans une période interglaciaire, avec une concentration en CO2
stable, proche de 280 ppm. Mais cette concentration a rapidement augmenté depuis 150 ans,
passant de 280 ppm vers 1860 à 380 ppm. Ainsi, la concentration en CO2 a autant augmenté
en cent cinquante ans qu’en quelques milliers d’années, dans le passé, lors des transitions
entre une période glaciaire et interglaciaire.
Le réchauffement climatique dû à un accroissement de
CO2

Parallèlement
à
l’accroissement
de la
concentration
en CO2 dans
l’atmosphère,
on observe
une
augmentation
de la
température
moyenne de la
surface de la
Terre. Ce
réchauffement
est d’environ
0,8 °C sur
cent cinquante
ans, dont 0,6
°C sur les
cinquante
dernières
années. Le
CO2 étant un
des principaux
gaz à effet de
serre, une
augmentation
de sa
concentration
renforce
l’absorption du
rayonnement
infrarouge par
l’atmosphère,
ce qui a pour
conséquence
d’augmenter
la température
de surface
selon les
mêmes
principes
physiques que
ceux utilisés
précédemment
pour expliquer
l’effet de
serre.
Néanmoins,
nous allons
exposer
pourquoi ce
lien entre
concentration
en CO2 et
température
de surface
n’est pas si
direct et
pourquoi il faut
faire intervenir
toute la
complexité du
système
climatique en
plus de l’effet
de serre lui-
même. Ce
sont toutes
ces difficultés
qui font que
c’est
seulement
depuis
quelques
années que
les
climatologues
ont établi que
l’augmentation
des gaz à effet
de serre, et
notamment du
CO2, est la
principale
cause de cette
augmentation
de la
température.
Évolution observée de la concentration de l’atmosphère en CO2
(source : Jean-Marc Barnola, LGGE-CNRS)

On sait aujourd’hui calculer de façon précise et fiable de combien une variation de la
concentration en CO2 modifie l’effet de serre. Si l’on suppose que l’atmosphère terrestre
conserve exactement ses propriétés actuelles, que seules la concentration en CO2 et les
températures de l’air et de la surface de la Terre peuvent varier, on obtient alors qu’un
doublement de la concentration en CO2 a pour conséquence d’augmenter la température
moyenne de la Terre de 1,2 °C. Ce calcul peut être fait de façon très précise, mais il est basé
sur des hypothèses qui sont beaucoup trop simplificatrices. En effet, si la température
change, toutes les autres grandeurs décrivant le climat changent aussi : humidité, vent,
nuages, pluies, couverture neigeuse, etc. Tout cela peut à son tour modifier les échanges de
chaleur dans l’atmosphère, et donc avoir un effet sur les températures : ce sont des
phénomènes de rétroaction. Prenons quelques exemples.
La quantité maximale de vapeur d’eau pouvant être contenue dans un volume d’air dépend
de la température : plus la température de l’air est élevée, plus cette quantité est importante,
et inversement lorsque la température est plus faible (voir « La physique du climat »). Or nous
avons vu précédemment que la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre. Donc, si
l’humidité relative de l’atmosphère reste constante, toute augmentation de la température de
l’air sera accompagnée d’une augmentation de la quantité de vapeur d’eau, donc de l’effet de
serre, ce qui entraînera une augmentation de la température de l’air et de la surface de la
Terre. C’est une rétroaction positive : la variation de la vapeur d’eau a pour effet d’amplifier la
variation initiale de température. Qui dit amplification ne veut pas dire emballement car il y a
un phénomène stabilisateur : c’est la loi d’émission du rayonnement dont nous avons parlé au
début de ce chapitre et qui dit que lorsque la température augmente, l’énergie perdue par
émission de rayonnement augmente. Les rétroactions sont actives aussi bien lorsque la
température augmente que lorsqu’elle diminue. Toujours pour ce premier exemple, si la
température baisse, la quantité de vapeur d’eau baisse aussi, ce qui réduit l’effet de serre et
tend à diminuer la température de surface.
Une autre rétroaction positive est liée à l’extension de la couverture neigeuse. La neige, qui
est très blanche, réfléchit entre 80 et 90 % du rayonnement solaire incident. Or, dans un
climat plus chaud, la surface neigeuse sur les continents sera moindre. S’il y a moins de
neige, le rayonnement solaire, au lieu d’être réfléchi par le sol, sera absorbé et la température
aura donc tendance à augmenter davantage.
Une dernière rétroaction importante tient aux nuages. Ces derniers ont un effet de serre qui
dépend de leur altitude, les nuages hauts ayant un effet plus important que les nuages bas.
Les nuages, comme la neige, réfléchissent également vers l’espace le rayonnement solaire
incident, phénomène parfois appelé « effet parasol ». L’effet de serre des nuages tend à
augmenter la température de surface de la Terre, l’effet parasol tend à la refroidir.
Aujourd’hui, on observe que ces deux effets antagonistes ne s’annulent pas tout à fait et qu’à
l’échelle globale, l’effet parasol domine, que les nuages refroidissent légèrement la surface de
la Terre. La façon dont les nuages changeront avec la température globale n’est pas encore
bien connue. Les modèles climatiques actuels tendent à montrer que leur effet parasol
diminuera si la température globale augmente, ce qui aura tendance à augmenter davantage
la température de la Terre, mais cet effet est très incertain et il est la principale source
d’incertitude des projections des changements climatiques futurs.
L’ensemble de ces rétroactions climatiques a pour effet d’amplifier d’un facteur 2 à 3 toute
variation de température. Par exemple, lors d’un doublement de la concentration en CO2,
nous avons vu que la température augmentait de 1,2 °C si elle était la seule grandeur à
changer. En prenant en compte l’ensemble des rétroactions du climat, on trouve que
l’augmentation de la température est de 2,5 à 4,5 °C. On voit ainsi clairement l’importance

des rétroactions dans les prévisions des changements climatiques futurs. Pour estimer
précisément l’augmentation des températures, il faut bien connaître et bien prendre en
compte l’ensemble de ces rétroactions : c’est l’une des principales difficultés à surmonter pour
estimer les réchauffements climatiques futurs.
Le refroidissement dû à un accroissement des aérosols
Une autre perturbation anthropique est l’émission d’aérosols, toutes petites particules solides
ou liquides qui peuvent rester plusieurs jours en suspension dans l’air lorsque leur diamètre
est inférieur à un micromètre (?m), c’est-à-dire inférieur à un millième de millimètre. Ce sont
notamment de tout petits grains de sable, de terre ou de sel, des pollens… Ils peuvent aussi
être produits par des feux (la fumée que l’on voit est constituée d’aérosols) ou être le résultat
de réactions chimiques. Les aérosols réduisent la visibilité, « troublent » l’atmosphère et
renvoient une partie du rayonnement solaire incident vers l’espace, ce qui diminue le
rayonnement solaire arrivant à la surface de la Terre et tend donc à en réduire la température.
Mais les aérosols influencent aussi la formation des nuages et ont tendance à les rendre plus
réfléchissants au rayonnement solaire, ce qui contribue également à diminuer la température
de surface de la Terre.
On pourra se reporter au chapitre « La physique du climat » déjà cité pour une explication plus
détaillée du phénomène de condensation et du lien avec la formation des nuages dans
l’atmosphère, nous ne considérons ici que l’effet des aérosols. La vapeur d’eau se condense
de façon privilégiée autour des aérosols. Lorsqu’il y a peu d’aérosols dans l’air, la vapeur
d’eau se condense autour des quelques-uns présents. Le nombre de gouttes est donc assez
faible, ce qui fait que les gouttes sont assez grosses car la vapeur d’eau ne peut se
condenser qu’en un petit nombre d’endroits. C’est bien ce que l’on observe dans la première
partie de l’expérience.
Lorsqu’il y a beaucoup d’aérosols dans l’air, la vapeur d’eau peut se condenser autour du
grand nombre d’aérosols présents. Il y a beaucoup de gouttes et elles ont un faible diamètre
car la vapeur d’eau peut maintenant se condenser en un grand nombre d’endroits. C’est ce
que l’on observe dans la deuxième partie de l’expérience : le nuage est beaucoup plus «
lumineux » car les gouttes d’eau sont plus petites, plus nombreuses et elles diffusent
davantage la lumière (voir dans cet ouvrage, « Les couleurs du ciel », de Roland Lehoucq).
Chaque goutte d’eau qui tombe entraîne avec elle un ou plusieurs aérosols : c’est pour cela
que le ciel est souvent très limpide après une pluie, il a été « lavé » des aérosols. Dans notre
expérience avec la bouteille, il faudra former plusieurs fois de suite un nuage et attendre que
les gouttelettes tombent pour pouvoir réduire la quantité d’aérosols en suspension. On peut
aussi attendre simplement une ou deux heures sans rien faire, le temps que les aérosols se
collent aux parois de la bouteille.
Les activités humaines ont pour effet d’augmenter la quantité d’aérosols dans l’air et
aujourd’hui, on estime que ce supplément d’aérosols masque environ un tiers du
réchauffement climatique dû à l’accroissement des gaz à effet de serre.
On prend deux bouteilles de soda en plastique, on colle avec une colle forte les deux
bouchons ensemble, tête-bêche, et on les perce ensuite d’un trou de 4 à 5 mm de
diamètre environ. On verse un fond d’eau dans la bouteille du bas et on visse les deux
bouteilles sur les deux bouchons. Attendre au moins cinq minutes que l’ensemble soit à
la même température. Placer la bouteille du bas dans le faisceau d’un projecteur et
comprimer la bouteille du haut avec les mains pendant vingt secondes environ.
Relâcher la bouteille du haut. On voit alors apparaître des petites gouttes d’eau dans la
bouteille du bas (ces gouttes forment un « nuage »). Elles sont le résultat de la

condensation de la vapeur d’eau qui a eu lieu lorsque la pression dans la bouteille a
diminué. On dévisse ensuite la bouteille du bas et on y introduit pendant quelques
secondes une allumette (ou un bâton d’encens) tout juste éteinte et qui fume encore, de
sorte que la fumée se disperse à l’intérieur de la bouteille. Après l’avoir refermée, on
refait la même expérience que ci-dessus : compression puis décompression de la
bouteille. On observe encore la formation d’un nuage, mais celui-ci est beaucoup plus
lumineux que le premier. En présence d’aérosols, ce nuage diffuse beaucoup plus la
lumière, les gouttelettes d’eau sont plus petites que précédemment, plus difficiles à
distinguer individuellement.
Les autres causes des variations du climat
Outre l’accroissement des gaz à effet de serre, les activités humaines peuvent modifier le
climat via un changement des caractéristiques de la surface des continents. Par exemple,
l’eau contenue dans le sol s’évaporera beaucoup plus facilement si le sol est recouvert par
une forêt que s’il est recouvert par une prairie. Ces changements peuvent modifier la
température de surface à l’échelle régionale ou continentale, mais ont peu d’effet à l’échelle
globale.
Le climat peut également être modifié par des « perturbations » naturelles. Sur de très grandes
échelles de temps (plusieurs dizaines de milliers d’années), ce sont notamment les variations
de la position relative de la Terre et du Soleil qui jouent un rôle déclencheur dans les
transitions entre périodes interglaciaires et glaciaires. Sur des échelles de temps beaucoup
plus courtes (quelques mois à quelques années), les très grosses éruptions volcaniques
influencent le climat en émettant des poussières très fines qui peuvent rester quelques mois à
quelques années dans la haute atmosphère, vers 15 km d’altitude. On estime que l’éruption
du Pinatubo (Philippines) en 1991 a conduit à une réduction de la température moyenne de la
Terre de 0,5 à 1,5° C dans les mois qui ont suivi, un effet qui a ensuite progressivement
disparu en trois ans. Le rayonnement émis par le Soleil varie également, notamment selon un
cycle de onze ans, mais ces variations sont de très faible amplitude et ne semblent pas
affecter le climat global.
Enfin, le climat varie tout seul, par lui-même, sans forçage. On le constate à l’échelle locale
ou régionale : été chaud ou froid, sec ou pluvieux, hiver rigoureux ou clément, etc. Les
interactions entre l’atmosphère et les surfaces continentales ou les océans créent des
variations du même type à l’échelle globale, dont un exemple connu est le phénomène El
Niño : elles relèvent de la « variabilité interne du climat ».
Addons
Voir Aussi
Aucun résultat
Du même auteur
29 notions-clefs : effet de serre et climat
26/03/14
29 notions-clefs : la physique du climat
07/08/09
 6
6
1
/
6
100%