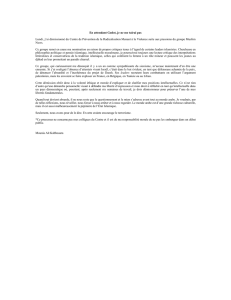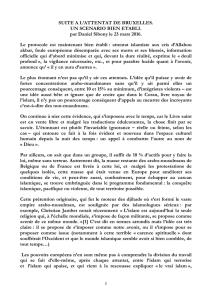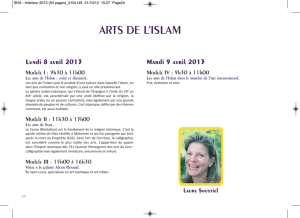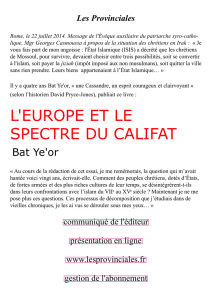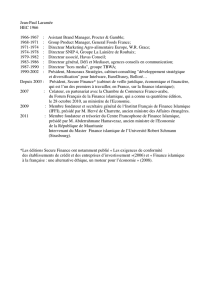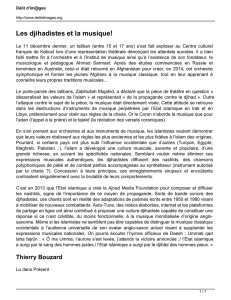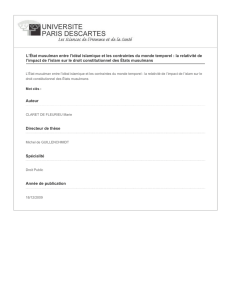L`économie islamique est d`essence spirituelle et de

L’économie islamique est
d’essence spirituelle et de
profondeur sociale »
Rédigé par Huê Trinh Nguyên |
SAPHIRNEWS
Abderrahmane Lahlou, fondateur-directeur d’ABWAB Consultants, est notamment expert
agréé auprès de la Banque islamique de développement. Il est l’un des nombreux co-
auteurs des « Actes pour une économie juste », sous la direction de Dominique de
Courcelles*, un livre issu de la conférence internationale « Éthique et religions pour une
économie juste » qui s’était tenue en 2014. Dans son récent ouvrage « Économie et
finance en islam »**, Abderrahmane Lahlou insiste sur les fondements éthiques et
philosophiques de l’économie islamique qui prévalent toujours aujourd’hui et qui
permettraient de « stabiliser l’économie et recadrer les finances ». Interview.
Bien avant le concept de développement durable qui a émergé à la fin du XXe siècle, « la législation
islamique s’est dressée autant contre la surexploitation des ressources naturelles que contre
l’exploitation de l’homme par l’homme », affirme Abderrahmane Lahlou, spécialiste de l’économie et
de la finance islamique. Schéma ci-dessus : Les dimensions de l’économie islamique. (Photo : © ABWAB
Consultants)

Saphirnews : Dans votre ouvrage « Économie et finance en islam »**, vous
dites que la doctrine islamique en économie et en finance est à la fois
d’essence spirituelle et d’esprit social. Expliquez-nous…
Abderrahmane Lahlou : Je peux dire que la doctrine économique islamique est d’essence
spirituelle, sous format temporel. Les actes économiques sont à vocation d’adoration et de
dévotion. Deux illustrations peuvent en être faites.
Abderrahmane Lahlou.
La propriété des biens revient non pas à l’être humain, mais à Dieu. L’homme en est
dépositaire et usufruitier, et transmet ces pouvoirs à ses ayants droit. En aucun cas, l’homme
ne dispose du droit de détruire un bien ou une valeur. Il est dans une posture mentale et
comportementale où il a conscience permanente que les biens qu’il gère en lieutenance
obéissent à des lois telles que la préservation, la fructification et le partage.
En second lieu, de nombreux actes et attitudes économiques liés aux transactions du marché
ou à l’investissement sont présentés dans la vision islamique comme étant des actes de piété,
rétribués dans l’au-delà, sans que cela enlève leur portée économique. Bien au contraire, les
finalités de l’équité, de la solidarité et de la création de valeur sont recherchées à travers les
actes de piété, de repentance.
De même, les actes de corruption, de spéculation, d’abus de biens d’autrui sont freinés par
l’attitude individuelle de précaution au regard du courroux divin et par l’application des
sanctions légales de la part des autorités.
Et qu’en est-il de l’esprit social ?
Abderrahmane Lahlou : D’un autre côté, la doctrine économique islamique est de
profondeur sociale. En même temps qu’elle encourage l’effort individuel et la jouissance
personnelle des richesses, d’une part, elle promeut toutes formes de transactions et de
partage des facteurs de production qui assurent l’équité et, d’autre part, elle garantit par la
force de la loi uneredistribution minimale au profit de la communauté la plus proche comme
acte rituel obligatoire.
Un autre aspect social que l’on retrouve dans la doctrine islamique porte sur le droit des
populations salariées à un traitement équitable sur les salaires et les retraites, et digne sur les
conditions de travail. De même, la répartition des rôles entre épargnants et investisseurs, par
le truchement des banques islamiques participatives, fait des épargnants des contributeurs à
la prospérité économique, non de simples détenteurs de ressources exploitées par les
banques.

Les pays du Golfe, pour ne citer qu’eux, sont connus pour leur absence
d’imposition et le clivage entre nationaux et étrangers, discriminant ces
derniers sur le marché de l’emploi, l’accès à l’entrepreneuriat, les avantages
sociaux… N’y a-t-il pas là une disjonction avec le principe islamique de
justice sociale ?
Abderrahmane Lahlou : Vous savez, les principes islamiques ne sont plus vraiment observés
par tous les États depuis la colonisation. Et les indépendances n’ont changé que peu de
choses. La vision séculaire de la gestion de l’État s’est imposée peu à peu. Il reste des aspects
de forme qui sont vivaces, mais peu de pays se réclament d’une application de
la sharia dans ses finalités de justice, de liberté de respect des droits, de partage des revenus.
Rappelez-nous brièvement les outils de la finance islamique.
Abderrahmane Lahlou : Les outils financiers dans le référentiel islamique ont plutôt trait aux
banques, aux assurances et aux marchés financiers. Pour financer les besoins des particuliers
ou des entreprises, il existe, par exemple, l’outil de la murabaha, qui consiste à acheter un
bien ou un équipement sur ordre et à le revendre sur plusieurs échéances, moyennant une
marge fixée à l’avance. Il existe aussi des outils de participation aux profits et pertes du projet
financé, la mudaraba et la musharaka, et bien d’autres instruments bancaires.
Dans le domaine de l’assurance, le produit islamique s’appelletakaful et consiste à faire des
assurés de véritables sociétaires mutualistes, à qui revient l’excédent éventuel des opérations
d’assurance. Sur les marchés financiers, il existe des fonds communs de placement (FCP)
compatibles avec la sharia.
Quels sont les apports de la finance islamique à l’économie juste et
participative que prônent aujourd’hui un certain nombre d’économistes en
cette période de crise ?
Abderrahmane Lahlou : Je peux les résumer en deux idées. La première est la stabilisation de
l’économie, par la redistribution des revenus, le respect de l’éthique dans les transactions et
dans la moralisation des biens et services produits. La seconde est la résilience du système
bancaire et financier, qui ne court pas le risque de la bulle financière et de l’envolée des
crédits au-delà de la production réelle de richesses.

En quoi peut-on mettre en parallèle les principes islamiques de solidarité, de
justice sociale et de respect de l’environnement avec la récente encyclique
du pape François qui en appelle à une « écologie humaine » ?
Abderrahmane Lahlou : Je pense que la toute récente encyclique du pape François sur
l’environnement et l’écologie est une excellente ouverture de l’Église, autrefois distante du
temporel et des affaires des États et de la société. La substance de l’encyclique a été élargie
à l’« écologie humaine », ce qui est un large domaine où l’Église se veut de plus en plus
présente.
Cette ouverture vient confirmer le mouvement depréservation de la Création, né auparavant
chez les protestants.
En communion avec cette ouverture, l’islam a encore moins d’efforts à accomplir pour
s’inviter dans le champ de l’économie, de la finance et du développement durable, comme
je le rappelle dans mon ouvrage sur l’économie et la finance en islam. L’islam est par
essence de nature globale : normalisation du spirituel et réglementation du temporel.
En précurseur de la destruction de son espace de vie auquel s’adonnera l’homme du XXIe
siècle, la législation islamique s’est dressée contre la surexploitation des ressources naturelles
autant que contre l’exploitation de l’homme par l’homme dans la relation de production. Ce
n’est que dans les années 1980 que ces problématiques ont été cadrées dans le concept de
développement durable.
Les principes de l’économie islamique ont donc aussi une visée écologique ?
Abderrahmane Lahlou : La préservation de l’environnement est une marque de respect pour
laNature, don de Dieu et objet d’épreuve, puisque l’être humain n’est que le régent sur Terre,
et ne possède pas dans l’absolu ce dont il dispose. « Et ne répandez pas le mal sur Terre
après que l’ordre y a été établi » (Coran, s. 7, v. 56).
Ce faisant, l’être humain, chargé de cette noble mission, remplit les conditions qui vont lui
assurer une meilleure vie sur Terre, à lui et surtout aux générations futures. La préservation des
plantations, et particulièrement des arbres, occupe une place de choix dans la tradition
musulmane. Dans une recommandation du premier calife de l’islam, Abû Bakr, il « interdisait
à ses troupes lors des expéditions de couper les arbres, à l’exception d’un arbre nuisible ».
En somme, la vision islamique et la vision économique s’accordent sur les objectifs, mais pas
sur la finalité théologique et spirituelle.

* Dominique de Courcelles (sous la dir.), Actes pour une économie juste, Lemieux Éditeur, juin
2015, 400 p., 30 €.
** Abderrahmane Lahlou, Économie et finance en islam. Une éthique pour stabiliser
l’économie et recadrer les finances, Éd. Al Madariss, avril 2015.
1
/
5
100%