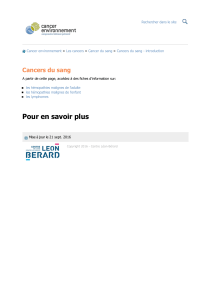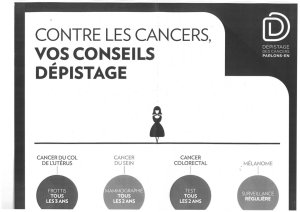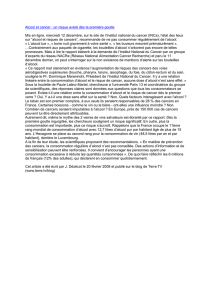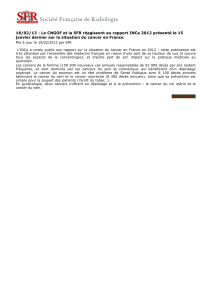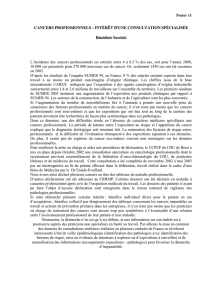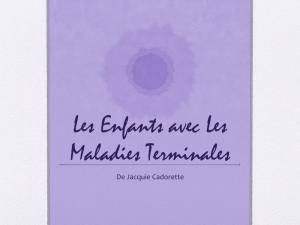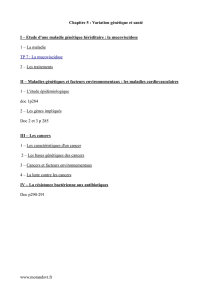Cancer et travail - Arc Espace Chercheurs

1
COLLOQUE CANCER ET TRAVAIL
Couvent des Cordeliers amphithéâtre Pasquier
21, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Mardi 14 décembre 2010
PROGRAMMES ET CONFÉRENCES
COLLOQUE
Cancer
et travail

COLLOQUE CANCER ET TRAVAIL
2

3
COLLOQUE CANCER ET TRAVAIL
8h30 Accueil
9h00 Ouverture
• Dominique MARANINCHI (INCa)
• Jacques RAYNAUD (ARC)
• Marcel GOLDBERG (Inserm)
Session 1 Genèse des cancers professionnels
9h30 Modérateur : Christelle DAVID-BASEI (ARC)
• État des lieux : De l’exposition à la reconnaissance des cancers professionnels
Ellen IMBERNON (InVS, Département Santé Travail)
• Facteurs de risques professionnels des cancers du poumon et des voies
aérodigestives supérieures (étude ICARE)
Danièle LUCE, Isabelle STUCKER (Inserm U 1018-CESP)
• Étude de l’incidence des cancers et de la mortalité en milieu agricole en France
(étude AGRICAN)
Pierre LEBAILLY (Centre François Baclesse, Caen, GRECAN, EA 1772)
• Facteurs de risques professionnels des cancers du sein :
étude cas-témoins en Ille-et-Vilaine et en Côte d’Or (étude CECILE)
Pascal GUENEL (Inserm U 1018-CESP)
10h30 Questions / échanges avec la salle
10h45 Pause
Session 2 Travailler avec ou après un cancer
11h15 Modérateur : Norbert AMSELLEM (INCa)
• État des lieux : Situations de travail et trajectoires professionnelles des actifs
atteints de cancer
Marie MENORET (Université Paris 8)
• L’expérience du cancer : quelles stratégies de régulation dans l’activité de travail ?
Anne-Marie WASER (LISE - CNAM)
• Impact psychosocial du cancer du sein et facteurs associés aux trajectoires pro-
fessionnelles des femmes jeunes en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)
Lucille GALLARDO (Inserm U912 / ORS PACA)
• Les logiques d’action des entreprises à l’égard des salariés atteints du cancer :
une comparaison France/Allemagne
Bruno MARESCA (CREDOC)
12h15 Questions / échanges avec la salle
12h30 Cocktail « déjeunatoire » - Salle Marie Curie
PROGRAMME

COLLOQUE CANCER ET TRAVAIL
4
Session 3 Contributions du travail aux inégalités sociales
14h00 face au cancer
Modérateur : Sylvie CELERIER (Centre d’Études de l’Emploi)
• État des lieux : Différences sociales d’exposition aux risques professionnels
de cancer et de répercussion sur l’emploi
Gwenn MENVIELLE (Inserm U 1018-CESP)
• Sous-traitance, travail temporaire et cancers professionnels : connaissance,
reconnaissance et prévention
Annie THEBAUD-MONY (Inserm/Université Paris 13)
• Situations de travail et trajectoires professionnelles des actifs atteints de cancer
Alain PARAPONARIS (Inserm U912 - ORS PACA)
15h00 Questions / échanges avec la salle
Table ronde Cancer et travail : quelles questions, quelles solutions ?
15h30 Modérateurs : Jean-Pierre GRÜNFELD, Emmanuel HENRY (IEP Strasbourg)
Participants :
• Arnaud de BROCA, secrétaire général de la FNATH (Association des acciden-
tés de la vie)
• Gérard LUCAS, médecin du travail secrétaire national du SNPST
(Syndicat National des Professionnels de Santé au Travail)
• Michel YAHIEL, président de l’Association nationale des DRH
• Noëlle LASNE, Médecin du travail, co-fondatrice de Médecins sans frontières
• Huguette MAUSS, présidente du FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante)
• Claire LALOT, collectif d’associations Chroniques associés
17h00 Questions / échanges avec la salle
17h30 Conclusion et clôture

5
COLLOQUE CANCER ET TRAVAIL
L’INCa et l’ARC ont lancé conjointement, en 2006 et 2007, deux appels à projets de recherche
s’inscrivant dans les orientations du premier plan cancer et abordant respectivement sous deux
angles distincts le thème général « cancer et travail ». Le premier de ces appels à projets visait à
explorer les conséquences de la maladie et de ses traitements sur les situations d’emploi et de
travail des personnes atteintes ; le second visait à mieux connaître les facteurs de risque
professionnels des cancers et les conditions de leur reconnaissance sociale comme maladies
d’origine professionnelle. Ce colloque est l’occasion de rendre compte et de discuter des résultats
d’une partie des recherches réalisées dans ce cadre et, en examinant comment le travail contribue
à la formation des inégalités sociales face au cancer, de participer à la lutte contre ces inégalités,
qui constitue l’un des axes prioritaires du plan cancer 2009-2013 (mesures 9, 12 et 29).
Les recherches menées en réponse au premier appel à projet permettent, à travers des approches
quantitatives ou qualitatives, de mesurer et de mieux comprendre l’impact de la survenue du
cancer sur la vie professionnelle des patients qui étaient actifs au moment du diagnostic. Avec près
d’une personne atteinte de cancer sur deux âgée de moins de 65 ans, du fait des progrès réalisés
dans le diagnostic et le traitement de la maladie, la question du maintien dans l’emploi ou du
retour à la vie active des patients est en effet devenue fréquente. Pour autant, les chances d’exercer
une activité professionnelle deux ans après le diagnostic d’un cancer continuent d’être très altérées.
Les enquêtes longitudinales réalisées montrent comment les multiples difficultés auxquelles sont
alors confrontés les patients, au cours des traitements comme après, liées aux séquelles physiques
et psychologiques de la maladie (fatigue, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration,
anxiété, etc.), fragilisent les conditions de la poursuite ou de la reprise de leur activité professionnelle.
Mais la possibilité du maintien en emploi est marquée de fortes disparités sociales entre catégories
professionnelles d’encadrement et d’exécution, voire entre statuts d’emplois (nature du contrat
de travail). L’aménagement des conditions et du poste de travail, rendu possible par la législation
du travail, ne constitue pas une garantie de retour à l’emploi, pour certaines catégories
socioprofessionnelles, cette compensation possible de la perte de productivité liée à la maladie et/
ou à son traitement ne paraissant pas toujours suffisante aux yeux des employeurs.
Quels enseignements peut-on alors retirer d’une comparaison entre les logiques organisationnelles
à l’œuvre, ainsi que les représentations de la question des salariés en longue maladie dans les
(grandes) entreprises françaises et allemandes ? Dans quelle mesure le problème de la maladie des
salariés, en particulier de ceux atteints de cancer, constitue-t-il une véritable préoccupation des
entreprises et sous quelle forme cette question apparaît-elle dans les discours des responsables
des entreprises ? Quelles sont les pratiques adoptées à l’égard de la maladie et dans les politiques
de gestion des ressources humaines ? Quel rôle peuvent y jouer des formes institutionnelles
différentes de reconnaissance du handicap au travail (liées à des traditions historiques nationales
distinctes) ?
Les approches qualitatives adoptées dans certaines des recherches, croisant les regards (médecins
du travail, ergonome, sociologues) sur plus d’une centaine d’entretiens réalisés au total,
s’intéressent à la diversité des stratégies et des arrangements que les personnes qui travaillent avec
un cancer parviennent ou non à mettre en œuvre pour tenir ensemble travail et santé. Les récits
recueillis auprès des travailleurs indépendants, salariés et fonctionnaires interrogés montrent une
réalité très contrastée du traitement de la maladie au travail. Si le droit social prévoit de nombreux
statuts, certains d’entre eux ne sont attribués que sur un mode négocié et/ou suite à divers
contrôles dont les malades ne mesurent pas toujours les enjeux. L’adéquation entre les statuts
possibles et les aptitudes du salarié peut s’avérer très problématique.
INTRODUCTION
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%