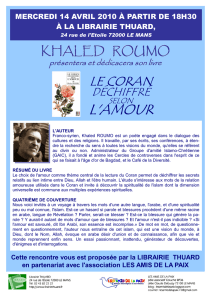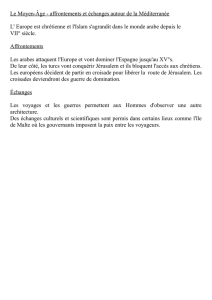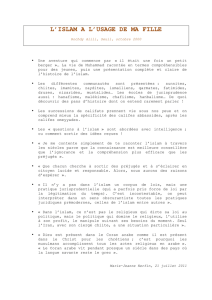La pensée arabe - Le blog de Socrate

La pensée arabe,
Mohammed Arkoun1,
PUF, 2014,130 p.
Il peut paraître présomptueux pour un occidental (nourri de tradition chrétienne dans un Occident
qui tend à prendre, qui a pris, des couleurs diverses) d'aborder la grande, l'immense question de la
pensée arabe. Il est temps que les deux traditions, dépassant leurs antagonismes séculaires, leurs
rêves hégémoniques continuent de se parler, cherchent à se comprendre même si la chose est
difficile.
C'est plus présomptueux encore quand l'occidental se confronte au Saint Coran, à l'Islam qui en est ,
si je puis dire, la figure terrestre, un ennemi privilégié de l'"Occident" pour parler comme
Arkoun(A3).
Cependant, de récents événements nous poussent à un effort d’intelligence, même sur des bases
bien limitées, par la lecture de trois ou quatre livres qui sont comme une petite introduction à ce
que nous pouvons décrire comme une pensée complexe, un islam complexe, pluriel.
Deux livres, bien que sur la base d’emprunts inégaux, serviront de base à ce petit résumé. Le
premier est celui de Mohammed Arkoun, « La pensée arabe » (A) ; le second , à partir d’un point
de vue différent, est celui de Braudel dans « Grammaire des civilisations 2» (B).
Notre lecture sera donc, par définition si l’on peut dire, incomplète, nécessairement tronquée,
erratique au regard de critères de véracité qui ne sont pas les miens.
Le fait coranique
Il s’agit bien de la pensée arabe. Et selon les historiens, de deux périodes : avant le Coran, après le
Coran.
Avant le Coran3, dialectes et croyances mythologiques divers, bref, une société divisée, poly-
segmentaire.
Avec le Coran, un État, une culture, une religion qui sont unificateurs, centralisateurs,
nationalisants (A9).
Le Coran a d’abord été une parole et il est resté une parole liturgique jusqu’à nos jours. Mais il y eut
beaucoup d’énoncés qui cependant tous s’accordent sur une Vulgate officielle constituée dès le
califat de ‘Uthmân (644-656) et représentent la totalité de la Révélation. Ce texte est commun aux
Chî’ites et aux Sunnites. Il renvoie à un langage religieux qui s’épanouit sur trois plans solidaires :
le culte (rites,...), la loi ou charî’a (institutions, droits des hommes, droits de Dieu,...), la pensée
(théologique, éthique,…). L’âme religieuse vit de façon indivise ces trois actes.
La fonction prophétique est essentielle : « tout acte concret accompli par le prophète ouvre aux
hommes une espérance » (A19). Pour le Prophète, il y a une parfaite « homogénéité du dire et du
vécu ». Il est sans cesse présenté dans le Coran comme l’ « annonciateur de la bonne nouvelle « , le
« guide », l’ « Ami », l’ « Elu », le « transmetteur de la Parole de Dieu »,..
1 PUF, 2014,130 p. Pour cette dédition. La première, en 1975 ("Que sais-je?").
2 Champs, Flammarion,1993.La première édition en 1963, pp. 73 à 151.
3 Le mot "Coran" ne serait pas d'origine arabe d'après M.A. Amir-Moezzi mais syriaque. Il signifie "récitation
liturgique". Ce mot et d'autres ont été arabisés avec le temps. Mais cela pose la question de l'articulation du
message du Prophète Muhammad avec les autres religions. In Etudier l'islam. Un entretien entre Hamir Bozarslan
et M.A. Amir-Moezzi. Esprit, déc.2016, p.42.
1

La formation de la pensée arabe (de 632 jusque vers 950).
1. La vision musulmane traditionnelle (A24). L’âge fondateur réunit les Textes, Sources, Modèles
(Coran, Traditions prophétiques nommées hadith ou sunna) idéalement compris , interprétés par les
Compagnons, et plus tard encore par les pieux docteurs. Un groupe de vrais fidèles sera sauvé parce
qu’il a suivi scrupuleusement sa Sunna4, tous ses enseignements et toute sa pratique.
La communauté des fidèles, l’Ummâ qui s’étend de l’Atlantique au Pamir (B105).
L’accès aux textes dépend d’un effort de recherche personnelle (ijtihâd) mais dans le cadre strict
des connaissances transmises par les Compagnons (selon les Sunnites), par les Imâms (selon les
chî’ites).
2. La langue arabe est le moyen d’expression d’une culture, cadre institutionnel et horizon de cette
culture.
Chronologie en quelques dates.
An 1 de l’Hégire (622 après J.-C.). Quatre califes « bien guidés », Abü Bakr, Umar, Uthmân, Ali. Ali meurt en
661. Les 3 derniers sont assassinés.
656, Bataille du Chameau où d’illustres Compagnons soutenus pas Aïcha, veuve du Prophète s’opposent à Ali.
Désormais , les discussions sur les grands problèmes ouverts par le Coran seront de plus en plus dominés par les
options partisanes : le fait coranique se muera en fait islamique.
660, Installation de la dynastie omeyyade à Damas. Ils ont nettement fait prévaloir la raison d’État sur la
perspective religieuse (étendard blanc).
710, Construction des grandes mosquées de Médine, Damas, Alep, Jérusalem, Fustât.
750, Avènement de la dynastie abbasside (étendard noir); fondation de Bagdad en 762.
Bagdad est détruite par les Mongols en 1258.
3. Les premières discussions doctrinales. L’« homme est le lieutenant de Dieu sur terre ». Un
nouveau discours de légitimation s’introduit dans une société qui était jusque là, régie par des règles
archaïques. Mais les luttes de légitimation (en termes religieux) qui fondent la séparation sunnites/
chî’ites ont cet arrière fond sociologique. Quelle légitimité pour les héritiers de l’état-Ummâ fondé
par Muhammed? Des horizons s’ouvrent, mais les révoltes sont réprimées au nom de cet Etat-
Umma (A36) : khârijites et proalides en sont les principales victimes. C’est au cours du siècle
Omeyaade que la bipolarité sunnite/chî’te du fait islamique se dessine mais le clivage ne sera
effectif qu’à partir des années 880-900 (A36).
4. Libre arbitre et prédestination. Dans le Coran, on trouve des versets en faveur des deux thèses.
Un Dieu juge rigoureux mais en même temps, clément et miséricordieux, qui s’écarte de la
représentation pré-coranique d’un destin inexorable, impassible. Les partisans du libre arbitre
revendiquent une capacité d’agir déléguée par Dieu à l’homme..
5. L’impact de la pensée grecque. Signalons seulement que la tension entre logos et muthos déjà
palpable en Grèce classique est réactivée à Basra, Kûfa et Bagdad. (En gros , activité discursive
liée à la raison telle que la représente Aristote ; activité symbolique liée à l’imagination créatrice
telle qu’on la trouve chez Platon (Note A 41). Un traité dit de « l’Harmonisation des deux sages »
permettra de façon cohérente d’accéder à la vérité et de conquérir le bonheur parfait.
Le fait coranique est vécu, compris de deux manières, rationalisante et traditionaliste ce qui
correspondait à deux groupes sociaux très différents.
4 D'où l'appelation "sunnites".
2

6. La compétition sunnite/chî’ite.
Pour les premiers, importance de la tradition obligatoire fondée sur un hadith, un texte explicite,
source de la Loi, du prophète. Toujours pour réagir contre l’utilisation avérée de l’opinion
personnelle, il faut reconnaître aussi la légitimité de l’accord unanime de la communauté.
Les chî’ites travailleront aussi à leur unification doctrinale mais ils n’ont pas les œuvres
magistrales dont disposent les Sunnites.
La pensée classique.
On l’a vu les penseurs et les écrivains se sont tournés vers l’antiquité arabe, iranienne, grecque
pour construire un espace culturel nouveau toujours subordonné cependant au Modèle
indépassable qu’il s’agit de promouvoir à l’aide du Coran et de l’expérience du Prophète (A49).
Entre le X ème et le XIII ème siècle se constitueront les humanités arabes, un domaine touffu et
complexe.
Six noms essentiels en philosophie (B114)
I. Al-Kindi (mort en 873), appelé le philosophe des arabes. Originaire de Mésopotamie.
II. Al-Farabi (né en 870, d'origine turque). Il est le "second Maître "( après Aristote).
III. Ibn Sinna (Avicenne), né en 980, mort en 1037; "indubitablement , un idéaliste"(B116)
IV. Al-Gazali né en 1058. L'anti-philosophe, l'avocat passionné de la religion traditionnelle. Il prend le
manteau de laine blanche que portent les sûfi, adeptes d'une voie mystique (B117).
V. Ibn Rushd (Averroès) nè à Cordoue en 1126, décédé en 1198. Un philosophe de la fin du monde
(B116). Editeur fidèle des oeuvres d'Aristote. Textes et commentaires seront traduits de l'arabe en latin
(B117).
VI. Ibn Khaldun,le dernier géant de la pensée musulmane , né en Tunisie en 1332, décédé au Caire en
1406 (B141).
Avicenne et Averroès écrivent un traité médical et longtemps la médecine musulmane sera le dernier mot de la
science (y compris pour les médecins de Molière).
Admirateurs d'Aristote, les philosophes arabes sont contraints à un dialogue aux mille rebondissements, entre
une révélation prophétique, celle du Coran, et une explication philosophique humaine, celle des Grecs. Une
querelle angoissée, quelles concessions mutuelles entre la raison et la foi? (B115).
1. Ses caractères généraux.
Pour s’en tenir au seul domaine économique. Le monde musulman poursuit sa croissance jusqu’au
XI ème siècle quand les Turcs seldjoukides déferlent sur le Proche Orient, les nomades hilâliens sur
le Maghreb, tandis que le Califat de Cordoue se disloque en principautés qui seront la proie facile
de la Reconquista. Mais c’est surtout avec l’essor de l’Europe occidentale (avec, notamment les
marchands italiens dès le XII ème siècle) que commencera le déclin de la civilisation arabo-
islamique.
On notera cependant dans l’âge d’or de cette civilisation, la distinction entre les sciences
rationnelles (physique, médecine,...), apanage d’une élite et les sciences religieuses ouvertes à un
public plus large, dans les mosquées. C’est le cas des mystiques qui se regrouperont en cercles d’où
sortiront les confréries. Ces années sont aussi des temps d’acquisition de savoirs , de promotion
intellectuelle des savants dont les conseils sont recherchés. Mais il y a peu d’initiateurs d’idées
vraiment neuves (A54).
2. Un système cognitif commun.
a) L’adab.
Il représente l’ensemble des connaissances profanes utilisables par le citadin cultivé. C’est
3

l’expression d’une pensée parvenue à sa maturité. La frontière du pensable et de l’impensable se
déplace et la tendance laïcisante, rationalisante, réaliste gagne du terrain .
Géographiquement, la terre est divisée en une « demeure de l’Islam » et un espace étranger peu
connu.De la même manière, le temps va se diviser entre un temps mythique (origine des choses, du
monde,…) et un temps cyclique et liturgique (rituels, fêtes,…). L’Hégire (622 après J.C.) fait la
différence entre un temps obscur, se prêtant aux évocations mythologiques et un temps
événementiel .
Le sujet humain se doit de cheminer dans la voie de la perfection, condition sine qua non du Salut
individuel pour ressembler à Dieu.Le lien est fort entre le Beau, le Bien, le Vrai. C’ est tout-à-fait
caractéristique du langage musulman et c’est à la base l’inimitabilité du langage coranique.
Autre caractéristique, la citation et notamment la citation par excellence qui fournit l’argument
d’autorité(A59).
b) Les tensions éducatives dans la pensée classique.
Ces tensions s’expriment par des couples de concepts opposés tels que : raison/Loi religieuse ;
raison/Révélation ; connaissance rationnelle/ connaissance traditionnelle ; sens ésotérique, science
obvie ; innovation/pratique consacrée ; sacral/profane,... En fait, la pensée arabe se trouve de plus
en plus enfermée dans ce postulat : la Vérité ultime, éternelle et totale est incluse dans le Coran qui
a été une Parole, puis un texte.
L’accès à la vérité est donc conditionné par des techniques de décryptage d’un texte dont les clés
sont multiples(A60).Comment sortir de ces oppositions ?
Une conscience indivise (un effort de la raison confortée par la foi) ? Il reste que cet effort a
perpétué la vision mythique au détriment d’une vision positive de l’homme et de l’histoire. La
contemplation du merveilleux, des essences immobiles (Dieu, l’âme, la Raison, la Justice, le Vrai,
…) l’a toujours emporté sur l’observation personnelle, l’expérimentation,… (A 62).
c) Écoles et thèmes.
En gros,une communauté orthodoxe, fidèle à l’Islam vrai face à des « sectes égarées ».Comment
définir la valeur comparée de la raison et de la Révélation comme sources et garants de la
connaissance vraie ? (CA63).Comment partager entre une visée traditionaliste et une visée
rationaliste ?
Mais quand le Coran parle de raison, de quoi s’agit-il ?
La notion de ‘aql dans le Coran. Elle recouvre en fait, trois concepts différents : intellect, raison
théorique ou constituante, raison pratique ou constituée. C’est un appel à un exercice simultané de
toutes les puissances de l’esprit. Mais il y a deux puissances inséparables:le cœur et l’esprit donnent
lieu à la saisie intuitive d’une certitude de foi , d’une part, à l’intellection d’une vérité démontrée
par la raison discursive.
A nouveau Platon et Aristote. Pour le premier : « connaître les noms, c’est connaître les
choses ».Dans la Genèse : « Dieu apprit à Adam tous les noms ».. Il y a une relation stable,
nécessaire entre les choses et leur nom.
Pour Aristote, l’homme appréhende d’abord les objets, et leur donne ensuite des noms arbitraires :
le sens est une relation arbitraire.
De là découlent 3 attitudes différentes : traditionaliste, rationaliste, mystique.
1. L’attitude traditionaliste.
Priorité de la Tradition sur la raison.La Tradition est l’ensemble des énoncés et pratiques par
lesquels le Prophète et les pieux Anciens (les Compagnons pour les Sunnités, les Imâns pour
les Chî’ites) ont explicité le donné révélé coranique. Cette définition est très englobante et
réunit à peu près tout sauf les Falâsifa et avec quelques correctifs, les Mu’tazilites.
On peut distinguer un traditionalisme strict (littéralistes partisans du sens obvie du texte
sacré, hostiles à toute discipline où la raison interviendrait en faculté souveraine constituante
de sens) et celui des théologies dogmatiques et fondamentalistes des sunnites et des chî’ites.
Mais ces deux tendances ont un fond commun. Elles font appel à l’homme raisonnable : la
4

raison fonctionne comme l’ « instinct déposé par Dieu chez ses créatures mises à l’épreuve
pour le servir ». Dans la pratique, on réactualise les portraits, le rappel des expériences
vécues, les citations,...les conduites exemplaires qui doivent hanter chaque conscience
jusqu’à susciter des imitations instinctives (A 67).
On veut aussi dégager la leçon de l’histoire. Qu’est-ce que celle-ci nous a appris ? Elle
« avertit » les hommes, comme dit le Coran, sur les actes qu’il faut reproduire et ceux qui
doivent être évités.
Il y a enfin les articles de foi que les fidèles doivent professer sans demander de preuves.Un
enseignement dogmatique dont voici quelques exposés neutres :
Unicité de Dieu,
Existence de Dieu, attributs de l’essence et des actions de Dieu.
Le Coran , Parole éternelle, incréée de Dieu,
La foi et l’infidélité,… (cf A 68).
Les écoles principales :
Chez les Sunnites : les Hanbalites. Contre toute initiative d’approcher le mystère de Dieu par
la spéculation, pour les esprits les plus simples. On met en regard l’argument d’autorité
(verset ou hadith) et l’assentiment requis.
Du côté chî’ite, deux écoles que je citerai seulement : les imâmiens ou duodécimains ; les
ismâ’iliens, Où faut-il arrêter la série des Imâns impeccables ? Au douzième ou au
septième ?
2. L’attitude rationaliste.
Elle s’oppose à la précédente en ce qu’elle affirme la supériorité méthodologique de la
Raison sur la Tradition. Cette Raison souveraine s’attache obstinément à prouver que ses
principes et conclusions sont en accord avec ceux du donné révélé.
Deux courants de pensée :les Mu’tazilites (avec des réserves) et les Falâsifa (philosophes). Il
s’agit de s’élever vers l’Un en parcourant la voie ascendante à partir des éléments simples
(terre, eau, air,feu) ou la voie descendante du flux émanateur qui traverse toute la création.
(A75). L’âme ne peut se retirer en soi sans y retrouver le monde, ni sortir de soi sans se
retrouver dans le monde.
Une figure : Ibn Ruchd, de tendance aristotélicienne.
3. L’attitude mystique.
Discipline ascétique pour transformer radicalement le moi psychologique en un surmoi
pouvant se hisser jusqu’à l’ « union avec Dieu » : c’est le sufisme en deux mots ((A76).
Il faut dépasser le niveau superficiel du paraître, le niveau intermédiaire du coeur.
Une figure : Ibn Khaldûn mort en 1406.
Conservation , ruptures et résurgences.
L’espace mental de la pensée classique est entièrement constitué au XIIIème siècle. L’an 1258
représente cependant une date importante. Cette année-là les Turcs s’emparent de Bagdad et mettent
fin au califat abbâside. L’Islam chî’ite triomphe en Iran, l’Islam arabe est recueilli en Syrie et en
Égypte. En Occident, l’Islam andalou se réfugie dans le Royaume de Grenade. Sans oublier les
Mérinides du Maroc et les Hafsides d’IIfrîqiyâ.
Du XVIème au XIXème siècle, les Turcs Ottomans prennent en charge surtout politiquement,
l’Islam arabe et méditerranéen.
Conservation des valeurs, ruptures, voire résurgences sont caractéristiques de cette période parfois
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%