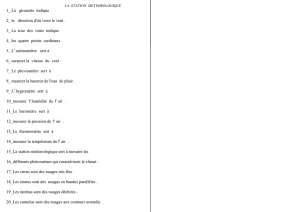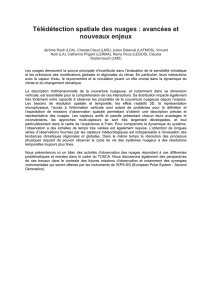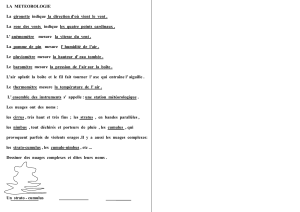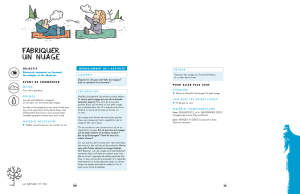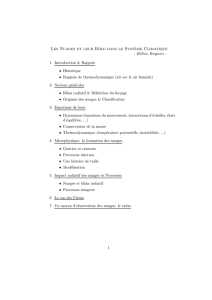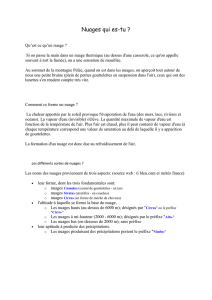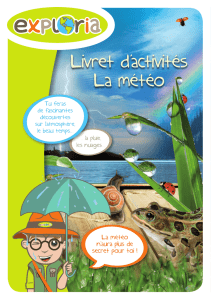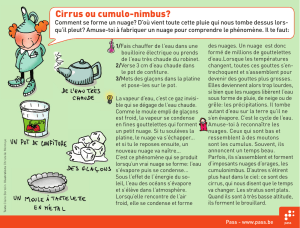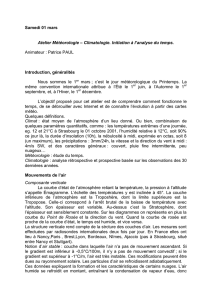L`observation des nuages

Climatologie des nuages
L’observation des nuages
Didier Renaut
Avant l’arrivée des premiers satellites
météorologiques (qui date des années
1960), la climatologie des nuages
reposait sur la compilation des obser-
vations synoptiques de surface effec-
tuées en routine, 4 ou 8 fois par jour, à
terre ou à bord de navires, par tous les
services météorologiques du monde.
Cela représenterait environ un million
d’observations par mois pour les sta-
tions terrestres et 100 000 pour les
navires.
Les relevés correspondant à ces obser-
vations, archivés mais aussi, le plus
souvent, transmis via le système
mondial de télécommunications de
l’OMM, contiennent, en ce qui
concerne les nuages, des informations
locales sur la couverture nuageuse
totale ainsi que par type de nuage (en
trois catégories d’altitude), le « temps
présent » (précipitations, brouillard,
etc.) et la hauteur de la base des
nuages.
À l’aide de ces relevés, il est possible
d’établir, de façon plus ou moins com-
plète, une climatologie décrivant la
couverture nuageuse du globe, ses
caractéristiques, voire ses évolu-
tions, avec l’objectif final d’étudier,
de surveiller et de modéliser le climat
de notre planète. Il semble ainsi qu’une
des plus anciennes descriptions de la
couverture nuageuse à l’échelle du
globe soit due à Brooks (1927). Un
historique assez complet de la climato-
logie des nuages a été publié par
Hughes (1984). La version la plus
récente de climatologie globale des
nuages reposant sur les observations
de surface est due à Warren et Hahn,
en 2012, sous forme de site Web :
http://www.atmos.washington.edu/
CloudMap/.
Les observations de surface des
nuages, essentiellement visuelles,
comportent des limitations qui peu-
vent introduire des biais dans les
climatologies :
– situé sous les nuages, l’observateur
voit la base et les bords des nuages. En
conséquence, il surestime souvent la
couverture nuageuse et privilégie les
nuages bas. D’autres types d’erreurs
peuvent intervenir en fonction de
l’expérience de l’observateur et de
l’environnement géographique du lieu
d’observation. Enfin, l’observation
visuelle est difficile de nuit, en par-
ticulier pour l’identification des
cirrus ;
Avant-Propos
– les observations de surface ne don-
nent que la couverture nuageuse d’une
toute petite zone géographique et leur
répartition sur le globe est clairsemée
et inégale (dense dans certaines
régions continentales, presque inexis-
tante sur certains continents et sur
certaines parties des océans), ce qui
pose un problème important de
représentativité.
Lorsque l’on compare les climatolo-
gies globales des nuages provenant des
deux types d’observations (surface et
satellite), la principale différence
réside dans la couverture en nuages
bas, plus importante pour l’observa-
tion de surface. Ceci est lié au fait que,
dans le cas de nuages sur plusieurs
couches, les instruments spatiaux iden-
tifient la couche la plus élevée contrai-
rement à l’observateur de surface qui
identifie la couche la plus basse. Sur
ce point précis, laissons conclure
Hughes (1984) : « Les observations de
la couverture nuageuse totale par satel-
lite et depuis la surface sont complé-
mentaires ; il est déraisonnable de
s’attendre à ce que des climatologies
des nuages compilées à partir d’obser-
vations de nature différente soient
identiques ».
L’épaisseur optique d’un nuage COD
(cloud optical depth), en général déter-
minée dans le domaine visible, mesure
l’importance de son interaction avec le
rayonnement. Elle dépend de l’épais-
seur géométrique du nuage, de sa
concentration en particules et de l’apti-
tude de ses particules à interagir avec
le rayonnement. Si la fraction du
rayonnement transmise par le nuage
La Météorologie - n° 82 - août 2013
38
La climatologie des nuages avant l’arrivée des satellites
Quelques propriétés radiatives et microphysiques des nuages
(ou transmission du nuage) est I/I0,
l’épaisseur optique du nuage est
définie par
COD = –ln (I/I0)
C’est un nombre sans dimension. Une
épaisseur optique nulle correspond à
un nuage totalement transparent
(I = I0), une épaisseur optique infinie à
un nuage totalement opaque (I = 0).
L’épaisseur optique dépend de la
longueur d’onde considérée. Typique-
ment, l’épaisseur optique d’un cirrus
varie de moins de 0,03 pour un cirrus
subvisible à 5 pour des cirrus épais
des latitudes moyennes. L’épaisseur
optique des nuages d’eau liquide,
beaucoup plus élevée, est comprise
entre 5 et 100.

L’émissivité d’un nuage CEM (cloud
emissivity) est le rapport entre le
rayonnement émis par le nuage et celui
qu’émettrait un corps noir à la même
température. Elle mesure la capacité
d’un nuage à absorber et à réémettre le
rayonnement (essentiellement le
rayonnement infrarouge, à cause de la
température des nuages). C’est un
nombre sans dimension compris entre
0 et 1. L’émissivité dépend de la lon-
gueur d’onde considérée. L’évaluation
GEWEX montre qu’en moyenne
globale l’émissivité des nuages (glacés
et liquides) est comprise entre 0,4 et
0,8 dans l’infrarouge thermique.
Image composite de la couverture nuageuse globale, obtenue par la juxtaposition des images, proches dans le temps, fournies par les radiomètres multispectraux (canal infrarouge)
de plusieurs satellites météorologiques géostationnaires et défilants. Image du 12-02-2013 à 18 h UTC. (© Météo-France CMS Lannion).
Brooks C.E.P., 1927 : The mean cloudiness over the earth. Mem. Roy. Meteor. Soc., 1, 127-138.
Hugues N.A., 1984 : Global cloud climatologies: A historical review. J. Climate Appl. Meteor., 23, 724-751.
Bibliographie
La Météorologie - n° 82 - août 2013 39
Le contenu intégré en eau des nuages
CWP (cloud water path) est la masse
d’eau condensée contenue dans une
colonne verticale de surface unité du
nuage. Il s’exprime en g.m–2. Selon la
phase de l’eau condensée dans le
nuage, on peut distinguer le contenu
intégré en eau liquide CLWP (cloud
liquid water path) et le contenu intégré
en glace CIWP (cloud ice water path).
L’évaluation GEWEX montre que les
valeurs typiques de ces variables
varient de 30 à 120 g.m–2.
Le rayon effectif des particules du
nuage CRE (cloud effective particle
radius) correspond à un rayon moyen
de la distribution en taille des particu-
les ou au rapport du volume des parti-
cules à leur surface projetée. Cette
variable permet de faire le lien avec les
propriétés radiatives du nuage. La
valeur du rayon effectif dans les nua-
ges varie typiquement de 20 à 120µm
pour les cristaux des nuages glacés et
de 5 à 30 µm pour les gouttelettes des
nuages d’eau liquide. Le rayon effectif
moyen global des particules de nuages
est d’environ 14 µm (± 1 µm) pour les
sommets des nuages liquides et d’envi-
ron 25 µm (± 2 µm) pour les nuages
glacés élevés.
1
/
2
100%